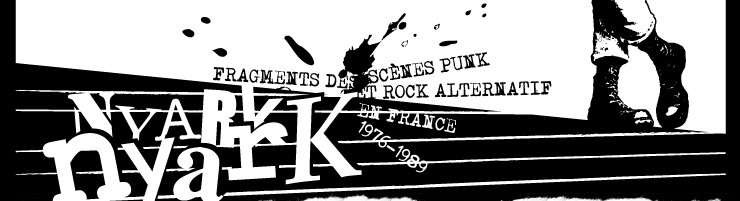Métal Urbain 1976 ?
Éric Débris : Le premier concert c’est 76, le 10 décembre 1976.
En 76, vous vous dites punks ?
Éric Débris : On fait comme les punks anglais ou américains, on devient punks. On fait partie de la première vague, on fait partie des groupes qui ont inventé le genre, donc on ne s’en rend pas vraiment compte. On fait de la musique, on est sapé d’une certaine manière et l’on s’aperçoit d’un seul coup qu’on est labellisé punk par la presse. On a vu les trucs sur la scène de 74, les Ramones, j’ai vu Patti Smith en concert à Paris, des trucs comme ça. On est au courant qu’il se passe un truc aux USA…
Vous avez quand même des références discographiques ?
Éric Débris : Évidemment, à l’époque on écoute toute la scène glitter anglaise [aussi appelée Glam rock, NDA], Bowie, Roxy Music etc., et du coup tout ce qui en découle aux États-Unis, qui est plus violent comme les New York Dolls et d’autres groupes américains, évidemment les Stooges… On a, comme tous ceux qui sont tombés dans la marmite punk, la double compile Nuggets, qui a été faite par Lenny Kaye, où l’on trouve l’essentiel des groupes garage punks américains. Ça finit de nous confirmer qu’il y a des gens qui font une musique plus violente, moins commerciale, pas exactement celle qu’on entendait tous les jours, qu’il n’y avait pas que les Beatles, les Rolling Stones et les Pink Floyd, qu’il y avait d’autres groupes. On s’en doutait, j’avais déjà acheté des disques de Captain Beefheart, des trucs comme ça… On fait partie de ceux qui sont assis au fond de la classe, qui sont plus préoccupés par le dernier disque qu’ils ont acheté que par le cours de maths, c’est tout. En fait, faire du punk-rock à l’époque, c’est vouloir faire du rock’n’roll différemment de ce qu’on voit.
C’est-à-dire ?
Éric Débris : À la fois au niveau musical et des textes, l’attitude, revenir au rock’n’roll. Donc on était spectateurs de cette scène-là, et, quand on a grandi, on a voulu faire du rock’n’roll plus vite, plus dur, plus violent etc. Avec des textes qui parleraient de trucs qui nous touchent à ce moment-là, de politique, parce qu’écrire des textes genre “tu m’as quitté baby reviens”, si tu veux, ça avait été fait et refait…
En 1976 quel âge avez-vous ?
Éric Débris : J’ai 19 ans. En fait les prémices de Métal Urbain c’est 1974-75. En 74, je suis déjà dans des groupes qui n’ont pas vraiment de rapport avec ce que je veux faire, c’est juste pour être dans un groupe. Ensuite, je collabore à divers projets avec des gens que l’on va retrouver après, à droite à gauche, un peu comme en Angleterre les London SS. Ce sont des espèces de groupes qui n’existent pas vraiment, qui répètent et dans lesquelles on va croiser à peu près tout le monde à un moment ou à un autre… Une espèce de groupe qui s’appelait “Blood Sucker” dans lequel il y a eu Jacno, Rikky Darling, Zip Zinc, Pat Lüger, Herman Schwartz…
Un métagroupe… ?
Éric Débris : Oui, un truc qui a servi à tout le monde pour s’exercer un peu… Ensuite, à l’origine de Métal Urbain on trouve un projet qui n’a pas duré, qui a fait une répète et demi, qui s’appelait “De Sade”. Il y avait Rikky Darling, Zip Zinc et moi. On avait la volonté d’utiliser le synthétiseur et des guitares pour faire une musique violente, contrairement à la musique planante qui se faisait avec des machines. Zip et moi on était passionnés de machines, de synthés, mais on trouvait que ça n’allait pas assez loin. Dès que les mecs essayaient de faire un truc, c’était du genre “chhhuuuu, chhuuuu”, ou bien c’étaient des musiciens qui faisaient de la musique “concrète” ou de la musique moderne, comme Pierre Henri, des gens comme ça. Mais ça n’allait pas assez loin pour nous. On a tenté un truc avec machines et guitares, et au cours de cette répétition, un de nous, je ne sais plus si c’est Zip Zinc ou moi, fait : “c’est du métal”, et l’autre : “oui, mais urbain”, alors c’est du métal urbain. Et là, on a décidé finalement de faire des morceaux de trois minutes, de les ramener à un format rock, de trouver un chanteur… Sans penser faire du punk rock ou autre, parce qu’on faisait ce qu’on voulait faire…
L’étiquette n’était pas encore “écrite”…
Éric Débris : Non et puis il n’y avait pas de “style punk”, le punk au départ c’est chacun fait sa musique avec son style. Les mecs ne faisaient surtout pas la même chose que le voisin. C’est à partir de la deuxième vague que les mecs ont commencé à faire du punk rock, et là, pour moi ça commence à partir en couilles parce que ce n’est pas un style, le punk rock, c’est une attitude, donc il y a un problème.
 Les premières répétitions de Métal Urbain en 1976 ?
Éric Débris : La première répète de Métal Urbain a lieu une semaine avant de jouer au Golf Drouot. Les morceaux qui existent sont ceux sur lesquels on avait travaillé avec Zip Zinc, avant l’été 76. Je vais traîner à Londres avec Panik pendant l’été. Là, on voit en effet qu’il y a plein d’autres mecs qui sont dans le même délire, et on voit que ça commence à bouger très, très sérieusement… On va au festival de Mont-de-Marsan, où il y a deux groupes et demi de punks qui jouent, le reste ne sont pas vraiment des groupes punks. A part les Damned, il n’y a pas vraiment de punk rockers là-bas… A la rentrée on commence à se dire “il faut faire un truc”, et finalement on décide que Clode Panik sera le chanteur du groupe.
Les premières répétitions de Métal Urbain en 1976 ?
Éric Débris : La première répète de Métal Urbain a lieu une semaine avant de jouer au Golf Drouot. Les morceaux qui existent sont ceux sur lesquels on avait travaillé avec Zip Zinc, avant l’été 76. Je vais traîner à Londres avec Panik pendant l’été. Là, on voit en effet qu’il y a plein d’autres mecs qui sont dans le même délire, et on voit que ça commence à bouger très, très sérieusement… On va au festival de Mont-de-Marsan, où il y a deux groupes et demi de punks qui jouent, le reste ne sont pas vraiment des groupes punks. A part les Damned, il n’y a pas vraiment de punk rockers là-bas… A la rentrée on commence à se dire “il faut faire un truc”, et finalement on décide que Clode Panik sera le chanteur du groupe.
Pourquoi ?
Éric Débris : Ben c’est un pote, il a la dégaine, il est branché sur les mêmes trucs que nous, il se sape comme nous et il a l’air d’un chanteur. Dans le punk rock, dans le rock aussi d’ailleurs, on embauche un type parce qu’il a l’air d’un bassiste, d’un batteur ou d’un chanteur et pas parce qu’il sait jouer, c’est après qu’il apprend… Et coup de bol, pour nous le casting était bon… Alors il y a le tremplin du Golf Drouot. À l’époque, c’est hyper fastoche : on s’inscrit, on te donne une date, et un mois ou trois semaines après tu joues. Un soir où Alsphat Jungle jouait là-bas, on s’inscrit, et on nous donne une date, le 10 décembre 1976. Là, on a genre deux semaines et demi, pour trois répètes et on fait le concert… Mais comme on bosse avec des machines, ce n’est pas tout à fait pareil. Les morceaux sont pré-existants, il suffit que Panik les chante, qu’on place les guitares dessus et puis c’est parti !
On a là le line up définitif ?
Éric Débris : Le line up c’est : deux synthés et la boîte à rythmes, Zip Zinc et moi. À l’époque, la boîte à rythmes est fabriquée par Zip Zinc, qui est lui-même batteur, mais qui ne veut plus jouer de batterie. Il pense que ça ne sert plus à rien, il est parti dans un truc radical, il trouve plus intéressant de programmer des rythmes, plutôt que d’acheter du matériel qui est cher et rudimentaire à l’époque. Il a aussi fabriqué un synthé. Moi, au tout début, j’ai un bout de matériel qu’il a fabriqué. Puis, j’ai un peu d’argent, un héritage, je vais m’acheter un synthé AKS sur lequel je vais bosser un paquet d’années. Il y a aussi un guitariste, Rikky Darling qui joue aussi à l’époque dans Asphalt Jungle. Il était entre les deux groupes, mais on jouait ensemble depuis pas mal de temps. Je l’avais rencontré au bahut, c’est un mec avec qui je faisais de la musique dans tous les autres projets que j’avais avant. Et donc, naturellement on prend la forme suivante : deux mecs aux synthés, une guitare, et un chanteur. Après ça tournera, Rikky va partir et deux guitaristes vont le remplacer.
Est-ce qu’à cette époque, vous avez conscience que l’état d’esprit dans lequel vous êtes, les choses auxquelles vous aspirez sont partagées par d’autres ? Qu’il existe un embryon de scène en France ?
Éric Débris : Oui… Il y a très peu de gens, c’est comme à Londres ou à New-York. La scène est microscopique, quelques petites centaines de personnes à tout casser, des gens qui tournent autour d’Asphalt Jungle, des Stinky Toys, qui se retrouvent à l’Open Market où à Harry Cover, un magasin qui fait des tee-shirts…
C’est essentiellement parisien ?
Éric Débris : On ne sait pas s’il se passe des trucs en province. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Là, on a fait des bonds vraiment incroyables… Il y a 30 ans, passer un coup de téléphone ça coûte cher, même à Paris. On restreint les appels… Ce n’est pas l’époque des diligences, mais prendre le train à l’époque c’est toute une aventure… Donc c’était dur de savoir ce qui se passait, il n’y avait pas de contact avec des gens d’autres villes, pas de média qui relayait, il n’y avait pas internet, pas de fanzines…
Les radios ?
Éric Débris : À la radio il n’y a rien… Quelques émissions spécialisées. Alors il n’y a rien, et finalement il y a plus, c’est aussi le paradoxe. À l’époque à la radio, on a trois ou quatre émissions le soir qui arrivent plus ou moins à s’enchaîner. Sur RTL il y a une émission avec un mec qui maintenant traîne chez Ruquier, qui à l’époque est un vrai rocker, qui a déjà de temps en temps de gros goûts de chiottes, il ne comprenait pas vraiment tout, mais en attendant quand notre 45 tours est sorti, il l’a passé tout de suite. C’était une émission où les mecs passaient des nouveautés. À l’époque, le but du jeu n’était pas de faire de l’audience en passant des trucs lisses… Dans les émissions “rock”, on passait du rock pointu avec les nouveautés qui étaient sorties dans la semaine, voire le jour même, parce qu’autrement ça n’avait pas d’intérêt. Le mec qui passait les mêmes disques qu’il y a 15 jours, on s’en foutait. Il y avait aussi l’émission de José Arthur sur France Inter en première partie de soirée, le Pop Club… Donc il y avait moyen, finalement, de savoir ce qui se passait, parce que c’était super pointu. Les canards de rock ne faisaient pas des couvertures parce que les maisons de disques les leur avaient achetées, mais parce que c’était un truc qui les branchait, quelque chose qui avait une valeur… Même si à l’époque, ils ne parlaient que des anglais et des américains, ce n’était pas biaisé comme maintenant. Le bac de nouveautés à la FNAC, c’était chaque semaine une cinquantaine d’albums en import, à peu près le même nombre en pressage français et des 45 tours de rock qui étaient maintenus dans les bacs parfois deux ans après leur sortie. Le fonctionnement était donc complètement différent. C’est sûr que c’était à la fois plus lent en terme d’information sur ce qui se passait localement, par contre on choppait des infos sur l’Angleterre ou les États-Unis, il suffisait d’acheter des canards en import dans les kiosques et de traîner à l’Open Market ou chez Harry Cover… C’était possible d’aller trouver de l’info parce qu’elle était toute petite, alors que maintenant, il y en a tellement que les gens n’y font plus gaffe… Par contre, pour savoir ce qui se passait en France, c’était impossible. Il y avait Paris, et le reste c’était loin et cher…
On revient à votre première expérience de scène, au Golf Drouot ?
Éric Débris : En fait, on va à ce concert, là on est en plein dans une attitude punk.
C’est-à-dire ?
Éric Débris : Le Golf Drouot à l’époque est rempli de mecs, ce qu’on appelait les babs, le reste des hippies, à cheveux longs, sapés avec des fringues des surplus de la guerre du Vietnam, une espèce de masse verdâtre, avec des sacs américains et des badges dessus, des signes de la paix, des vestes avec des conneries marquées, et puis une attitude de grand Duduche… Et nous là-dedans, évidemment on a les cheveux courts, on porte des jeans, des tee-shirts, des trucs synthétiques, des fringues qu’on trouve encore assez facilement à l’époque, des vieux restes des années 50, des chemises en nylon… Et déjà, le seul fait de porter des jeans droits, pas à pat’ d’éf, des baskets des tee-shirts blancs avec un badge dessus et surtout d’avoir les cheveux courts c’est suspect, bizarre… Et les gens se méfient. Donc on débarque au Golf Drouot, et là on voit des mecs sapés avec des impers en plastique, et déjà, en montant dans l’escalier on entend hurler “Révolution, anarchie !”, le délire. Donc on fait notre balance on se resape pour monter sur scène, il y a quelques punks qui sont là les mecs d’Asphalt Jungle, quelques mecs qui tournent autour d’eux… On attaque le concert avec les hippies, les babs, en partie assis par terre… Évidemment, on envoie une musique super forte parce qu’on contrôle en partie le niveau avec notre système. Les mecs commencent à reculer un petit peu. Nos potes sont debout devant, du coup tout le monde se lève, (ce n’est pas un concert assis), et au bout de trois morceaux il y a une canette qui vole et passe à côté de ma tête. Là, de manière hyper subtile, je me plante sur le devant la scène et je fais un salut nazi au mec. Toutes ces conneries autour du salut nazi on en reparlera peut-être à un moment, parce qu’il y a un truc à clarifier par rapport à ça. Le fait de faire ça, c’est plus pour provoquer le mec en face parce qu’il vient d’avoir une attitude, genre de censure, de te balancer un truc dans la gueule, donc tu lui réponds, tu fais pareil. Évidemment, les mecs commencent à s’énerver, le morceau continue et à un moment Clode Panik se penche, et un mec saute pour essayer de l’attraper par les cheveux. Vu qu’il n’en a pas, ça ne marche pas et le mec se ramasse la gueule. Zip Zinc de son côté prend un pied de micro et il saute dans le public avec… Les mecs du premier rang, Asphalt & co, se retournent et commencent à latter dans tous les sens, Rikky Darling avec sa guitare retournée est prêt à allumer le premier qui approche de la scène, voilà le premier concert, baston générale…
La légende est en marche…
Éric Débris : Et le patron du Golf Drouot, mort de rire, qui vient nous voir à la fin : bon, ben les gars, vous êtes hors-concours…
Vous ne gagnez pas le tremplin… ?
Éric Débris : Non, on est hors-concours ce soir-là. “Vous êtes hors-concours, c’était spécial… “, il se marrait. Je pense qu’il s’était revu à ses débuts avec les premiers groupes de rock… Ils n’en parlent pas, mais je suis sûr qu’avec les Chaussettes Noires il y a eu des bastons au Golf. Il y a eu tant d’énervés là-bas, que c’est forcément parti en vrille, ils n’en ont jamais parlé, pour la légende, après “Âge tendre et têtes de bois”… Mais lui, il était mort de rire !
Il ne découvrait pas ?
Éric Débris : Pour lui c’était : “ça y est c’est reparti pour un tour, il y a des rockers qui vont faire les cons !”. Autrement dit, il a dû se faire chier pendant les dix ans entre les deux, avec les hippies qui étaient assis… Je pense que là, il a dû recommencer à rigoler. Mais le Golf s’est arrêté très vite, On n’a pas pu y rejouer. Tous les mois il y avait une chronique dans Best sur les groupes qui avaient gagné, et cette fois ci, c’est nous le groupe hors-concours, qui nous sommes retrouvés avec la chronique. Ce qui a dû faire vachement plaisir aux autres groupes, qui eux faisaient de la vraie musique, et qui avaient gagné.
Une bonne chronique ?
Éric Débris : Super, je ne me rappelle plus du titre, mais en gros : “ça y est le punk débarque en France au Golf Drouot avec Métal Urbain” et blablabla…, et une photo de nous.
Vous jouez quels morceaux à l’époque ?
Éric Débris : Il y a une reprise de “No Fun”, “Snuff Movie” une version digne d’un film de Rob Zombie, digne de “La colline a des yeux”. On joue un morceau qui s’appelle “Métal Urbain” à l’époque, une reprise de “Anarchy in the UK” en version française, “Lady Coca-Cola”. On a cinq titres à l’époque, mais on n’arrive à en jouer que trois. On était mort de rire, on ne pouvait pas espérer mieux ; un concert qui dégénère en baston générale, c’était parfait pour le premier. C’est sûr qu’on est rentré par la grande porte dans le Panthéon…
Vous avez de bonnes répercussions suite à ce concert ?
Éric Débris : Oui, il y des mecs de maison de disques qui veulent nous signer. Ils sont présents ce soir-là parce que c’est la maison de disques qui est en train de signer Asphalt Jungle. Et le mec qui a fait l’article dans Best est leur attaché de presse. Le lendemain, il arrive dans les bureaux de la maison de disques en disant : “j’ai vu un truc de cinglé hier, il faut qu’on regarde parce qu’ils sont pires que les autres”. Donc c’est parti… On sait assez vite qu’il y a de l’intérêt dès le premier concert. On essaye d’en trouver d’autres, ce qui n’est pas simple. Il y a un réveillon punk qui est organisé par Zermati, donc le 31 on essaye d’y jouer.
Zermati qui tenait l’Open Market et qui a organisé festival de Mont-de-Marsan ?
Éric Débris : Oui, on le connaît un peu, et on lui demande de jouer au réveillon punk. Il ne veut pas vraiment… Il commence à y avoir des rumeurs à la con, genre Métal Urbain c’est des gosses de riches… Parce qu’on a des synthétiseurs… Rikky a une guitare qu’il a achetée avec l’héritage de la mort de sa mère, moi j’ai un synthé acheté avec une assurance suite à la mort de mon père, et le reste du matos est fabriqué par nous-même, on n’a même pas d’ampli. On a rien ! Une partie d’ailleurs du matos que Zip Zinc utilise est fait avec des pièces volées dans le camion d’un artiste de variété, dont une console de mixage, et d’autres trucs qui avaient été désossés, réassemblés… On était peut-être le groupe qui avait le moins de matériel, mais parce que c’étaient des synthés les gens imaginaient que c’étaient des trucs qui valaient une fortune. On n’arrive pas à jouer à ce truc-là, on y traîne quand même, puis après il y a des trucs qui se mettent en place, dont un concert au théâtre Mouffetard qui est organisé par des groupes. Il y a une espèce de collectif, on se retrouve dans l’organisation, mais en fait je ne sais même pas qui organisait vraiment, on en faisait partie, mais je n’ai jamais compris comment ça c’était goupillé, tout ce qu’on sait, c’est qu’on a joué. C’était au mois de mars, il y a des élections ce jour-là, et on arrive sur scène avec nos cartes d’électeurs accrochées comme des badges avec des A anarchistes dessus. Évidemment, on refuse d’aller voter. On va enchaîner en 77 sur les concerts en première partie d’Asphalt Jungle qui a choppé une résidence au Gibus pour une semaine. On fait deux soirs de suite, dont un le 22 mars. Date qui nous fait marrer parce que c’est l’anniversaire du 22 mars 68. On arrive avec une banderole sur scène “Que faisiez-vous le 22 mars 68 ?”. On joue vachement avec ces trucs-là… Anarchistes, post 68 voire avant 68…
Une démarche situationniste ?
Éric Débris : Oui, quoique les situationnistes, on ne connaisse pas vraiment, on est plus anarchistes. Plus tard, des mecs commencent à nous parler du manifeste situationniste, en nous disant : vous êtes vachement proches de ça, et on répond : “ben non, on ne sait pas”, et c’est vrai qu’à Paris, à l’époque les punks ne sont pas vraiment au courant, et encore moins à l’étranger. On est d’ailleurs beaucoup plus proches des lettristes que des situationnistes. Quand on voit les mecs qui traînaient à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, la façon dont ils étaient sapés, avec leurs fringues peintes, avec des textes dessus, c’était très proche de ce qu’on a fait, mais on ne savait pas qu’ils existaient. Pour l’essentiel, on était trop jeunes pour être à la fac et avoir étudié ces trucs-là, les autres traînaient plutôt aux Beaux-arts, ils n’étaient pas en Lettres. On était proches sans le savoir.
En 77, grâce à vos différents contacts, vous enregistrez votre premier 45 tours ?
C’est venu très vite, on a fait quelques concerts. Le patron de la boîte de disque est venu nous voir à un concert au théâtre Oblique, qui est devenu le théâtre de la Bastille. Il est rentré dans la salle - il nous l’a dit après -, il a regardé un morceau et demi, et il est sorti pour reprendre son souffle… Et donc on enregistre le premier 45 tours fin avril-début mai, il sort en mai. Dessus, on retrouve “Panik”, “Lady Coca Cola”, et une chute de studio, “Métal Urbain”, en instrumental, qui n’est pas utilisée, et qui disparaît. Vous commencez très fort, avec le morceau “Panik” ? Éric Débris : C’est marrant, parce que le morceau Panik a une histoire. Au départ, on n’avait que quelques titres, “Lady Coca-Cola”, “Snuff Movie”, et on débarque comme ça sans rendez-vous dans les bureaux de Malcom McLaren [manager des New York Dolls, puis des Sex Pistols, NDA]. On voulait essayer de voir avec lui si, quand les Sex Pistols tourneraient en France, on pouvait jouer avec eux. On lui fait écouter la démo, et il nous dit c’est bien, mais il n’y a pas de single. Du coup on en a fait un. Malcom McLaren aura au moins servi à ça… Rires…
Vous allez sortir votre deuxième 45 tours chez Rough Trade ?
Éric Débris : Notre manager de l’époque nous a trouvé un concert à Londres, au Roxy. À cette époque, notre maison de disques n’est plus très chaude pour nous suivre, elle vient de décider de mettre le paquet sur un groupe de Lyon qui s’appelle Factory.
En arrivant à Londres, on est allé en taxi à la boutique Rough Trade. On arrive à l’accueil, on se présente, il y a un petit peu d’agitation, et l’on se retrouve avec tout le staff de Rough Trade, sauf Geoff Travis qui était aux États-Unis.
“– On est venu vous voir parce qu’on sait que vous vendez nos disques…
Qu’est-ce que vous faites ?
On est là pour faire un concert… On avait une cassette démo et ils nous disent : c’est super, on veut le sortir. On leur répond que c’est juste une démo et que l’on veut faire un vrai disque.
Pas de problème, on va booker un studio, on en train de monter un nouveau label on vous signe. Vous n’avez pas de camions pour votre concert ? On va vous prêter le nôtre, Ross va aller chercher votre matos à la gare et il va s’occuper de vous.”
On va jouer au Roxy, puis le lendemain au Vortex, avec Slaughter and the Dogs, les Spizz quelque chose, avant qu’ils ne deviennent Spizzenergy, et dans la nuit on va partir vers un petit bled à côté de Brighton, où l’on va enregistrer le 45 tours.
Donc les morceaux “Paris-maquis”, et “Clé de contact” en face B ?
Éric Débris : Oui, et là, pendant le studio, on voit Geoff Travis arriver, il venait d’apprendre que ses petits camarades de jeu avaient signé un groupe. Ça c’est le côté rigolo de l’affaire.
Vous sortez 10.000 exemplaires d’un coup ?
Éric Débris : Oui, parce que ça coûtait moins cher d’en sortir 10.000 que 5.000. Ça a été pressé en Irlande, un truc complètement dingue, parce qu’il n’y avait plus un banc de pressage libre en Angleterre… À l’époque, Paul McCartney fait un carton avec “Mull of Kintyre”, et toutes les boîtes qui pressent des 45 tours font du Paul McCartney. Les mecs de Rough Trade vont trouver un plan pressage en Irlande, qui a un procédé d’impression étrange, il n’y a pas d’étiquettes sur le rond central mais une sérigraphie. D’où cette espèce de blanc laiteux un peu bizarre, que je n’ai jamais revue ailleurs. Les 10.000 exemplaires se sont vendus en l’espace d’un mois.
Qui réalisait le design des pochettes ?
Éric Débris : C’était moi. “Paris Maquis”, où l’on fait rentrer la tour Eiffel à l’envers dans le logo… C’est moi qui faisais les pochettes depuis le début. Celle du 45 tours “Panik”, est cosignée avec Clode Panik, c’est moi qui ai conçu le logo. À partir de “Paris Maquis”, on décide de n’avoir plus que des pochettes purement graphiques, de ne plus montrer des photos du groupe. On pense que sur la première, ce n’était pas nécessaire d’avoir des photos, qu’il valait mieux avoir un truc intemporel.
Beaucoup de groupes de l’époque ont ce souci de l’image ?
Éric Débris : Oui, parce qu’il y a beaucoup de gens, soit dans les groupes soit autour, qui viennent des arts graphiques. C’est un mouvement qui est très visuel, jusque dans les fringues.
On est donc en 1977, pour la sortie de “Paris Maquis” ?
Éric Débris : On va faire des allers-retours entre la France et l’Angleterre pour jouer… Et ça, c’est tout Métal Urbain : on n’a pas de management, on a une maison de disques en Angleterre, mais plus rien en France, on n’a pas de fric, et l’on se retrouve, après un concert au 100 Club, avec une proposition de résidence tous les 15 jours de la part du promoteur du club. Le seul groupe punk qui avait eu une résidence là-bas, c’était les Sex Pistols. Sauf que notre maison de disques nous dit qu’elle n’a pas les moyens de nous maintenir à Londres pendant tout ce temps-là, et qu’il faut rentrer en France… On va enregistrer notre troisième single, “Hystérie Connective” et “Pop Poubelle”… On a deux propositions, une de Rough Trade, et une de Radar. Radar est une boîte qui vient de se monter, ils viennent de signer Elvis Costello, les Inmates, c’est un label indépendant, avec beaucoup de fric derrière. Finalement, on bosse avec les deux, mais c’est un peu le bordel, on ne sait pas du tout qui s’occupe de quoi. Au moment où le disque sort, en 1978, Radar s’embrouille avec le financier qui est derrière, Warner. En fait, Warner essayait de couler Radar pour récupérer Elvis Costello. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’Elvis Costello, comme nous, comme d’autres gens chez Radar, n’avait pas de contrat. Et, alors qu’il y avait des commandes d’import en France, Warner refuse de represser le disque.
1978, la fin est proche…
Éric Débris : La fin est proche, parce que Warner refuse de ressortir notre disque, tout part en couille. On fait un concert catastrophique à l’Olympia, on joue beaucoup plus tard que prévu, donc on boit plus, et sur scène, on n’est plus du tout étanche… Je renverse de la flotte sur le matos, du coup on a des problèmes techniques… À l’époque, on n’a pas du tout de management, personne pour nous encadrer, on est vraiment orphelin… On n’a pas de maison de disques en France, donc c’est dur d’avoir des retombées sur ce qu’on fait. Notre disque n’est pas disponible, à part en import… En France, on est considéré comme un groupe qui s’est expatrié, et qui fait de la musique pour le marché anglo-saxon. Et les journaux ne veulent pas parler de nous, parce qu’on n’a pas de maison de disques, qu’on est un produit pour l’export, des trucs au-delà du réel !
À quel moment décidez-vous d’arrêter ?
Éric Débris : Dans la foulée d’une série de concerts qu’on organise en décembre 78, pour fêter les deux ans du groupe. On fait ça au Gibus, où l’on est un peu devenu des vedettes locales. On négocie une entrée gratuite pour le soir de l’anniversaire, avec des invitations qu’on imprime à des quantités astronomiques… Le deuxième soir, Clode Panik annonce après le concert qu’il arrête. On va essayer de sauver l’histoire. Je pars à Londres pour tenter de négocier avec Rough Trade un budget pour enregistrer l’album. Panik est éventuellement d’accord pour enregistrer l’album si on a le blé pour le faire, et quitter le groupe après une tournée de promo. Mais je n’arrive pas à décrocher les budgets, et donc ça s’arrête là. Enfin, ça s’arrête… J’avais déjà négocié un concert pour jouer le 31 décembre au Rose Bonbon, je rentre de Londres juste après noël, et avec Hermann et Pat, on décide de faire le concert quand même, à trois. Je passe au chant, et l’on fait un set très court, on joue les nouveaux morceaux qu’on était en train de bosser. On fait cinq nouveaux morceaux, dont “Colt 45” qu’on retrouvera après. C’est le dernier concert de Métal Urbain.
Ensuite sort la fameuse lettre de Clode Panik où il exprime son dégoût…
Éric Débris : C’est vrai que ça fait deux ans qu’on se bat face à des gens qui n’en ont rien à foutre de notre gueule…
Étiez-vous un groupe politique ?
Éric Débris : Le seul fait de sortir dans la rue c’est de la politique. Quand tu vis, et que tu ne te contentes pas d’exister c’est politique. Si tu existes, tu te lèves le matin tu vas bosser, tu rentres le soir, tu vas voter une ou deux fois par an, et tu meurs une fois que tu as touché ta retraite. Mais quand tu vis, ta vie tu essayes de l’inventer, donc du coup tu ouvres les yeux, les oreilles, et puis ta gueule… On est politiques, mais surtout pas politiquement corrects. On est très, très, incorrects…