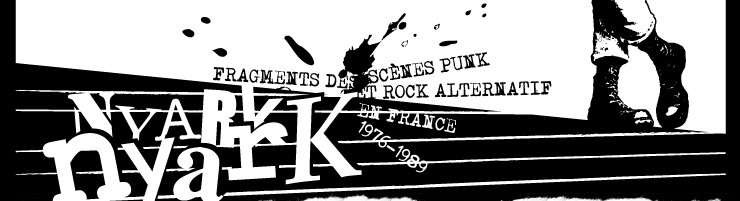Quel est l’état de la scène sur Montpellier en 1977 ?
Quel est l’état de la scène sur Montpellier en 1977 ?
Spi : C’était le néant. Comme Lennon le disait “avant Elvis Presley c’était le néant”. Il avait tort, mais à Montpellier il y avait vraiment le néant. C’était une ville de droite, encroûtée. Il n’y avait pas de scène pour se produire, à part un vague cinéma, un kiosque, le “Pavillon Populaire”, à chaque fois qu’on demandait la salle, elle était toujours en réparation… Au niveau des groupes, c’était la même chose que partout en France, des groupes qui faisaient du copiage d’anglais, qui essayaient de refaire ce que faisaient leurs idoles. Au début, avec O.T.H. je chantais en anglais, en yaourt, je n’écoutais que des trucs en anglais, ça ne me venait même pas à l’idée de chanter en français. C’est venu au fur à mesure, avec des conseils et des directives de nos deux premiers managers : Bernard et Alain Voyer.
Quel est le déclic qui vous a fait partir vers le punk ?
Spi : Nous nos influences étaient pré-punks. Cela allait du rock glamour (genre Gary Glitter), à Status Quo, aux Stooges, aux Doors et à la musique noire en général : blues, rythm’n’blues, funk. On s’est formé en 1976, mais ça n’a aucun rapport avec les Sex Pistols, c’était dans l’air du temps, une conjoncture morale, sociale, l’aboutissement de mai 68. Mai 68 a été fondamental, une vraie révolution, pas un simple remplacement d’un pouvoir par un autre. Avant 68, le monde est en noir et blanc, après on passe à la couleur avec du bon et du mauvais, mais avec un vrai droit d’existence pour la jeunesse. Avant 68, la jeunesse c’était des espèces de bébés robots dans une boîte à conditionner qu’on appelle famille, école, caserne, qui s’apprêtait à rentrer dans la vie active pour être militaire, bourgeois ou prolo… Mai 68 n’aurait peut-être pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le rock’n’roll, ou alors ça aurait été mai 78 ou mai 88.
Vous êtes des amis d’enfance ?
Spi : Mon parcours est un peu différent de celui de mes comparses. Eux sont des copains d’enfance, ils sont un peu moins âgés que moi. J’habitais dans un immeuble juste à côté du leur, mais ça, je ne le savais pas. Je suis parti de chez moi à 18 ans, pour faire la route, faire la manche pour essayer de trouver un groupe. J’ai fait ça trois-quatre mois, mon idée fixe c’était vraiment de monter un groupe, je n’ai trouvé personne, et je suis retourné à Montpellier. Un jour, je rentre dans un magasin de disques, et je vois une annonce “groupe cherche musiciens” et l’adresse, c’était la mienne, le même immeuble que moi, l’escalier d’à côté. Ce mec c’était un ancien du rock sur la ville, Éric Carméni. Il n’avait plus de groupe, et il s’était dit : “je vais prendre les jeunes de l’immeuble d’à côté, et je vais les driver”. Le groupe s’appelait “Bubblewind Band” je crois, enfin je ne sais plus très bien. Je suis allé le voir en lui disant que je jouais de l’harmonica. Il m’a dit : “ok, pas de problème”, je suis allé à une répète, et je suis tombé sur les autres, “les jeunes”. À part Éric Carméni au chant et à la guitare, il y avait déjà Beub à la batterie, Motch à la guitare, Pépone à la basse. Ils m’ont d’ailleurs regardé d’un sale œil avec mon harmonica, ce n’était pas du tout dans leur esprit. Eux, leur influence c’était Status Quo. J’ai réussi à passer le cap de la première répète sans me faire jeter, et j’ai réussi à me faire admettre avec mon harmonica.
J’ai commencé à pousser des gueulantes dans le micro, et je me suis rendu compte qu’il y avait une fureur qui se dégageait de ma voix, je n’arrivais pas à chanter mélodiquement, j’hurlais…
Comment en arrivez-vous à la création d’O.T.H. ?
Spi : Six mois après, Éric le chanteur-guitariste nous a largué pour monter un autre groupe, et on s’est retrouvé dans le local à se demander : “qui va chanter maintenant ?” Tout le monde s’est retourné vers moi. J’ai commencé à pousser des gueulantes dans le micro, et je me suis rendu compte qu’il y avait une fureur qui se dégageait de ma voix, je n’arrivais pas à chanter mélodiquement, j’hurlais… Les autres me demandaient de chanter normalement, je n’y arrivais pas, dès que j’ouvrais la bouche, c’était la rage qui sortait. C’était explosif, il y avait 18 années de frustrations contenues à libérer. Et l’on avait tous cette rage. C’était obsessionnel, on répétait du lundi au dimanche inclus. Cette phase a duré trois ans. Un jour, le bassiste nous dit : “je ne peux pas venir, je vais faire du cheval”. Pour nous ça a été un choc incroyable, on s’est dit ce n’est pas possible, et on l’a viré. Alors il y a eu la rencontre avec Domi à la guitare et Phil à la basse, le groupe est devenu OTH, la formation était complète.
Ce que vous jouiez c’était déjà les prémices d’O.T.H. ? Spi : On a toujours fait des compos. Quand quelqu’un trouvait une idée, un riff, c’était le tribunal, tout le monde devait dire s’il l’avait déjà entendu, ou si ça lui rappelait quelque chose. Si c’était le cas, on virait l’idée et on continuait à chercher.
Pendant cette période, vous faisiez beaucoup de concerts ?
Spi : Non, pas trop. En fait les concerts c’était tous les soirs au local. Le local était devenu une sorte de club déglingué, glauque. Tous les jours il y avait toujours quatre, cinq personnes et le samedi entre 10 et 20. Après on a eu quelques dates plus ou moins péraves, le podium Midi Libre sur la place de la Comédie, on jouait n’importe où. Jamais on ne s’est dit : “on ne va pas jouer là parce que c’est un truc minable”, tout était bon à prendre. C’était la guerre totale. La solution finale… C’est la meilleure définition de ce que l’on ressentait à l’époque, on était la solution finale à tous nos problèmes. O.T.H. a été connu sur le tard, pendant huit ans on a tourné partout… Le plus souvent pour rien. On gagnait moins que ce que l’on dépensait pour aller jouer. Pour tourner c’était simple. On avait besoin de 1.500 balles pour faire un concert, c’était intérim, magouilles, pour pouvoir payer le déplacement. Le premier album est arrivé en 84 le deuxième en 86, on commençait à peser mais on n’en vivait pas. Un jour, huit ans après, en revenant d’un concert, il nous restait 10 sacs en poches. C’était la première fois ! C’est à cette époque qu’on a rencontré Etienne Imer qui est devenu notre manager. Il a été un élément très décisif à l’épanouissement du groupe parce qu’il était vraiment très fin stratège, très déterminé, travailleur, et surtout il nous a apporté une grande confiance en nous. Il y croyait, plus que nous peut-être ! Et l’on sait ce que la foi peut faire… C’est à peu près à cette même époque que j’ai lu un article intéressant dans Spliff, un fanzine de Clermont-Ferrand. Un journaliste avait écrit ce truc très court : “de plus en plus de gens aiment O.T.H., et vice versa”. Ce mec avait parfaitement observé et compris ce qui était en train de se passer entre nous et le public. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on commençait à plaire. C’est là qu’on s’est dit, les gens aiment ce qu’on fait, il faut qu’on le leur rende, que par-dessus tout on les respecte… Au départ on n’était pas monté sur scène pour aimer, ou pour être aimé, mais désormais tout devenait différent… Cette reconnaissance du public nous a rendus plus mordants, plus déterminés, plus humains. Jusqu’à la tournée “Rock en France”, qui a été pour nous comme une explosion, la consécration… Il y a eu un déclic dans la tête des gens, c’était comme les états généraux de la France rock’n’rollienne. Un de nos meilleurs souvenirs. Nous, on n’était pas radicaux dans nos propos, dans le sens : “les fachos sont méchants et les anars gentils”. Ça nous a beaucoup été reproché. Ce qui a un peu déclenché les choses, c’est une photo. Nous on voyait des groupes anglais avec des drapeaux anglais sur des affiches, on s’est dit on va affirmer notre côté français, et on a peint nos guitares en bleu blanc rouge. Là, je crois que l’on a fait une grosse erreur marketing… Rires… Ça n’a pas duré longtemps, mais la photo est parue plein de fois… C’est à partir de ce moment-là, comme nos paroles n’étaient pas franchement radicales qu’elles ont pu être détournées… Tu vois, tout peut être interprété de manière erronée. Si tu ne dis pas clairement : je suis contre le fascisme, on peut vite détourner ce que tu racontes. L’ennui c’est que pour moi, ce discours-là ne fait pas partie de la musique, c’est du discours politique. La musique est là pour exprimer autre chose, des choses inexprimables. C’est tout l’intérêt de la chose, sinon autant monter un parti plutôt qu’un groupe.
 Peut-être parce que vous n’aviez pas de texte radicalement antifasciste ?
Peut-être parce que vous n’aviez pas de texte radicalement antifasciste ?
Lô Malfois : On peut le schématiser un peu comme ça… Et vous n’aviez pas peur du show-bizz non plus… Spi : On nous aurait proposé de signer chez C.B.S., on aurait foncé, alors que les autres groupes alternatifs affirmaient vouloir rester indépendants. Je suis convaincu que si ma vie a changé avec le rock’n’roll, c’est grâce, certains diront à cause, grâce à des majors et des labels qui ont eu suffisamment de pouvoir pour enregistrer, supporter des albums et les diffuser dans le monde, un petit label n’aurait jamais pu. Je n’aurais jamais pu découvrir les Doors s’ils avaient été signés sur un label équivalent à celui de Marsu, je n’aurais jamais découvert ce groupe qui a changé ma vie. Et nous, pourquoi se serait on privé de ça ? De toute façon, ils n’ont pas voulu de nous !!! Rires… Et à juste titre je pense… Il n’y avait aucune raison qu’un gros label… Lô Malfois : Trop incontrôlable, trop chaotique, c’était le chaos permanent… Même maintenant… Tu ne peux pas rationaliser, ce n’est pas possible. Dès que tu essayes de faire ça, ça ne fonctionne pas… Pour tout… Certains ont essayé, ils sont fatigués maintenant… Rires… Spi : Dans O.T.H. il y a des gens qui sont très animaux, j’aime cette qualité, mais tout peut basculer d’un moment à l’autre. J’ai des scènes en tête, des loges en miettes ou des hôtels malmenés. Pas des trucs de petites frappes, mais des trucs d’impulsifs… Je vais t’en citer un… On était dans un hôtel en Bretagne après un concert, on n’arrivait pas à dormir, on était tous un peu bourrés à discuter sur le palier de nos chambres, on buvait encore et le batteur est allé pisser. Je discutais avec Motch, le guitariste, et là je ne sais pas pourquoi, il se retourne et balance un grand coup de pied, de toutes ses forces, dans la porte des W.C. qui était ouverte au moment pile où Beub, le batteur, ayant fini de pisser, était en train de sortir du chiotte à quatre pattes, avec son verre à la main… J’ai entendu le verre tomber en premier, et lui en second. Il se tenait la tête, il était en sang, et le bassiste devenait fou furieux en hurlant : “j’ai horreur du sang !!”, et en cognant de toutes ses forces dans toutes les portes, tout ça à trois heures du matin. En deux secondes, je ne sais pas pourquoi, alors qu’on était cool, d’un seul coup c’était parti… Ce n’était pas de l’exibitionnisme, c’était animal…
Trop incontrôlable, trop chaotique, c’était le chaos permanent…
Votre premier enregistrement, c’est “Classé X “ ?
Spi : Je ne me rappelle plus trop bien quand c’est sorti, je crois en 1981, tiré à 200 exemplaires. Ça ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, c’était très rapide, on n’avait pas le budget, le son ne nous plaisait pas forcément.
“Musique Atteinte”, vous l’avez enregistré suite au “rock Odéon” ?
Spi : Oui, c’était un tremplin, on avait terminé deuxième et les trois premiers avaient droit à un enregistrement. Là, c’était produit par l’Odéon et le Studio Village qui nous avait repérés, et qui s’étaient dit que c’était le moyen de nous faire enregistrer un truc sans qu’ils ne le payent. C’était un 45 tours. Ils étaient sûrs que l’on allait finir dans les trois premiers.
 Art Trafic c’était votre label ?
Art Trafic c’était votre label ?
Spi : On avait un manager Alain Voyer qui était un ancien syndicaliste, et c’est lui qui nous a dit : “je veux bien vous manager à condition que vous chantiez en français”. C’était avant tous les albums. C’est lui qui a créé “Trafic d’Art”, j’aimais bien ce nom parce que Rimbaud, mon idole, avait fini sa vie en faisant du trafic d’armes. Le manager suivant, Etienne Imer l’avait transformé ensuite en “Art Trafic”.
Quelle était l’idée du label ? C’était pour O.T.H. ?
Spi : Je ne sais pas pourquoi on a fait ce label, peut être pour avoir une structure, pour être autonomes et pouvoir sortir nos disques. On essayait de contrôler un peu notre vie. “Sur des charbons ardents” c’était une co-production Art trafic et Studio de la Loge qui était sortie sous le label Kronchtadt Tapes. Lô Malfois : Je les avais rencontrés en 1982 sur un festival, j’avais pris une grosse claque, et comme j’étais déjà un peu actif, j’avais un magasin de disques et je vendais leurs cassettes. Peu après ils sont venus jouer à Saint-Étienne, et, comme il y avait un fan automatiquementil y avait plus de fans. Ensuite on a fait “Cœur et Cuir“, un concert filmé, j’avais fait des pieds et des mains auprès d’eux pour pouvoir sortir cette cassette. Spi : Il y a trois villes importantes en France pour O.T.H., Besançon, notre premier carton. À l’époque on faisait tout dans l’organisation de concert, avec des copains, et un jour on donnait des tracts dans les rues de Besançon. Il y a deux rockers qui commencent presque à nous chercher des embrouilles, “qu’est ce que t’as dans ton tract ?”, et il commence à bouffer le tract. On leur dit que c’est pour un concert d’O.T.H. Le mec ressort le tract de sa bouche, il le lit, “oh merde, génial, c’est quand !!!”… Rires… Les deux autres villes c’était Saint-Étienne et Toulouse. Toulouse c’était explosif, explosif… Le chaos total. Une espèce d’énergie, et en même temps un public très jeune, plus énergique plus lumineux… Même si tous les gens de Toulouse ne sont pas lumineux !
 En 1984 vous sortez “Réussite”, ça en a été une ?
En 1984 vous sortez “Réussite”, ça en a été une ?
Spi : Oui, c’était clair et net, nous on avait déjà réussi notre aventure, qu’on ait été aimé ou pas, que l’on ait vendu ou pas. On avait passé trois années à jouer de la musique, à réveiller la ville. Et on sentait bien qu’on était indestructibles. L’album Réussite a été enregistré dans le studio Village, un gros studio, mais on n’était pas très en phase avec eux. Puis on a rencontré Rémi Ponsard, et là on a été en phase ! On a enregistré “Sur des charbons ardents” dans son studio, à Montpellier, au studio de la Loge. Là, c’était des sessions de pur rock’n’roll, la guitare il adorait ça Rémi !
1986 c’est le boom du rock alternatif…
Spi : Nous, on était un groupe de province… Province, qui étymologiquement veut dire “pays vaincu”… Lô Malfois : On peut dire que tous les groupes de province en ont bavé, à part quelques exceptions. Disons que tu peux avoir une scène locale, mais celle de Paris, elle fait la pensée pour tout le reste. Les groupes de province, ce sont des stars locales, les groupes de Paris aussi, mais par rebonds, ils ont une aura nationale… Il n’y a quasiment aucune exception.
Vous vous retrouvez dans le message de la scène alternative ?
Spi : Pas des masses, on avait notre message à nous et des affinités, bien sûr avec ce mouvement… Mais on a toujours été des francs-tireurs… Nous on est vraiment des fumistes côté politique, c’est pour ça que nos textes ont prêté à confusion, ils n’étaient pas politiques. Ils étaient intérieurs, viscéraux, ils exploraient l’ange et le démon dans l’homme, intimement liés. Lô Malfois : Si j’ai toujours été fan et que j’ai signé tout de suite, c’est justement parce que les textes étaient politiques, ou post-politiques… Ça dépassait la politique. Spi : Dans le rock alternatif il y avait une ligne un cadrage. Lô Malfois : La ligne Béru, Bondage, était la ligne officielle de l’alternatif. Spi : Mais je dois avouer que les Bérus ne nous ont jamais snobés, d’ailleurs un des premiers bons concerts que l’on a faits à Paris, c’était grâce à eux. On les avait rencontrés par hasard à Pigalle au New Moon, et ils nous ont proposé de faire leur première partie. On arrive dans cette banlieue glauque, il y avait une grande scène en béton… Ce concert a été foudroyant au niveau du public : le pogo, l’énergie, un public très humain contrairement à ce que l’on pensait avant de débarquer. À la fin du concert, comme on n’avait pas un rond pour rentrer sur Montpellier, les Béru nous ont filé tout ce qu’ils avaient gagné, ils faisaient des entrées à presque rien (ils bossaient à côté)… En fait il leur restait mille balles et ils nous les ont filés pour que l’on puisse mettre de l’essence et rentrer à Montpellier. Je tenais à citer ce geste de leur part, qui nous avait beaucoup touchés !
 En 1988 sort l’album “Sauvagerie” :
En 1988 sort l’album “Sauvagerie” :
Spi : Je n’aime pas cette période-là, cet album-là, c’est un peu un tournant.La puissance des albums précédents c’était la puissance des quatre années de répète où l’on a composé des tonnes de choses, jeté des tonnes de choses. Il en était resté les morceaux du premier et du deuxième album. Par la suite, on n’a pas eu l’occasion de répéter aussi intensément. Pour celui-là, on a répété un mois avant, et on a enregistré cet album avec ses hauts et ses bas. Je ne l’aime pas trop, pour moi l’aventure était terminée au niveau créativité… Lô Malfois : Par contre sur scène ça commence à devenir très sérieux… Quand tu vois les images de concert en 1984 à Saint-Étienne et celles de 1988, tu vois qu’il y a plus l’habitude des grosses scènes, des gros éclairages. Spi : Sauvagerie avait coûté huit patates à l’époque, et en écoutant le live pirate qu’on a fait peu après, on est tombés sur le cul de voir tellement il était plus percutant, plus chaud, plus vrai, et en plus il nous avait coûté zéro centime. Le live a été enregistré pendant une tournée en Bretagne. On était parti avec la sono de Fred de Fa music, une boîte de Lyon, qui a été un partenaire important pour nous. On était parti avec tout le matos, on faisait tout… On arrivait sur le lieu d’un concert, on montait la sono, on jouait, on démontait la sono, et pour finir on faisait la fiesta. Un dimanche soir, on s’est retrouvé à jouer dans un petit bar, le Barracuda. Tous les soirs on enregistrait le concert, et ce soir-là, on n’avait plus de cassette vierge. Le patron du bar nous a donné la cassette démo d’un groupe (il en recevait des tas), et c’est cette cassette-là qui nous a servi pour ce live, ça ne nous a vraiment pas coûté un centime ! C’était une cassette orange, même pas une TDK, une cassette de bazar… Fred, le patron de Fa Music nous a rappelés après la tournée : “écoutez cette cassette, ça sonne, il y a un truc…”. C’était pérave, le mix était bizarre. Autant on pouvait trouver ça déglingué, autant ça pouvaitpasser pour quelque chose d’osé… À l’époque, pour les artistes Français, les mix étaient un peu plats, timides, pas comme les Anglais. On l’a faite écouter à New Rose, on était encore chez eux à l’époque, on voulait sortir une cassette pirate. Et là New Rose nous rappelle pour nous dire : “stop, vous sortez un vinyle live officiel et c’est pas la peine de péter plus haut que votre cul avec un album à huit patates pour vous ramener avec une cassette qui est dix fois mieux que ce que vous avez fait avant !!!”. C’était vrai. L’album est froid, le studio était froid, le mec qui enregistrait était froid, glacial, il ne jurait que par les stars anglaises qu’il enregistrait, c’était une autre planète… Mais cette cassette, c’était du concentré de chaleur humaine, elle dégoulinait de sueur !
On.Tenter.Hooks. ?
Spi : Il fallait trouver un nom, au départ on chantait en anglais, on a regardé dans le dico et c’est le batteur qui a trouvé cette expression, “Sur des charbons ardents”, On Tenter Hooks. Sur scène c’était un peu ça, le brasier… J’ai quelques anecdotes, on a fait la première partie de Baron Rouge un groupe de métal basque, on s’est retrouvé dans une salle de 3.000 personnes, c’était tellement survolté que c’était presque palpable… On jouait une reprise des Dead Kennedys, “Too Drunk To Fuck”, on était tellement survoltés à sauter partout que la scène s’est écroulée, tout s’est effondré. Je me suis retrouvé en équilibre sur une poutre… Et on n’a pas arrêté de jouer. Il y avait des gens qui soutenaient la scène et les organisateurs ont trouvé des poutres, et ont refait la scène pendant que nous on jouait… Ce soir-là, on a eu plus de succès que le groupe vedette. On Tenter Hooks… Le brasier…