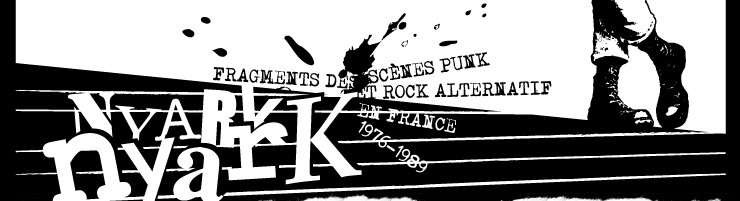Les Thugs, ça démarre en 1983 ?
Éric Sourice : Le groupe s’est formé en 1983 des cendres de différents groupes angevins, tels que Dazibao, Stress. C’est à la base une bande de copains, deux frangins d’abord, Christophe et moi. Christophe à la batterie, moi guitare-chant et deux copains Gérald et Thierry. En 1977 on avait tous 17 ans, sauf Christophe qui en avait 16. On était tous, à la base des fans de musique. On achetait de la musique tout le temps, du disque, du disque…
Vous en trouviez à Angers ?
Éric Sourice : Bonne question. Oui, on trouvait le premier 45 tours des Sex Pistols par exemple. C’était un petit disquaire qui n’était pas branché sur ces trucs-là, mais à qui l’on demandait de commander, donc on trouvait. Ce n’était pas obligatoirement facile, on ne trouvait pas tout, mais à cette époque-là, que ce soit les Damned, les Sex Pistols ou les Clash, tout ça se trouvait en province, c’était quand même de la grosse distribution, des majors. C’était plus difficile pour du disque français, les indépendants, les petits labels… Donc on montait sur Paris, chez New Rose, on trouvait d’autres trucs. On a toujours eu la chance d’avoir au moins un disquaire…
 Comment est ce qu’ en 77 tu découvres le punk ?
Comment est ce qu’ en 77 tu découvres le punk ?
Éric Sourice : En fait on écoutait déjà du rock, un peu comme tout le monde. On n’était pas branché sur les New York Dolls, parce qu’on ne connaissait pas encore, mais sur les Stooges, des trucs qui faisaient du bruit, un peu 60’s… J’étais branché également sur du planant allemand. On écoutait beaucoup de choses très différentes… Enfin surtout moi, peut-être moins Christophe. Donc on écoutait du rock, on achetait du disque, et il y avait un truc qui arrivait et qui correspondait à l’état d’esprit qu’on avait, le DIY. On est monté sur scène, c’est un peu la légende, on est monté sur scène et on ne savait pas jouer. Pour nous, un groupe, c’est un moyen d’expression, comme au lycée lorsqu’on faisait des journaux, qu’on appelait des journaux de contre-information. Au début c’était une expression, comme un journal de contre-info, comme la radio. On cherchait à foutre le bordel, c’est pour ça que le punk nous correspondait bien musicalement, parce que c’était une explosion sonore. Foutre le souk un peu partout avec les différents moyens qu’on pouvait prendre… Ça correspondait aussi totalement à notre état d’esprit, le côté un peu anar que pouvait véhiculer le mouvement punk. Donc 77, c’est le déclic. On commence à acheter une batterie, une guitare, notre premier groupe s’appelait IVG, on chantait en français. Mais on n’a jamais fait de concert.
Déjà la même équipe ? Éric Sourice : Oui, à part le bassiste. On a tous appris à jouer en même temps : un peu le classique du groupe punk. On se retrouvait dans un local, personne n’avait de notion musicale. J’avais fait six mois de conservatoire, mais j’avais six ans, je ne connaissais même pas le solfège, donc on a appris tous ensemble. On a commencé à faire quelques groupes de punk rock dont IVG, et après on se cherchait sur des trucs un peu plus new-wave… En 83, suite à différents changements de nom les Thugs arrivent, avec la volonté de faire notre truc, du punk rock.
La scène à Angers en 1983 c’était quoi ? Éric Sourice : C’était un désert. Qu’est-ce qu’il pouvait se passer à cette époque (fin 77-début 83) dans une ville moyenne ? pas grand-chose. Disons qu’en 1981-82 il y avait quelques groupes qui commençaient à répéter, à essayer de créer. On partait du degré zéro. Dans les années 70 il n’y avait pas de salles de concert, quasiment pas d’assos. Il y avait quelques petits concerts début 80, mais ils étaient organisés dans des salles qui n’étaient pas faites pour ça, la mairie dès qu’il y avait un siège cassé, te faisait un procès… C’était le désert. Évidemment, il y avait quelques groupes, mais on les comptait sur les doigts d’une main. Sauf qu’avec ce DIY qui arrivait, on pouvait monter des assos, faire des émissions radios, des fanzines, monter un magasin de disques, faire un label, monter un groupe. Nous, on a tout fait… On a essayé de se saisir des radios libres le plus rapidement possible. On a fait une émission pirate avec un pote, avec un petit émetteur qui devait porter à 50 mètres, ça devait être en 79-80. En 1981, on a participé à des vraies radios libres associatives avec plusieurs émissions dont une qui s’appelait “Black et noir” en 83/84. De cette émission naîtra une association et, plus tard, le magasin de disques. La radio était vraiment un vecteur très intéressant. On pouvait faire écouter à nos cinq ou six auditeurs du rock’n’roll, des trucs qu’ils n’avaient pas l’habitude d’entendre. Et l’on commençait à avoir des contacts, avec des groupes, des labels… C’est la toile d’araignée, on prenait des contacts, on s’interviewait, on se filait des coups de main sur nos villes respectives, on partageait nos expériences…
 On est en 83, débuts des Thugs, vous ne jouez que des compositions ?
Éric Sourice : Oui. Dans toute notre carrière, on a dû faire une dizaine de reprises. On ne savait pas jouer, donc on était incapables de faire des reprises. Et puis on voulait faire nos propres morceaux. On s’est fait un répertoire assez rapidement, et ensuite il y a eu des rencontres. Notamment par l’intermédiaire d’une copine qui faisait un fanzine, et qui était en contact avec des gens de Juvisy-sur-Orge qui allaient créer Gougnaf. Elle leur a filé une K7, une démo enregistrée en studio, ils ont trouvé ça super, et finalement on a fait le premier 45 tours avec eux. Super rencontre… Il faut bien saisir qu’à cette époque-là, entre Paris et la province il y avait un monde. Soite, Juvisy c’était la banlieue, mais nous retrouver là-bas, c’était un choc culturel… On tombait en banlieue parisienne avec le mouvement punk… Et on tombait chez des fous furieux, parce que Gougnaf c’étaient des fous furieux…
On est en 83, débuts des Thugs, vous ne jouez que des compositions ?
Éric Sourice : Oui. Dans toute notre carrière, on a dû faire une dizaine de reprises. On ne savait pas jouer, donc on était incapables de faire des reprises. Et puis on voulait faire nos propres morceaux. On s’est fait un répertoire assez rapidement, et ensuite il y a eu des rencontres. Notamment par l’intermédiaire d’une copine qui faisait un fanzine, et qui était en contact avec des gens de Juvisy-sur-Orge qui allaient créer Gougnaf. Elle leur a filé une K7, une démo enregistrée en studio, ils ont trouvé ça super, et finalement on a fait le premier 45 tours avec eux. Super rencontre… Il faut bien saisir qu’à cette époque-là, entre Paris et la province il y avait un monde. Soite, Juvisy c’était la banlieue, mais nous retrouver là-bas, c’était un choc culturel… On tombait en banlieue parisienne avec le mouvement punk… Et on tombait chez des fous furieux, parce que Gougnaf c’étaient des fous furieux…
Ça a été une des premières productions de Gougnaf ? Éric Sourice : Oui. Ils avaient commencé par des k7 (13ème Section), ils avaient ensuite sorti en vinyle le maxi “Ultraviolet” et on est la deuxième référence.
Vous l’enregistrez à Angers ?
Éric Sourice : Non, en banlieue parisienne par le biais de Gougnaf. Dans une cave avec “Godo” (Godefroy de Maupéou) qui avait enregistré “13ème section” et “l’Infanterie Sauvage” de Juvisy. Lui cheveux longs, il écoutait dans sa cave de la musique planante, et les mecs débarquaient pour faire du bruit… C’était vraiment super fun ! Ce 45 tours a déclenché énormément de choses… On l’a envoyé à l’étranger et ça a été notre premier contact avec “Vinyl Solution” en Angleterre. Ce label est tenu par deux français, Yves Guillemot, un ancien du Havre, et Alain De La Mata, un photographe. Ils ont trouvé ça super, et nous ont proposé de bosser ensemble, ce qui se fera quelques années plus tard. Des contacts aussi avec les gens de chez Closer, chez qui l’on fera le premier mini LP, et puis au niveau des médias, surtout des fanzines, avec des retours supers.
Pourquoi pas chez Gougnaf ?
Éric Sourice : À cette époque, les Gougnaf c’était vraiment le gros bordel. On a estimé qu’ils n’étaient pas capables de le sortir. Ils n’avaient pas de thunes, on se demandait comment ils allaient payer les pressages… En gros, on les sentait trop à l’arrache, ce qui a été une erreur stratégique grave, parce qu’après, quand ils ont sorti Parabellum, les Rats, les Sheriffs, c’était le même bordel. Donc c’était faisable. On est resté super pote avec eux. Christian qui était dans Gougnaf était notre manager, Christophe produisait certains de leurs disques, j’ai bossé avec eux quand ils sont venus sur Angers… Aujourd’hui je pense qu’on aurait pu rester chez Gougnaf plutôt que d’aller chez Closer. On s’est bien entendu avec eux, mais Gougnaf était plus dans notre état d’esprit. Radical Hystery sort fin 84, début 85. On l’a enregistré dans un studio qui n’était pas rock’n’roll, qui était plutôt un studio qui bossait dans la bande son de film. Du coup on nous a un peu laissé faire, et le résultat au niveau du son n’est pas extraordinaire…
Tu parlais des échos dans les fanzines, vous aviez un son atypique pour la scène française…
Éric Sourice : C’est lié à l’idée qu’on voulait tout contrôler et tout faire, dans la mesure du possible. On a toujours énormément travaillé le son. Le son de scène, et sur disque également. Christophe était vraiment branché là-dessus, il refusait les producteurs et voulait produire. Il le fera plus tard, avec les Rats, Parabellum, les Sheriffs. Il avait des idées très précises. Son idée, c’était cette espèce de bloc que tout pouvait faire ensemble, avec cette espèce de mur de guitares/basse/batterie, sur lequel surnageaient des voix. On voulait tout maîtriser et tout essayer.
Je trouve qu’il y avait une adéquation entre les disques et la scène, la puissance latente…
Éric Sourice : C’est ce qu’on voulait. Je suis content d’entendre des trucs comme ça. Comme à l’époque quand on entendait : “un 747 au décollage, un maelström sonore…”, alors qu’on n’était pas parmi les groupes les plus bruitistes. C’était plus ce “tous ensemble”, les deux guitares qui faisaient souvent la même chose, le bloc monolithique qui avance… Avec le côté pop qu’amenaient les mélodies de voix ou les gimmicks de guitare. Ça correspondait vraiment à ce qu’on était. L’envie de foutre le bordel… J’ai souvent comparé un concert à une manif. Tu as la même dose d’adrénaline, tu as envie que ça fasse bouger le monde. Cette volonté de se battre, de s’amuser ensemble… Ce qu’on voulait faire avec les Thugs, c’était ça.
 Il y a peu de références musicales à l’époque dans ce créneau ?
Il y a peu de références musicales à l’époque dans ce créneau ?
Éric Sourice : Nos références, au tout début, c’est les Nomads, les Dogs, les Pistols, la scène anglaise 77, les Hearthbreakers, New York Dolls, les Stooges. En même temps, ça n’y ressemble pas vraiment. On est au tout début du hard core. On va être à la croisée des chemins et l’on va se situer entre Buzzcocks pour le côté très simple, mélodique et simple, et Husker Dü pour le côté “mur du son”, les guitares à fond. En plus, on chantait en anglais. À cette époque, en 83, on peut dire que la France était divisée entre le punk qui chantait en français, essentiellement les parisiens, et le rock’n’roll qui chantait en anglais, la scène de province. Nous on était entre les deux… Le public était un peu décontenancé par ce qu’on faisait, sauf quand on a eu notre propre public. On ne répondait pas aux clichés du mouvement. On n’avait pas de poses, pas le côté festif… Du début à la fin du concert, j’allais dire trois mots, les morceaux allaient s’enchaîner… On nous l’a beaucoup reproché. Notre premier mini LP sort début 85 chez Closer. Il n’est pas accueilli de façon extraordinaire, mais on commençait à tourner beaucoup, en France, en Grèce, en Suisse. Ça se passait bien avec Closer mais ils ont eu des problèmes, ils n’ont d’ailleurs pas tardé à fermer, et l’on a recontacté Vinyl Solution. Chez eux on va sortir, sur plusieurs années “Electric troubles”, le maxi “Dirty White Race”, “Still Hungry”, “I.A.B.F.”. Ça a été une chance inimaginable d’avoir pu travailler avec des gens installés à Londres. Ça nous a permis d’avoir des licences partout dans le monde : en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ça nous a permis de tourner en Europe, aux États-Unis, de rencontrer notamment les gens de Subpop, le label de Nirvana, avec lequel on va travailler plus tard.
Peut-on dire que vous étiez un groupe politique ?
Éric Sourice : Oui, ouiouiouioui, oui et oui. On était un groupe très politisé. On n’a jamais été comme les Bérus proches des milieux d’extrême gauche, on n’a pas fait beaucoup de concerts de soutien. Mais on avait des choses à dire, et quasiment toutes nos paroles étaient d’inspiration politique, sociale. En 1995, on a sorti un album qui s’appelait “Strike”, en plein pendant les grèves… C’était un hasard et en même temps ça n’en était pas un. On a toujours parlé de ça, qu’on n’avait pas envie de travailler, de participer à une société capitaliste, néolibérale… En même temps on se méfiait énormément des slogans. On était dans une lutte des classes, mais on pensait que c’était trop facile de ne dire que ça. Tous les problèmes ont leur complexité et l’on ne pouvait pas les résumer en une phrase, un slogan. “La jeunesse emmerde le Front National”, soite, mais ce n’est pas aussi simple que ça. On s’est toujours un peu méfié des foules, des gens qui lèvent le poing, et qui, en même temps, d’ici trois ou quatre ans finiront par être des cadres dynamiques dans une entreprise. On a toujours eu ce côté un peu désabusé… Mais on était complètement dedans… Une manif c’est bien, on y va parce qu’on se dit que la révolution est peut être au bout, et en même temps on n’y croit pas une seule seconde… Ce qui ne nous empêche pas d’essayer, et d’y revenir la fois d’après… Et toujours… On ne voulait pas être des portes drapeaux. On s’est impliqué dans des trucs militants, mais au niveau musical on n’était pas évidents. Il fallait aller chercher la substantifique moelle. Je me souviens d’un titre du “Monde Diplomatique” : ”Informer fatigue”… Et nous c’était un peu ça. C’est aussi pour ça que l’on nous a proposé peu de concerts de soutien.
Tu arrêtes ta chronologie en 1989, ce n’est pas bête… C’est un moment-charnière, où, dans ce mouvement, on retrouve beaucoup de gens qui étaient rentrés parce qu’ils avaient vu de la lumière, et qui, quand ils ont vu qu’ils s’étaient plantés, sont allés voir ailleurs. C’est aussi le moment où beaucoup de groupes vont signer chez des majors. 89 c’est aussi le moment où commence à s’ouvrir en France ce qu’on va appeler plus tard le réseau Fédurock. 90 c’est le moment où tout bascule dans l’institutionnel, les majors signent du rock parce que ça a commencé à vendre… Ça devient difficile pour les groupes de jouer dans les bars…
C’est aussi une date charnière pour nous… Les premières tournées aux US.A., les premiers disques qui sortent là-bas, d’abord chez Subpop puis chez Alternative Tentacles. Le fait d’avoir une reconnaissance à l’étranger a fait qu’on a commencé à avoir beaucoup de monde aux concerts en France. “Il paraît que vous vendez plein de disques aux Etats-Unis -non, pas plein, au contraire…”. Dans l’esprit des gens, cette reconnaissance à l’étranger faisait que ça devait être bien…
À cette époque on s’amusait beaucoup. Il y avait des labels de tarés, notamment Gougnaf, Bondage… Il y avait un fourmillement, plein d’assos qui organisaient des concerts. Plus tard, on a joué dans des grandes salles, où l’on ne voyait pas forcément les organisateurs… Dans les années 80, il y avait une agitation, une envie de foutre le bordel et de s’amuser… Plus les labels, les fanzines… C’était un état d’esprit qui était totalement différent… Branlant, pas au point, pas pro, mais quand même 10.000 fois mieux que ce qu’on a pu voir après…