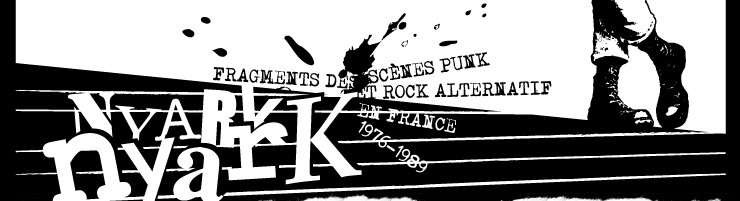On peut dater le départ des Cadavres à la fin des années 70 ?
On peut dater le départ des Cadavres à la fin des années 70 ?
Vérole : J’ai découvert le punk en 77, par le grand frère d‘un copain qui allait souvent à Londres. Il m’avait fait écouter des cassettes, notamment les Sex Pistols et New Rose des Damned. Jusque-là, je me foutais complètement de la musique. J’ai tout de suite plongé dedans. Mais c’est vrai qu’à l’époque il n’y avait rien… Pas de fanzines, que des journaux à la con… Par contre il y avait des disquaires. On découvrait forcément le punk par hasard, vu qu’il n’y avait rien… On a commencé en 79-80. Au départ, c’était un groupe à la petite semaine, on faisait des reprises, on répétait dans un garage en banlieue… On venait de plusieurs groupes, un groupe de banlieue qui s’appelait les Parias, et nous, les Cadavres. On a eu l’opportunité de piquer tout le matos, en un coup, dans une fête. C’est comme ça qu’a débuté le groupe. Au départ je voulais être gratteux, et j’ai finalement atterri au chant. Ça a commencé comme ça, toi tu vas être guitariste, toi batteur, on ne savait pas ce qu’on allait faire… C’était plus un plan pour le samedi après midi, tout le monde venait, apportait quelque chose, et on passait la journée à faire de la musique. On ne savait même pas qu’un jour on ferait un concert. On avait juste envie de faire quelque chose.
 Où est que cela se passe ?
Où est que cela se passe ?
Vérole : À Orsay, dans le 91. Par hasard, on avait deux potes qui habitaient là-bas, et on avait un garage pour jouer, ce qui est plus pratique qu’à Paris. Du coup, au début, on a beaucoup tourné en banlieue sud. Notre premier concert, c’était à la M.J.C. de Bures-sur-Yvette. Ensuite, on a joué au Gibus. On a vachement fait de plans M.J.C. de banlieue, surtout dans la vallée de Chevreuse… On jouait partout où on nous le proposait. Mais on a du mettre quatre ans avant de savoir jouer. Il y a deux périodes dans les Cadavres. Ce qu’on appelle “les anciens Cadavres”, c’est le groupe qui va de 79 à 83-84, et ensuite le groupe reprend en 86. Là, il n’y a plus que moi de la formation originale, je joue avec Manevy, Tougoudoum, Jérôme, et Cyril qui nous rejoint ensuite. Après le départ d’Éric, il sera remplacé par Bertrand à la batterie, c’est le groupe qui va jouer jusqu’en 1996. C’est cette formation qui a fait les disques, les concerts… Avec le premier groupe, à part un 45 tours et quelques concerts, on n’a pas fait grand-chose.
Pourquoi avoir choisi ce nom ?
Vérole : C’est vraiment trop vieux, je n’en sais rien… Je pense que c’est à cause des paroles. C’est moi qui écrivais les textes. Plutôt que de chercher la revendication sociale, comme les Clash, Sham 69, je suis plus parti sur des états d’âme, une envie d’écrire des choses plus personnelles. C’est vrai que les textes tournent beaucoup autour de la mort… Le suicide, l’hôpital, la déprime, l’alcool… On avait aussi tous des têtes de cadavres… On était palots, maigrichons… Quelques années plus tard, on s’est dit que ce n’était pas un nom forcément très fameux… Mais c’était fait… Ça ne dégage pas un truc joyeux, mais une idée de rupture avec l’existence. C’est aussi ce que l’on voulait. Je pense que les textes sont vachement importants pour un groupe. Trop de groupes les ont négligés…
Vous avez toujours chanté en français ?
Vérole : On était en France, notre public immédiat c’était des gens que l’on connaissait, pour se faire comprendre, il valait mieux chanter dans la langue du pays. Maintenant, si on avait été un groupe international et qu’on avait eu une tournée aux Etats-Unis, on aurait pu traduire tous les textes en anglais pour que les gens comprennent. Il y avait l’urgence, on avait des choses à dire, on les disait. Avec cette volonté d’avoir des textes à slogans. Si, dans une chanson, tu arrives à ce que les gens retiennent ne serait-ce qu’ une phrase, et qu’elle peut les faire réfléchir, tu te dis qu’au moins tu n’as pas prêché dans le désert. On avait des textes qui étaient des réactions, comme “No pasaran”, suite au score de l’extrême-droite aux présidentielles de 1988, des textes comme “7h23” qui parlaient du quotidien, d’autres qui exprimaient plutôt des angoisses… Les textes sont souvent des exutoires. Il m’était plutôt difficile de parler de problèmes que tu n’as pas vécu. Je me vois mal écrire sur la famine en Éthiopie, alors que je n’ai jamais connu la famine. On parlait de notre univers quotidien, de notre révolte dans ce monde, cette société. On lançait un message, mais en fait c’était surtout un S.O.S..
 Vous étiez un groupe politique ?
Vous étiez un groupe politique ?
Vérole : Si être politique c’est refuser le système dans lequel on est nés, on était un groupe politique. Si c’est être affilié à un groupe ou un parti politique, on ne l’était pas. C’est pour ça qu’on avait choisi comme symbole le triangle noir. Le triangle noir était celui des asociaux dans les camps de concentration… On ne voulait être affiliés à rien, sauf à nous-mêmes… On faisait de la politique parce qu’on luttait contre quelque chose qui nous oppressait, mais pas avec les moyens d’un parti politique. Si on s’était senti plus politique, on aurait pris le triangle rouge… Mais on était en réaction. “No pasaran”, je l’ai écrit juste après avoir entendu les résultats du premier tour des présidentielles en 88. Le Pen avait fait 14,38% … C’est un coup de sang, un réflexe immédiat. Là, tu as la plume facile. Il faut crever l’abcès, sinon demain ce n’est plus 14% , mais 24% . Aujourd’hui c’est encore pire, ça ne pourrait même plus s’appeler “No Pasaran”. Déjà, à l’époque, on disait “Chirac, Le Pen dans le même panier”. Depuis, il y a eu deux mandats de Chirac, et là, on a le sosie du borgne mais en pire… La version fasciste “tout public”. En prime il est moins vieux, donc il durera plus longtemps… Soyons unis pour le meilleur, parce que le pire reste à venir…
On ne voulait être affiliés à rien, sauf à nous-mêmes…
Vous enregistrez votre premier disque en 1982 ?
Vérole : C’était un maxi 45 tours autoproduit, avec le groupe Vatican en face B. On avait payé nous-mêmes le studio, une journée pour enregistrer les deux groupes. La pochette avait été faite par un pote qui n’y connaissait pas grand-chose… On en avait sorti 1.000, qu’on a tous vendus, puis de fil en aiguille quelque chose comme 3.500… Ce qui, pour un groupe sans promo, est plutôt bien. On avait un son pourri, comme la majorité des groupes français de l’époque. En France, on a une tradition de variété… On n’y peut rien, c’est comme ça. Il faut faire de la “Chanson FrançAIse”… Coller à une éthique définie par les médias. Tous les groupes, à l’époque, s’ils n’allaient pas enregistrer en Angleterre avaient un son pourri. Ensuite, avec la formation originale on a sorti un autre 45 tours, chez New Wave Records.
Comment se passe la rencontre ?
Vérole : Ce sont eux qui nous ont branchés, ils nous avaient vus en concert, et ils nous ont proposé d’enregistrer un 45 tours. Par la suite, le groupe s’est arrêté, à l’époque il y avait beaucoup de problèmes et pas de solution, et on a repris le groupe en 1986 avec des anciens membres de Charnier. Charnier, Cadavres, il y a un lien… Ils n’avaient plus de chanteur, et faisaient plein de reprises des Cadavres, on a décidé de reformer le groupe. Mais le nom n’était pas ce qui comptait le plus, c’était plutôt l’esprit qu’on voulait amener… On s’est remis à composer, moi à écrire des textes… Avec eux, on a enregistré un autre 45 tours sur le label Forbidden, et le premier album. Notre deuxième album, comme Forbidden n’existait plus, on l’a sorti chez Bondage. On a toujours été doué pour couler les labels. C’est à cette époque-là qu’on a tourné régulièrement.
Vous vous reformez en 86, en plein boum de l’alternatif ?
Vérole : Les Cadavres ont toujours été un groupe chiant à placer… On ne s’est jamais cassé la tête avec les étiquettes. Pour beaucoup de gens, l’alternatif ça correspondait à un état festif. Nous, on n’était pas festifs… Du tout… Après, il y avait les groupes anarchopunks, qui avaient vraiment une démarche politique affirmée. On n’était pas vraiment là-dedans, mais en même temps, on avait quand même des revendications. Un coup on était classé comme groupe alternatif, un coup street punk, un coup rock indépendant, radical… Au bout d’un moment on en a eu marre, on s’est créé notre propre étiquette, on a dit qu’on faisait du “ punk rock messin “. Au début, c’est parti d’une connerie, (on ne vient pas du tout de Metz), et ensuite on se revendiquait comme tel. On avait délimité le concept, avec nous il y avait les PKRK, les Rats, les Dileurs. En fait, l’idée de punk rock messin c’était un esprit qui se voulait plus proche de ce qui se faisait à la fin des années 70, mais avec le décalage d’âge, vu qu’on avait commencé plus tard que les autres.
Vous étiez sensible à la construction de l’alternatif/alternative ?
Vérole : Non, nous on ne construisait rien, on était dans la destruction… Dans la non gestion désastreuse d’une carrière de groupe, on est au top. On signait des contrats sans savoir ce qu’ils disaient, on faisait des concerts avec des cachets débiles… On était plutôt un club de vacances de cas sociaux qui faisaient de la musique… Rires… On n’a jamais essayé de s’adapter. On aurait pu essayer de coller à l’esprit de l’alternatif, à la tendance du moment mais on a continué à faire notre truc, sans s’occuper d’un monde qui tournait mal sans nous…
 Nous, on ne s’est jamais vraiment reconnu dans le rock alternatif. On faisait du punk rock. Un point c’est tout. L’idée c’était de faire quelque chose qui nous correspondait… Le terme ne me dérangeait pas, mais ça ne me parlait pas plus que ça.
Nous, on ne s’est jamais vraiment reconnu dans le rock alternatif. On faisait du punk rock. Un point c’est tout. L’idée c’était de faire quelque chose qui nous correspondait… Le terme ne me dérangeait pas, mais ça ne me parlait pas plus que ça.
L’idée c’était d’être contre ?
Vérole : Oui, on était tous là-dedans, on voulait tous créer quelque chose et proposer une contre-culture. L’idée c’était de revenir aux bases du rock, où tu mets tes tripes sur la table, et pas un produit pour faire plaisir à une boîte de disque. Après, que tu t’appelles alternatif, indépendant, peu importe… Le but c’était de ne pas ressembler à Téléphone. Pour moi c’était l’horreur, la synthèse absolue entre la variété soporifique française et des guitares. Un produit parfaitement marketé, un peu rebelle mais qui ne fait pas peur aux grands-mères… Le mouvement alternatif c’était l’antithèse de tout ça. Les gens repartaient sur des bases qu’ils s’étaient créés eux-mêmes. Faire de la musique sans se soucier de plaire à Pierre ou Paul, avec un état d’esprit franchement libertaire… Il faut aussi voir qu’en 1981, on sortait de 23 ans de droite…
Vous essayiez de construire un rapport fort avec votre public, notamment à travers “Basta”, votre feuille de choux ?
Vérole : Basta, c’était notre association. Ça servait de lien avec le public. Sur nos tables dans les concerts les gens laissaient leur nom, ils recevaient un petit fanzine, avec des cadeaux, on faisait gagner des places gratuites pour les concerts. Un lien avec le public, et aussi une asso pour gérer le quotidien du groupe. La force d’un groupe est dans son image, dans l’impact qu’il peut avoir, son concept. Nous on mettait dedans le rejet du monde dans lequel on était, notre angoisse d’exister, nos frustrations, et notre d’envie d’échapper à ce système qui rend quasiment tout impossible. On voulait aller chercher plus loin que la revendication politique ou syndicale… L’erreur d’exister. Le mal de vivre… On a essayé de faire passer ça avec un humour au troisième degré, un humour noir plutôt décapant. On a toujours fait des collages pour communiquer visuellement, dans une démarche un peu situationniste. Récupérer des images du monde dans lequel on vit, pour leur faire dire autre chose. Prendre une BD pour en détourner les dialogues. Mettre en rapport le cri de Munch, avec une tête de bébé biafrais, qui a un peu la même forme, pour dire aux gens : voila, c’est votre monde, maintenant, il faut faire avec. Si cela ne vous va pas alors il faut lutter… Sans quoi acceptez et taisez-vous. On voulait montrer un visuel qui nous était propre, mais qui faisait partie intégrante du monde dans lequel on vivait. On voulait détourner toutes les icônes, pour moi la Vierge Marie ou Mamie Nova, c’est la même chose. On ne proposait pas de modèle pour former une grande organisation, nous, on dénonçait pour que les gens pensent par eux-mêmes, et à partir de là rebondissent pour faire quelque chose, et créent leur propre univers. Comme une sorte de grande nébuleuse qui va se reproduire à l’infini. On n’était pas dans quelque chose de fédérateur.
 Vous avez joué pour les concerts d’adieu des Lucrate Milk et des Bérus ?
Vous avez joué pour les concerts d’adieu des Lucrate Milk et des Bérus ?
Vérole : Oui… Rires… Les Cadavres, les fossoyeurs… Tout ça, c’était un peu la même bande. Pour Lucrate, on avait joué avec Die Toten Hosen. On avait fait deux concerts dans la journée. Avec Die Toten Hosen au centre culturel allemand, et le soir à nouveau avec eux pour les Lucrate. Le concert d’adieu des Bérus, c’est un super souvenir. Il s’est passé un truc. En plus, pour nous c’était exceptionnel d’avoir joué à l’Olympia. Sur les mêmes planches que François Valery, Sylvie Vartan que de grands noms qui ont fait vomir notre enfance… Pour nous c’est un super souvenir. La fin des Bérus, c’est autre chose. Je ne suis pas nostalgique des fins. Tout a un début, tout a une fin, comme l’existence. Je pense que si les gens arrêtent, ils ont une bonne raison. La vie d’un groupe c’est comme une histoire d’amour. Donc il peut y avoir des tensions, et s’il doit arrêter, il faut qu’il le fasse. Quand on a arrêté en 1996, on ne s’entendait plus. Il y avait des tensions, des petits clans, on commençait à être cloisonné chacun dans notre truc. On ne jouait pas un rôle, mais presque, on devenait presque une parodie de nous-mêmes. Il fallait qu’on arrête, il n’y a pas à être nostalgique de ça. Mieux vaut stopper avant d’être pathétique. Je ne regrette rien de ce que l’on a fait, il ya eu des bons concerts, des mauvais, des trucs pas glorieux, d’autres vraiment mieux, c’est logique. Quand on a arrêté, il fallait qu’on le fasse. Et ce stupide monde a continué de tourner…