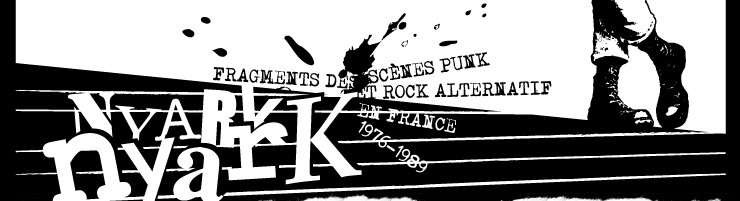À quelle époque faites-vous remonter les origines du groupe ?
Gilles : L’histoire du groupe, elle commence à Bron, une banlieue est de Lyon, pas la pire, mais un peu chaude quand même. On était trois, puis quatre gamins, à avoir grandi ensemble. Nos parents étaient instituteurs, dans la même école, et on vivait ensemble dans cette école. Elle était à la limite d’un quartier résidentiel avec des petites villas, et d’une ZUP, avec des grandes barres, le long de l’autoroute. On était, à l’école comme au collège, à mi-chemin entre ces deux mondes. À l’époque on écoutait des groupes comme AC/DC, Kiss, Trust, mais aussi Téléphone ou Renaud.
À quelle époque faites-vous remonter les origines du groupe ?
Gilles : L’histoire du groupe, elle commence à Bron, une banlieue est de Lyon, pas la pire, mais un peu chaude quand même. On était trois, puis quatre gamins, à avoir grandi ensemble. Nos parents étaient instituteurs, dans la même école, et on vivait ensemble dans cette école. Elle était à la limite d’un quartier résidentiel avec des petites villas, et d’une ZUP, avec des grandes barres, le long de l’autoroute. On était, à l’école comme au collège, à mi-chemin entre ces deux mondes. À l’époque on écoutait des groupes comme AC/DC, Kiss, Trust, mais aussi Téléphone ou Renaud.
Là, on est fin 70 ?
Gilles : Oui, on va vraiment commencer à faire un “groupe” en 1981. En 80, un mec nous a fait découvrir les Sex Pistols puis les Clash. Et là, en deux-trois mois, on a viré nos fringues de gamins de banlieue, on s’est coupé les cheveux, on a commencé à se faire des tee-shirts en écrivant des trucs dessus… On était devenus “punks”. À 15 ans, comme il n’y avait pas de lycée dans ma banlieue, je me suis retrouvé parachuté dans un lycée de bourges dans Lyon. Là, ça a été le gros choc. Tous ceux qui venaient de banlieue se retrouvaient à être les parias. De la part des profs, des gens qui dirigeaient le lycée, tout le monde nous considérait comme les rebuts qui venaient faire chier dans le beau lycée…
Laurent : Moi, je venais plutôt des classes moyennes inférieures, et on s’est retrouvé dans le même lycée, dans un quartier très bourgeois… Quand tu commences à écouter du punk rock, les Clash, Crass, et que tu lis les paroles, là, ça te parle, parce que tu te retrouves toi-même dans une situation où tu es confronté à un monde bourgeois, réactionnaire, catho… Alors que nos parents étaient à l’usine, sans schématiser, il y avait directement une différence de classe sociale qu’on a pris dans la gueule… Et du coup, on devait s’affirmer direct… “OK, on n’est pas comme vous, mais on va assumer à fond, et on va aller jusqu’au bout de la logique, et on ne va pas s’habiller comme vous, et on va faire de la musique qui ne vous plaît pas etc., etc.” Il y avait vraiment une espèce de logique de confrontation de classes au début, en plus des côtés “libérateur, provocateur et accélérateur” de cette musique punk qui causait dans le poste. En 81, on arrive au lycée, on a 15 ans, la gauche passe au pouvoir, nos parents sont contents. Je suis arrivé au lycée avec une rose à la main, alors que dans ma classe il y en a qui pleuraient, qui se disaient merde, les rouges sont au pouvoir, ça va être le goulag…
Alexa : De mon côté, je venais d’un milieu aisé, mais j’étais en rébellion totale. Ma famille pleurait de voir la gauche arriver au pouvoir et ça me faisait bien rire. Quand je me suis retrouvée dans ce lycée de bourges, j’étais baba-cool/Peace & Love, plutôt mal-à-l’aise au milieu des costard-cravates. J’ai croisé Gilles le punk dans un couloir et c’est là que tout a commencé. J’ai changé de look par la suite parce que je trouvais que le punk correspondait plus à mes idées et mes envies de “tout casser“. Ça n’a pas plu à mon père qui me traitait de fasciste !
 Le groupe avait déjà commencé ?
Le groupe avait déjà commencé ?
Gilles : Oui, et sur des bases politiques d’emblée. On a commencé par écrire des textes, à plusieurs, on a fait des photomontages… Et là-dessus, on a commencé à chercher des instruments et à se dire : on va faire de la musique. On avait lu des trucs… “Punkitudes”, par exemple, où on a découvert les textes de Métal Urbain. Et là on s’est dit, putain, c’est exactement ce qu’on pense. C’est ça.
Laurent : Pour nous, le punk, c’était ça. Qu’importe si on ne sait pas jouer, on va prendre les instruments, on va monter un groupe, on va aller cracher notre venin. Et le plus vite sera le mieux !
Gilles : Brigade, c’est clair que c’était en référence à la Fraction Armée Rouge et aux Brigades Rouges… C’était cette vision très romantique de la lutte armée qu’on a à 15 ans… Par contre, à l’époque, on avait une vision politique, mais on ne comprenait pas bien les tenants et les aboutissants de cette idée d’avant-garde du prolétariat… Pour l’instant on ne s’en rendait pas bien compte. Pour nous c’étaient juste “les vrais”, ceux qui étaient en train de se battre, dans les cités, dans la ville, la guérilla urbaine.
Laurent : Du coup, on a pris le truc au pied de la lettre, on s’inventait des concepts, ce qui après va devenir la Fraction Rock Terroriste. Pour nous le rock est un acte terroriste (de terroriser l’ordre établi, les conventions etc.). Je vais rejoindre le groupe un peu après sa formation, et je me souviens qu’on répétait au début dans le gymnase de l’école. On faisait un carré de tapis de saut en hauteur pour jouer au milieu. Les textes au début c’était du genre : “Crache sur la croix, il faut piller les églises, détruire le système, pour après le reconstruire”… On était vraiment dans un truc anarcho punk. On a rencontré Gagou, un punk un poil plus vieux que nous, très anarchiste, avec plein de disques et une basse. Il restera jusqu’en 86.
Alexa : Je suis arrivée dans le groupe peu après Laurent, suite aux demandes insistantes de Gilles. Je n’ai pas accepté tout de suite. J’étais trop timide et je me voyais mal chanter sur scène. Finalement j’ai pris sur moi, et je me suis lancée dans l’aventure. Au début c’était vraiment dur ! Je chantais en murmurant. Les autres m’ont soutenue et m’ont bien aidé à destresser. Du coup, j’ai appris à crier, mais pas à chanter pour autant !
Vous disiez que quand vous avez monté le groupe, personne ne savait jouer. Comment se fait le choix des instruments ?
Gilles : Par hasard. Je ne saurais même pas dire pourquoi j’ai acheté une guitare. Il me semble que je l’avais eu pour 30 francs.
Laurent : On apprend en jouant. J’avais lu une interview de Starshooter qui disait : on ne sait pas jouer, mais on n’en a rien à foutre de tous ces groupes de musique progressive qui font des solos à n’en plus finir… Du coup on avait le droit. Et si on ne l’avait pas, on le prenait. On prend la scène d’assaut et le reste suivra…
Alexa : Oui, on s’en fichait complètement parce qu’on avait trouvé un moyen de nous exprimer à fond et sans censure…
Gilles : Notre premier concert a lieu en 82, un truc organisé par les anarchistes du coin. C’était un concert antimilitariste. Il y a comme chaque année des mecs qui viennent avec leurs guitares sèches chanter des trucs politiques… Et on a joué là-bas, avec un autre groupe lyonnais, “Sordid Blanket”, qui, comme nous, avait un petit following de quelques copains. Et là on fait un concert chaotique, c’était plein de punks, et on a joué n’importe quoi. Il n’y avait pas un seul morceau construit. Chacun faisait ses trucs dans son coin… Et devant, c’était le pogo général, l’émeute. Et quand on a arrêté, les mecs nous gueulaient : encore, encore !!!
Laurent : Jusqu’en 1984, nos concerts ne seront pas vraiment des concerts. Je ne sais même pas si on arrivait à faire des morceaux entiers carrés…
Alexa : Ça c’est sûr que non ! Au festival “Justice Zulu” en juillet 84 en Ardèche, Rodolphe, un guitariste qui a joué un an avec nous, s’est effondré avant la fin du premier morceau ! On a continué le concert sans lui, c’était vraiment chaotique !
Gilles : C’est vrai qu’à ce moment-là, pour nous, il n’y avait pas beaucoup d’endroits pour jouer. Je dis pour nous, parce qu’on ne se considérait pas comme des musiciens, on n’allait pas jouer dans les bars… On se voyait plutôt comme des activistes !
Laurent : On a été rapidement identifié comme le groupe anarcho-punk de Lyon, et on s’est retrouvé invités dans des concerts de soutien… Mais c’est vrai qu’entre 81 et 84, on a dû faire trois ou quatre concerts.
 Laurent, tu vas intégrer le groupe juste après le premier concert ?
Laurent, tu vas intégrer le groupe juste après le premier concert ?
Laurent : Oui, début 83. L’ancien chanteur n’avait pas spécialement envie de continuer. On se croisait avec Gilles dans le lycée avec les mêmes badges de Clash, de Stiff etc., et ça s’est fait naturellement. On n’était pas dans la même classe mais on communiquait avec un marqueur sur les tables ! C’était bien parti pour ne pas s’arranger…
Là, on a quasiment le line-up définitif ? Laurent : Oui, si on rajoute Alexa, la chanteuse, qui est arrivée en 84, puis Pierre-Yves, le saxophoniste. C’est à peu près celui qui va enregistrer l’album. Avant, on bossait avec Rodolphe, qui lui savait réellement jouer de la guitare, et on a avancé suffisamment pour enregistrer nos premiers titres. Il joue sur “Vivre pas Survivre” le premier morceau qui est sorti sur des compiles.
C’est assez atypique pour l’époque, et même après, d’avoir une nana dans un groupe de rock, c’est quand même un milieu macho, consciemment ou inconsciemment un milieu de mecs ?
Laurent : On était vraiment très loin du rock macho…
Gilles : On avait même un côté très féministe. D’entrée de jeu, un des premiers textes qu’on a écrits était un texte féministe. Crass avait des filles dans le groupe, comme pas mal de groupes anarcho-punks anglais. On adorait X, le groupe punk de Los Angeles, mais aussi Wunderbach, en France. On trouvait qu’avoir un chanteur et une chanteuse dans le groupe, ça avait un côté magique.
Alexa : Atypique, mais c’est clair qu’il n’y a jamais eu de machisme dans le groupe. Je n’ai d’ailleurs jamais eu de soucis dans le milieu anarcho-punk. Dans les concerts, si je pogotais au milieu du public, les gars faisaient bien attention à ne pas me faire mal ! Et lorsqu’ils m’envoyaient valdinguer sans le faire exprès, ils venaient aussitôt me relever. Je trouvais ça plutôt touchant.
 Vous allez tourner essentiellement sur des concerts de soutien ?
Vous allez tourner essentiellement sur des concerts de soutien ?
Laurent : Jusqu’à l’album, on ne va faire quasiment que ça.
Alexa : On se sentait concernés. On ne faisait pas de la musique pour gagner de l’argent, mais pour exprimer des idées.
Gilles : Assez rapidement, il y a eu un article sur Haine Brigade dans la revue anarchiste de Lyon. Une très grosse interview sur quatre pages, avec des photos. Ça a fait parler de nous sur Lyon et dans les milieux très, très politisés. Du coup, ils se disaient : tiens, il y a des gamins qui sont en train de faire un truc nouveau par rapport aux anars qu’on avait l’habitude de voir…
Laurent : C’est vrai qu’on est arrivé au punk par la politique. En 84, on a commencé à répéter plus intensivement, à faire des démos. On est monté à Paris, on est passé à l’Usine à Montreuil. On a commencé à rencontrer les gens des Brigades, les gens de New Wave, tout ça par l’intermédiaire de Tapage Nocturne particulièrement.
Gilles : Au départ, je correspondais juste avec lui, c’était le copain d’une copine de lycée. Il m’envoyait des lettres avec des dessins que je trouvais géniaux. Mais il n’était pas du tout punk à l’époque, il l’est devenu en découvrant les premiers trucs Bérus, Ludwig, quand ils jouaient dans la rue, sur le parvis Beaubourg, etc.
Laurent : Un peu après, on va créer le fanzine “Kanaï”, dont il sera la rédaction parisienne, et le maquettiste illustrateur de choc.
L’idée, c’était de relier des gens et de faire une sorte de collectif de punks politisés.
Est-ce que vous pouvez présenter la Fraction Rock Terroriste ?
Gilles : Cette idée de Fraction Rock Terroriste est arrivée juste avant le premier Kanaï.
 Laurent : L’idée, c’était de relier des gens et de faire une sorte de collectif de punks politisés. Il y avait d’autres groupes lyonnais, des grenoblois, des parisiens, des dessinateurs. Ceux qui avaient envie d’en être en étaient. Le nom est suffisamment explicite pour savoir que la base c’est le rock radical et des positions révolutionnaires, voire une envie de tout foutre en l’air ! Genre “no more heroes anymore”.
Laurent : L’idée, c’était de relier des gens et de faire une sorte de collectif de punks politisés. Il y avait d’autres groupes lyonnais, des grenoblois, des parisiens, des dessinateurs. Ceux qui avaient envie d’en être en étaient. Le nom est suffisamment explicite pour savoir que la base c’est le rock radical et des positions révolutionnaires, voire une envie de tout foutre en l’air ! Genre “no more heroes anymore”.
Alexa : La F.R.T. a participé à l’organisation du festival Justice Zulu, un autre dans un squatt le 31 décembre suivant et ensuite le concert des Bérus et HB lors des journées libertaires de mai 85 à Lyon. Je me souviens aussi du premier “Forum du disque autoproduit et du fanzine” organisé par diverses associations bien-pensantes et subventionnées par Jack Lang. Ça se passait au centre des expositions de Montreuil. Le public devait payer 40 francs à l’époque pour pouvoir rentrer au forum. La F.R.T Paris, Kanaï et d’autres fanzines (Molotov & Confetti, Mr Propre, Manifestes, Les héros du peuple, Symphonie Urbaine…), mais aussi Bondage Records et les Nuclear Device, ont organisé un contre-forum sur les marches à l’extérieur, pour finalement rentrer en force et squatter un stand. L’idée étant de pirater proprement et sans bavure ce qu’on considérait comme le forum de la “récupération et de l’arnaque”. Opération réussie à 100 %, puisque le stand squatté a connu, ce jour-là, un furieux succès !
Quelles étaient les valeurs que vous mettiez derrière ?
Laurent : Tapage nous avait dessiné un pirate avec les dents cassées, le couteau entre les dents… La F.R.T. c’était un mix entre l’utopie des pirates, le punk et la guérilla urbaine… À ce moment, les manifs anti Le Pen se développaient, des squats s’ouvraient… C’était une bonne base. Mais on n’était pas forcément des violents. La violence, c’était plutôt celle de notre musique et de nos paroles.
Gilles : C’était une posture… plus confortable ! On n’était pas sur le terrain de la guérilla urbaine au sens strict. On se disait qu’on pouvait le faire autrement… On avait une radicalité dans la démarche et les objectifs qu’on se fixait politiquement, par contre, dans la vie de tous les jours, on était plutôt des gens gentils. C’est-à-dire respectueux, plutôt avenants, on ne foutait pas le bordel dans les endroits où l’on jouait… On essayait de se tenir aux options politiques qu’on s’était données. Les gens des Brigades étaient vraiment dans le même trip que nous, c’est pour ça qu’on s’est bien entendu.
Laurent : Ce qui ne nous empêchait pas, parfois, de nous ruiner les neurones avec eux, et de rigoler bêtement jusqu’au bout de la nuit…
Gilles : Dans le quotidien, on n’était ni des gens normaux, ni des cramés… Steph : … Ni des curés d’extrême gauche.
Laurent : On n’avait pas de leçons à donner aux gens, juste l’envie de motiver une vision subversive de la société et du monde de la musique.
Steph : À l’époque, on a fréquenté de près certains groupes anarchistes, et ce n’était clairement pas pour nous…
Alexa : Les anars avaient des positions qui nous allaient, mais dans la pratique c’était parfois différent. On les ressentait finalement assez sectaires pour une partie d’entre eux… Ils pouvaient être très directifs et nous, on n’avait pas envie de ça.
Gilles : Pour nous, ce n’était pas du tout envisageable de rentrer dans un système dogmatique, quel qu’il soit. Dès qu’on commence à me dire : “il faut faire ci, ou il faut faire ça”, la première chose dont j’ai envie, c’est de faire le contraire. Dans le fond, je sais ce que je veux, les objectifs que je me fixe, et comment je veux mener ma vie. Et, collectivement, sur quel terrain j’ai envie de rassembler des gens…
Laurent : À ce niveau-là, jamais de compte à rendre, juste des comptes à régler… Ta vie propre, comment tu la mènes, comment tu fais ton groupe, comment tu parles aux gens, aux filles, comment tu les respectes… À partir de là, tu as des affinités avec les gens, pour nous, c’est politique, c’est une façon de faire. Après, savoir si tu es de telle ou telle obédience, ce n’est finalement pas si important que ça. C’est sûr qu’on n’est pas à droite…


 Steph : On n’était pas très nombreux dans ce milieu, et quelque part, on n’avait pas assez d’amis pour se tromper d’ennemis. On a vu beaucoup
trop de gens se tromper d’ennemis. Pour certains, dès que tu n’es pas aussi radical qu’eux, ou pas sur la même ligne politique, tu deviens pire que leur ennemi politique… Pour nous, ces lignes de fracture, on aura suffisamment le temps d’en parler le jour de la révolution…
Steph : On n’était pas très nombreux dans ce milieu, et quelque part, on n’avait pas assez d’amis pour se tromper d’ennemis. On a vu beaucoup
trop de gens se tromper d’ennemis. Pour certains, dès que tu n’es pas aussi radical qu’eux, ou pas sur la même ligne politique, tu deviens pire que leur ennemi politique… Pour nous, ces lignes de fracture, on aura suffisamment le temps d’en parler le jour de la révolution…
On n’était pas très nombreux dans ce milieu, et quelque part, on n’avait pas assez d’amis pour se tromper d’ennemis.
Le fanzine Kanaï, organe de la Fraction Rock Terroriste ?
Gilles : Kanaï est parti de notre envie de nous exprimer. On faisait des concerts, on écrivait les textes, mais l’idée, c’était aussi de toucher des gens qui n’y venaient pas. C’était l’époque des premiers fanzines, les musiciens de Crass dans leurs concerts distribuaient des tracts… Le premier numéro de Kanaï, c’était un truc contre le racisme, on avait un côté très pédagogique. C’était début 1984.
Alexa : On ne voulait pas imposer nos idées, on voulait juste montrer aux gens que la vie n’était pas forcément telle qu’ils la voyaient. On voulait aussi qu’ils comprennent qu’un punk qui joue du rock ce n’est pas qu’un déjanté qui se bourre la gueule à la bière et qui sniffe de la colle à rustine, mais que c’est aussi quelqu’un qui pense, qui a des idées, qui crée et qui sait avoir l’esprit ouvert.
Laurent : On faisait aussi une émission sur radio Canut, une radio libre de Lyon. Mais éditer un fanzine, c’était aussi le moyen de se retrouver dans un réseau qui dépassait Lyon et sa banlieue…
Gilles : Sur Paris, les premiers qui nous ont touchés ce sont les Brigades. La pochette de l’album “Bombs n’Blood n’Capital” était super marquante. Ensuite Lucrate Milk, M.K.B., qui avaient ce côté groupuscule bizarre, les tout premiers Bérus, et les deux premiers albums de La Souris Déglinguée. Ailleurs, il y a Karnage, Camera Silens, et surtout O.T.H.
Laurent : C’est vrai que l’idée du fanzine, c’était de se retrouver éventuellement en réseau avec tous ces gens-là. De construire une sorte d’information alternative basée sur un réseau plutôt underground.
Donc Kanaï, c’est musique et politique ?
Laurent : De toute façon, toute l’histoire de Haine Brigade a été musique et politique.
Gilles : On parlait de tout ce dont on avait envie de parler. Il n’y avait pas que des chroniques de disques politiques, pas que des chroniques de disques punks…
Laurent : Et la rédaction, c’était un peu toute la Fraction Rock Terroriste. Avec une prédominance des gens de Haine Brigade et Tapage… Les liens se tissaient, on échangeait des fanzines avec d’autres (On A Faim !, L’Erreur de l’Occident, Alerte Rouge, Molotov & Confettis), et on les mettait en vente à la Gryffe, la librairie anar de Lyon. Après, on a commencé à le faire pour des disques. Et en 1986 on a ouvert une boutique de disques, K7, fanzines… Bref, on s’est mis à distribuer et à mettre à disposition la plupart de ce qui se faisait dans le réseau alternatif. Ça fonctionnait beaucoup par échanges, même avec l’étranger. On commençait à s’intéresser au hardcore, avec les groupes américains, mais aussi italiens, scandinaves, brésiliens… Entre le groupe, le zine et la boutique, on avait plusieurs vecteurs pour propager nos idées et rencontrer un maximum de gens. On appliquait le “Do It Yourself” à fond. On organisait des concerts sur Lyon dans des lieux désaffectés et occupés pour l’occasion. Pour nous, partir faire des concerts sert vraiment à voyager, à faire des rencontres… En 85, nos premiers concerts avec les Bérus, grosse sensation. Puis tournée en Allemagne, dans des lieux alternatifs, des squats. On découvrait le plaisir de se confronter à des tas de personnes avec des expériences passionnantes et impressionnantes. Les Allemands étaient déjà très au point sur le fonctionnement d’un underground radical. Idem pour la Suisse, alors que la France était à la traîne de l’Europe en matière de radicalité efficiente…
Jusqu’en 86, vous n’aviez sorti que des démos ?
Laurent : Au début, on n’a jamais pensé à faire carrière dans la musique, (je te rassure, à la fin non plus), puisqu’on ne savait pas jouer. Petit à petit on a commencé à répéter vraiment, à faire des morceaux, à devenir un vrai groupe. Steph va s’occuper de trouver des dates, un camion pour tourner… En route pour l’aventure et roulez jeunesse !
Gilles : On ne se sentait pas forcément au niveau pour enregistrer en studio. Ça nous paraissait complètement hors contexte de sortir un disque… Je me souviens que quand on a écouté Métal Urbain, les premiers Brigades, les premiers Bérus, on trouvait ça terrible. Musicalement on se trouvait mauvais à côté. Et puis il faut dire aussi qu’on n’intéressait personne. Le peu qu’on a fait écouter à droite à gauche ne rencontrait guère d’écho. On a donc sorti une K7 sur notre propre label.
 Vous vous retrouvez quand même sur la compilation “Rock Army Fraction” ?
Vous vous retrouvez quand même sur la compilation “Rock Army Fraction” ?
Gilles : Oui, et le même titre sur la compile “New Wave volume 2” et sur une compile anglaise parce qu’on était en contact avec les Disrupters. On avait donné d’abord le titre aux gens du fanzine Alerte Rouge pour “Rock Army Fraction”. Eux avaient dans l’idée de faire un disque avec des groupes politisés… Ils étaient vraiment communistes. Et il y avait, à ce moment, un vrai clivage entre les anars et eux, qui étaient les “rouges”. Malgré tout, ils ont trouvé que c’était bien de nous mettre dessus.
Steph : C’était un milieu qui était très divisé, il y avait plein de guéguerres, et nous, n’étant pas parisiens, on n’était pas dans les conflits locaux, on parlait avec tout le monde.
Laurent : On avait envie d’être déviants par rapport à tous les clochers… ! Même si on était clairement en phase avec les luttes et les mots d’ordre de l’extrême-gauche et des (w)anarchistes.
Que faites-vous avec votre label ?
Gilles : On le crée pour sortir des cassettes d’abord. Il y a eu Haine Brigade, puis un live de D.O.A. qui nous a permis de gagner un peu de sous, et ensuite la compile “Enragés”, manifeste de la FRT, avec des groupes lyonnais, grenoblois, suisses et les Kamionërs du Suicide de Paris.
Steph : L’acte fondateur du label, c’est d’acheter un doubleur de cassettes !
Votre label s’appelait “Bébé Rose”, pourquoi ce nom ?
Gilles : C’était pour prendre le contre-pied de Haine Brigade. Le nom du groupe nous pesait parfois un peu. Quand on l’avait choisi on avait 15 ans, là on était un peu plus grands, et on trouvait que la connotation n’était pas toujours pertinente. Et puis pour se moquer un peu des stéréotypes punks, “No Future records”, etc.
Laurent : Peu de gens nous avaient vus en concert, mais tout le monde avait l’impression qu’on avait créé les Brigades Rouges à Lyon…
Votre album est sorti en 1987, qu’est-ce que vous en pensez, artistiquement ?
Laurent : J’aime bien le son, mais je pense qu’il a été fait trop tôt. Je crois qu’il y a six morceaux sur les 12 qui ont été composés dans le mois précédent l’enregistrement. Et il y a eu un changement de bassiste deux mois avant, Dominique, qui jouait dans Sourire Kabyle, a remplacé Gagou. Je pense que s’il avait été enregistré six mois plus tard ça n’aurait pas été plus mal. Ç’aurait été plus représentatif de ce qu’on a fait après, plus mature musicalement. Mais on avait cette opportunité d’aller à Londres, dans le studio où avait enregistré Crass… Le genre d’occasion à ne pas louper.
Steph : Je trouve qu’artistiquement ce n’est pas terrible, mais par contre on a eu le meilleur son du punk français à l’époque. En France, personne ne savait enregistrer ça, et on est arrivé dans un studio où le mec savait faire sonner du punk rock.
Gilles : Il n’y a que les voix qui sont trop enrobées dans des effets, mais ça vient du fait que Laurent et Alexandra n’étaient pas assez sûrs d’eux… Je trouve cet album assez difficilement catalogable. Ça ne sonne pas rock’n’roll, ça ne sonne pas punk… Les morceaux sont assez speeds, comme des trucs de punks limite hardcore, en même temps la production est assez clean, il y a une grosse batterie…
Alexa : Artistiquement, je pense que pour l’époque, vu notre âge et notre totale inexpérience musicale, il est quand même pas mal ! D’ailleurs mis en téléchargement gratuit sur le net, il continue à être apprécié, par des anciens, mais aussi des plus jeunes.
Comment a-t-il été reçu ?
Gilles : À l’époque, il a été assez bien reçu dans le microcosme, on a eu de bonnes chroniques dans les fanzines, malgré quelques critiques sur les voix, notamment dans Maximum Rock’n’Roll [fanzine punk de référence, créé en 1982 à San Fransisco, il existe toujours, NDA]…
Ce n’est pas courant dans le rock ‘n’ roll, déjà d’avoir une fille qui chante, mais en plus avec une voix claire ?
Gilles : Ça venait comme ça, il n’y avait aucune recherche. Laurent : On n’a pas eu de réflexion par rapport à ça, c’était naturel, on ne chantait pas du punk, on chantait de la “chanson punk rock française”, parfois à la limite du hardcore qui commençait à envahir nos oreilles.
Alexa : Ce n’est pas courant non plus d’avoir une fille qui chante faux, du premier morceau de l’album jusqu’au dernier ! On a tout de même innové dans ce domaine… !
Pourquoi ce nom d’album : “Sauvages” ?
Laurent : Ça faisait une bonne dichotomie avec la pochette, deux gamins qui s’embrassent… On était toujours sur le truc amour et haine : Haine Brigade/Bébé Rose, Sauvages/les gamins qui s’embrassent… Clash avait pondu “Hate & War”, nous c’était “Hate & Love” (sans comparaison aucune avec le Clash, même si on a appris à jouer en reprenant “Garageland” ou “Police & Thieves”)…
Alexa : Un bon contraste entre notre musique et ce qu’on était dans la vie. On n’aimait pas la violence mais on en mettait dans nos textes. On ne parlait pas d’amour dans Haine Brigade et pourtant on était tous des amoureux nés !
Gilles : On a bricolé la pochette avec Tapage pendant une nuit. On avait récupéré cette super photo de Kertes. Le lettrage Haine Brigade, c’étaient des agrandissements de photocopies. Au départ, la photo était en positif, et quand on est allé faire les flashages, on a vu le négatif, et on s’est dit que c’était vachement mieux comme ça. Ce n’est pas un truc qu’on a réfléchi pendant des heures. Et le verso, avec la photo du loup qui hurle devant un immeuble, c’était en référence au titre instrumental, “Pleine Lune”. Le premier pressage est avec une pochette en noir et blanc, puis le second à un lettrage rouge et le dernier un lettrage vert. L’album nous a ouvert réellement la possibilité de multiplier les concerts. On avait organisé le concert des Bérus à Lyon juste avant sa sortie. 2.000 personnes étaient là, on a fait la première partie, avec Sourire Kabyle, ça a été une émeute monstre dans la Bourse du Travail, un lieu avec des sièges, un immense balcon. 50.000 francs de dégâts et la fin des concerts rock dans le lieu ! Ensuite on a joué avec les Brigades, Nuclear Device, Ludwig, les Sheriff, Laid Thenardier, les Thugs, Parabellum…, un peu partout en France.
Vous avez fait une tournée en Allemagne avec “The Brigades” ?
Laurent : On avait énormément d’affinités avec les Brigades et de vraies amitiés. Du coup on a fait plusieurs concerts ensemble, puis en 87, on a tourné en Allemagne avec eux, en soutien aux prisonniers politiques de la Fraction Armée Rouge. C’étaient eux qui avaient cette connexion, et quand ils nous ont proposé de partir avec eux, on a accepté tout de suite. C’était important, pour nous de jouer pour cette cause, car même si tu n’es pas d’accord avec les options de la Fraction Armée Rouge, le problème là était plus large, notamment sur les conditions de détention, les expériences de privation sensorielle, la torture blanche… À ce moment, la résistance anticapitaliste allemande était très radicale, virulente et assurait un vrai rapport de force notamment à travers les squats. Comme au pays Basque, la problématique des prisonniers permettait de structurer la lutte. Cette tournée a été un moment très fort, dans une ambiance très tendue politiquement. Les précurseurs des Black Blocks faisaient la une des magazines allemands, leur force lors de manifestations tournant à l’émeute, effrayait. Et les punks étaient souvent les forces vives du mouvement. On a donc été confrontés à une réalité beaucoup plus dure et active qu’en France. On mesurait l’écart qui nous séparait de ce type d’organisation politique. De Hambourg (Hafenstrasse) à Berlin (Kreuzberg) via Cologne (La Maison Blanche), on était vraiment effarés par l’ampleur de la “ résistance “ et du mouvement squat alternatif en Allemagne ! Sans parler de la qualité des groupes comme Jingo de Lunch que l’on a croisé sur la route…
Après l’album, vous enregistrez le split avec les Bérus pour la revue “Noir et Rouge” ?
Gilles : On l’a enregistré assez vite, derrière.
Laurent : Mais ça a mis un an à sortir…
Gilles : On en attendait beaucoup, et toute cette période d’attente n’a pas été géniale pour nous, on n’a pas beaucoup avancé concrètement… C’est encore Tapage qui avait fait la connexion, puisqu’il collaborait à la revue, et que c’était un fan devant l’éternel des Bérus et de Haine Brigade. C’est sûr que ce n’était pas sur notre nom qu’ils allaient vendre beaucoup de disques, mais pour lui c’était important qu’on soit là. Ça a été un super tremplin pour nous, beaucoup de gens ont découvert le groupe, on avait de plus en plus de propositions de concerts…
 Laurent : Mais c’était déjà le début de la fin, la fin des Bérus, la fin de Haine Brigade, la chute du mur de Berlin… Rires…
Laurent : Mais c’était déjà le début de la fin, la fin des Bérus, la fin de Haine Brigade, la chute du mur de Berlin… Rires…
Gilles : J’ai un souvenir assez vague de cette période… On avait commencé à enregistrer des morceaux, dans l’optique de notre deuxième album. Suite au 45 tours, on était en contact avec Bondage pour le sortir chez eux. Sauf qu’à cette période, ils ont commencé à dilapider toutes leurs thunes sur les Satellites, et autres Lords of the New Church, ils ont commencé à s’embrouiller entre eux… Pendant plus d’un an, on a attendu de savoir si notre disque allait sortir chez eux. Ça, c’est en 1989. Un nouveau bassiste débarque, Zvonimir. Et du coup, on a une dizaine de titres enregistrés dont seuls deux sortiront sur des compiles. On part tourner en Suisse, Autriche et Hongrie. Nouvelle expérience géniale. On passe le rideau de fer, et on joue pour des gens qui n’ont quasiment jamais vu de groupe occidental. Il y a des punks, et des anarcho-punks à Budapest, mais ailleurs on joue devant des jeunes venus voir un concert rock et se défouler. Tapage est sur scène et fait des fresques en live, avec des slogans politiques en hongrois, ce qui galvanise l’affaire. On joue avec Die Trottel qui a organisé les dates. Au retour, c’est à nouveau l’attente pour la sortie éventuelle d’un disque, puis ça s’est transformé en : est-ce qu’on continue ? Mon frère, Régis, le batteur, avait eu un gamin en 1988. C’est lui qui nous a dit : “les gars, maintenant on est au pied du mur, est ce qu’on avance, sinon je vais faire autre chose”…
Laurent : Haine Brigade, on s’est connu à 15 ans au lycée, et tout s’est toujours fait naturellement. Jusqu’au premier album, on n’avait aucun plan de carrière, on a vécu des trucs hors du commun… Par contre en 1989-90, on n’était plus étudiants, Régis avait un gosse et tout ça a fait qu’on s’est arrêtés, sans rupture réelle. On est tous plus ou moins parti sur d’autres projets musicaux.
Gilles : On aurait très bien pu se dire : le deuxième album, on va le faire nous-mêmes, comme le premier. Mais il n’y a pas eu la volonté. On était, comme tous les groupes du moment, sur l’alternative : est-ce qu’on signe et on continue, ou on ne signe pas. On ne voulait pas sortir l’album tout seuls. On voulait passer un cap. Comme il n’y a pas eu de label, on ne l’a pas fait.
Laurent : C’est vrai qu’en même temps, il y a beaucoup de trucs qui se sont cassés la gueule à ce moment-là. Avec les Bérus, il y a plein de groupes, de labels, d’associations qui se sont arrêtés. Et nous, on a continué, sur plein d’autres projets musicaux et politiques.
Steph : On n’a pas changé de vie non plus…