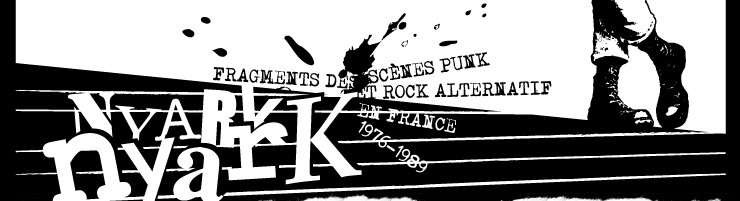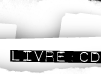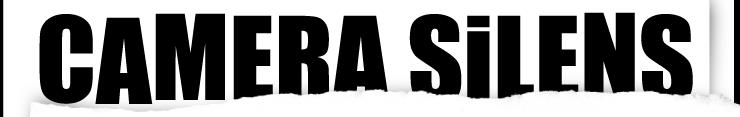Comment se passe le tout début de Camera, comment décidez-vous de faire de la musique ?
Comment se passe le tout début de Camera, comment décidez-vous de faire de la musique ?
Benoît : En relisant un article, je m’aperçois qu’on s’est rencontrés chez “Le Chné” le premier batteur, tous les trois avec Gilles. Mon grand âge commence à jouer avec ma petite mémoire… On avait déjà eu un ou deux groupes avant, enfin, des ébauches de groupes, et, comme souvent, par désoeuvrement et envie de s’éclater on a mis en route Camera Silens. On a donc commencé tous les trois, fin 1981.
Quel était l’état de la scène sur Bordeaux à l’époque ?
Il y avait tout à faire !! Tout était chiant, et on a plongé dans la vague Punk. L’ambiance était électrique, quelques lieux comme le mythique “Bar des cours” étaient bouillonnants. A côté de ça, sur Bordeaux il y avait toute une scène locale, à laquelle on n’adhérait pas du tout.
Dans la lignée de Téléphone ?
Benoît : Oui, un peu comme ça, un peu rock’n’roll, un peu rock varièt. Ce n’était pas vraiment notre truc. Ceci dit, on n’est pas les premiers dans le genre punk sur Bordeaux, juste avant il y avait un groupe qui s’appelait Strychnine. J’étais fan, je suis allé les voir je ne sais pas combien de fois, c’était le premier groupe à tendance punk bordelais, avec une attitude ad-hoc. Bon l’écoute de leurs disques est moins flatteuse, je crois qu’ils en ont un peu souffert, mais leurs concerts étaient vraiment supers. Juste après, dans la mouvance bien 77, il y avait un groupe qui s’appelait Stalag, c’était le premier groupe vraiment punk avec le look, l’attitude, les poses et la musique. Je les ai vus plusieurs fois en concert, et c’est là que se sont formées, dans leur public, les bases de ce qui allait devenir le mouvement punk de Bordeaux. Il y avait donc un petit réseau sur Bordeaux où l’on pouvait aller voir des concerts, ce n’était pas le désert comme dans plein d’autres villes… Ce n’était pas le désert, mais ce n’était pas facile, c’était tout nouveau, tout rebelle, tout anti-conformiste, tout était à construire en fait. On avait notre réseau de lieux comme le B.D.C. cité plus haut, l’inévitable Chiquito, notre foyer, puis la Gironde, le Luxor, La Chèvre, etc. À l’époque, il y avait tout à faire, y compris pour les ingénieurs du son qui devaient apprendre à enregistrer du rock carton ! On se retrouvait en concert ou en studio avec des mecs aux cheveux longs qui avaient d’autres références que nous. Même pour enregistrer en studio c’était une bataille, il fallait tout défricher. Il y avait beaucoup de groupes rock qui venaient de la mouvance du rock progressif, du jazz rock, de la pop. On a été dans la pleine lignée de la cassure qui avait eu lieu en Angleterre, et qu’on a appliquée dans notre ville. On a monté le groupe en rupture avec ce genre d’ambiance, les trucs un peu babas, un peu blues, des trucs qui ne nous éclataient pas du tout. Après, il faut savoir qu’on n’était absolument pas structurés, que tout ça s’est monté par la base et par la rue où on traînait comme des malades. Vous vous considériez punks à l’époque ? Benoît : Si on veut, on devait correspondre à l’imagerie.
Le groupe s’est appelé comme ça dès le départ ?
Benoît : Gilles et moi, on avait tous les deux le même bouquin sur la Fraction Armée Rouge. On le feuilletait chacun dans notre coin en cherchant un nom pour le groupe, et finalement on est tombé d’accord sur “Camera Silens” [littéralement chambre silencieuse, terme désignant les caissons de privation sensorielle dans lesquels étaient détenus les militants de la Fraction Armée Rouge. Technique de torture “blanche”, ce sont des pièces insonorisées, aux murs blancs, éclairées en permanence par une lumière artificielle, NDA]. On ne voulait pas d’un nom en anglais et encore moins un nom en ST.
En ST ?!
Benoît : Oui, à l’époque sur Bordeaux la mode pour les groupes était de prendre un nom en ST en référence aux Stooges ou aux Stones. Il y avait Stalag, Strychnine, Les Stagiaires, Les Stillettos, Les Standards, etc…
Dès le départ vous jouez les morceaux que l’on va retrouver sur le premier album, “Réalité” ?
Benoît : Tu sais comme on s’est produit nous-mêmes, on a avancé lentement, ce qui fait que Réalité c’est une longue gestation, il y avait pas mal de morceaux qu’on jouait déjà, même avant la première compilation Chaos En France. C’est un peu grâce à cette compilation qu’on a réussi à faire sortir le nom de Bordeaux. On a eu notre première époque bien punk en trio, et de fil en aiguille, le style a évolué, il a constamment évolué jusqu’à la fin.
Votre première démo date de 1982 avec les morceaux “Squatt” et “Suicide” ?
Benoît : Ouais c’était une cassette, enregistrée à Toulouse, dont un morceau s’est retrouvé sur une compilation américaine.
Comment vous retrouvez-vous dans l’histoire “Chaos en France” ?
Benoît : Je ne sais pas si c’est eux ou nous qui les avions contactés. On avait déjà quelques interviews sur des fanzines, on avait dû envoyer la cassette à droite à gauche, honnêtement je m’en souviens plus.
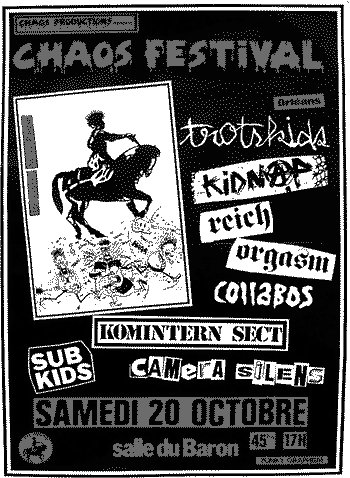 Dès le début ça colle avec les mecs de Chaos Productions ?
Dès le début ça colle avec les mecs de Chaos Productions ?
Benoît : Ça colle oui et non… On n’a jamais été des grands fans de Chaos, il ne faut pas croire, on n’a jamais trouvé les compilations géniales, c’était de la pochardise ces compilations, avec un côté beauf, second degré qui n’était pas vraiment notre truc. La plupart des morceaux c’était “pipi caca, on boit de la bière etc.” Ceci dit, Chaos en France c’était de bons gars, ils ont occupé un terrain où tout était à faire, avec les moyens du bord, on l’a pris comme ça, et on ne peut pas nier que ça nous a aidés.
C’est marrant que tu dises ça, parce que maintenant vous êtes un des groupes phares de ces compiles.
Benoît : Ben ouais, mais je me souviens que, quand on a reçu les disques avec les pochettes, on n’a pas sauté au plafond… Il y avait à boire et à manger…
À boire et à boire …
Benoît : … Rires… À boire et à boire ouais… Tu sais Chaos c’était un mec de Komintern Sect et un mec de Reich Orgasm, donc quand il y avait des sous, ils ont d’abord fait enregistrer leurs groupes. Du coup quand on leur demandait “quand est-ce que vous sortez notre disque ? Quand est-ce que vous nous donnez des sous pour qu’on entre en studio ? etc.”, ils disaient qu’ils n’avaient plus d’argent, que ça allait venir… Enfin bon, le truc habituel… Au bout d’un moment on leur a dit qu’on allait se débrouiller nous-mêmes pour sortir le disque. On est allé voir Patrick Mathé de New Rose, parce que c’est lui qui distribuait les compilations, et, comme il nous connaissait par ce biais, il a été d’accord pour distribuer le disque. On a donc enregistré et sorti Réalité nous-mêmes.
8.500 exemplaires, c’est énorme pour l’époque ?
Benoît : C’est-à-dire que ça s’est fait sur la durée, les 8.500 exemplaires ne sont pas partis d’un coup, la première année il y en a peut-être eu 2.000… Ce n’est quand même pas énorme non plus, les chiffres de vente étaient supérieurs pour tout le monde à l’époque…
Pour en revenir à Chaos en France, The Brigades, les parisiens, me disaient que les Brigades de Bordeaux avaient regretté d’être sur ces compiles parce qu’on y retrouvait un peu tout le monde, notamment des groupes pas très clairs…
Benoît : Ça les regarde… Il faut avouer qu’à l’époque, on ne se posait pas vraiment de questions, enfin, disons qu’on était contre tout… On était libres, et libres de fréquenter qui on voulait. On était punks, notre engagement c’était notre vie de tous les jours, ce qu’on allait faire le soir, nos potes, notre sincérité. J’ai mis mon premier bulletin dans l’urne à quarante ans ! Je sais, ce n’est pas glorieux… Nous, les compiles Chaos nous gênaient surtout d’un point de vue qualitatif. Ce qui nous gênait c’était surtout la musique et les textes qui n’étaient pas très bons, le petit côté beauf/punk. En plus je connais les deux mecs, et ça va, c’était juste bourrin… Il faut quand même reconnaître aussi qu’ils ont été un peu les défricheurs, avec de petits moyens, ceci explique aussi cela…
On peut parler des textes de l’album “Réalité” ?
Benoît : En fait on parlait de ce qu’on était censé connaître. On n’aurait pas pu écrire un texte sur des trucs qu’on ne sentait pas… La réalité sur le moment, c’était ça, on avait l’impression d’être nous-mêmes, en tout cas on n’avait pas l’impression de mentir, on essayait d’être sincères.
Comment a été reçu cet album ?
Benoît : Il a été bien reçu par beaucoup de fanzines, dans les réseaux parallèles, mais par contre la presse nationale et institutionnelle style Rock & Folk et Best nous a ignoré. Il faut savoir qu’au début, on n’avait pas de label, pas de structure, c’était vraiment artisanal. Tout ça n’était pas bien vu par la presse académique, ce n’était pas comme en Angleterre, où les mecs de Sounds ou de New Musical Express n’étaient pas gênés de faire plusieurs pages sur des groupes punks.
 Vous chantiez en français ?
Vous chantiez en français ?
Benoît : En fait nos modèles étaient anglais, mais on ne voulait pas reproduire, on voulait faire ça à notre sauce, avec nos mots, notre culture et notre quotidien. C’est aussi pour ça qu’on n’a pas cherché à prendre un nom anglais. C’était hors de question, comme il était hors de question de chanter en anglais, de toute manière, on parlait tellement mal anglais… Rires…
Quel public aviez-vous à l’époque ?
Benoît : Ça aussi, ça s’est fait petit à petit, mais dès le début on a eu un bon following de potes. Certains nous ont suivis jusqu’à la fin, et beaucoup nous ont aidés. En fait, tout ça, c’était du débroussaillage et c’est ce qui était hyper enthousiasmant. Une de mes plus grandes émotions, c’est quand on s’est pointé tous les trois à cette espèce de tremplin pourri, dans une banlieue quelconque et qu’on a gagné ! Là, ça a été incroyable, on avait dû faire des gros doigts, tous les stigmates punks de l’époque, hyper je-m’en-foutistes, on ne savait quasiment pas jouer… Mais on se sentait forts, en tout cas, plus forts que les autres… et on a été déclarés vainqueurs, ça nous a bien fait marrer.
Quelle était votre définition du punk ?
Benoît : C’était une attitude… Pour moi il y a deux punks, celui de 76, 77, et puis le revival des années 80. En 77 c’était No Future et en 1981-82 il y a eu l’émergence du street-punk, de la Oi ! et de plein de courants différents, le straight-edge, le psychobilly etc. Nous on était plus street-punks.
Dans la lignée des Sham 69 ?
Benoît : Oui, ça et d’autres on a beaucoup écouté. On a démarré avec des blousons en cuir cloutés, on allait assez souvent en Angleterre et on a vu comment ça a dérapé avec la pose, les magasins qui vendaient les trucs ad-hoc, les uniformes… C’est ça qui nous a peut-être fait basculer un peu plus dans le street-punk. Il y a également eu les premières compilations Oi ! qui nous ont marquées, dont les compiles Chaos En France 1 et 2 pour y revenir, sont des copies. Et bon, quand tu compares les deux, c’est difficile ! Nos références étaient anglaises, on voulait tenir la route par rapport aux groupes anglais, on répétait beaucoup, on essayait de travailler les textes. Dès qu’on avait quelques sous on essayait d’aller en Angleterre, on avait des amis qui habitaient à Londres. On se sentait vraiment en phase avec l’époque et avec le mouvement.
Ce qui nous a intéressés dans la Oi !, c’est justement cette ouverture sur monsieur tout le monde.
Le public qui vous suit à l’époque est issu de cette mouvance skin et punk ?
Benoît : Justement, ce qui nous plaisait c’était cette mixité, et pas seulement skins et punks, on a toujours dit qu’on jouait pour tout le monde. Ce qu’on aimait bien c’était le mélange : le boucher du coin, les potes du bar du coin, des étudiants j’imagine, des lookés, des pas lookés, des paumés… C’était ça qu’on aimait bien. Ce qui nous a intéressés dans la Oi !, c’est justement cette ouverture sur monsieur tout le monde. Si quelqu’un aime bien la musique, qu’il vienne au concert. Point ! Ce n’est pas une question de look en fait. J’ai toujours bien aimé les groupes genre Angelic Upstarts qui mélangeaient les genres.
Vous avez eu des problèmes avec la scène skin ?
Benoît : Non, pas spécialement en fait. Avec le temps, les gens déforment beaucoup. Des bagarres dans les concerts, je pense qu’il y en avait déjà dans les années 50 comme aux concerts des Chaussettes Noires ou autres, ça a toujours existé dans les concerts rock. Les skins n’avaient pas le monopole de la bagarre, comme dans la vie, n’importe qui peut y être confronté je pense. Après on en a fait tout un plat, mais quand tu fais une musique un peu énervée ça ne développe pas forcément des comportements “peace and love”.
Des problèmes quand la scène skin s’est politisée à droite ?
Benoît : Ça, c’est venu après. Au début, quand le punk puis la Oi ! sont arrivés, il n’y avait pas ce genre d’histoires, il n’y avait pas de skins rouges non plus, ça n’existait pas, il y avait juste des skins et des punks. Puis ça s’est radicalisé, il y a eu des mouvements d’extrême-droite qui se sont infiltrés, qui ont eu de plus en plus d’influence… Après on connaît tous les dérapages.
Vous en avez souffert ?
Benoît : Oui… C’est ce qui fait que j’ai donné une interview qui était assez critique sur Décibels, je disais que j’en avais ras le cul de tout ça. En fait, à l’époque, ça m’avait mis mal à l’aise toutes ces histoires. Maintenant, avec le recul ça va mieux… Rires… Comme si maintenant j’avais digéré.
C’est toi qui écrivais les textes depuis le départ ?
Benoît : Pas spécialement, avec Gilles au début puis avec Éric.
Le titre “Identité” sort sur la compilation “Les Héros Du Peuple Sont Immortels…” ?
Benoît : Pour nous c’était une période difficile, on commençait à avoir des problèmes internes et pas mal de doutes, c’est pour ça peut-être qu’on est différents des autres groupes présents sur cette compile. Cette jonction nous a permis de rencontrer les Babylon Fighters avec qui l’on a partagé l’affiche de quelques concerts. C’est un peu la compilation charnière entre les deux périodes de Camera Silens.
Le virage musical est important entre les deux albums ?
Benoît : Il était déjà important entre nos premières démos et le premier album. Il y avait des morceaux plus violents qu’on jouait sur scène qu’on n’a pas enregistrés. Réalité sonne déjà un peu différemment de ce qu’on faisait. On a commencé à mettre du sax, de la guitare acoustique, il y avait déjà une amorce d’ouverture sonore, que l’on va de plus en plus développer, qu’on retrouvera dans Rien Qu’en Traînant [titre du second album, NDA]. Ça suit aussi notre propre évolution musicale, personnelle. Je me mets à écouter, via la culture skin d’ailleurs, de la soul, du rock steady, des musiques auxquelles du temps de la création de Camera, je n’étais pas forcément sensible et concerné.
C’est en 1986 que vous prenez un saxo ?
Benoît : Il y en avait déjà un peu sur Réalité. Quand Gilles n’a plus été dans le groupe on a quand même voulu poursuivre à quatre, on ne voulait pas le remplacer. J’ai toujours chanté dans Camera, même quand on était trois, on s’était toujours partagé les parties de chant. Donc, je me suis forcé, parce que ça me faisait chier quand même, de me retrouver sur le devant de la scène où je n’étais pas vraiment à l’aise. Si on avait pu continuer avec Gilles tout aurait été plus simple, enfin si on peut dire.
C’est lui qui a voulu quitter le groupe ?
Benoît : Il est parti parce qu’il ne pouvait plus faire autrement, on ne pouvait plus continuer avec lui sinon on se serait arrêtés. On avait beaucoup donné pour ce groupe, et, comme il semblait qu’il y avait pas mal de gens derrière nous, ça nous a poussés à continuer… Même si il y a eu une période où on s’est mis en pause. Ce qui nous a relancés c’est quand Michel Vuillermet nous a contacté pour un reportage sur le groupe pour son émission “Décibels”. On s’est dit : “putain, il y a un mec important qui s’intéresse à nous, qui nous soutient, qui veut faire tout un truc sur nous…” Il était d’ailleurs aux Enfants du Rock, on s’était rencontrés à cette occasion quand il avait filmé le Rock à Bordeaux… Quand il est passé d’Antenne 2 à FR3 pour son émission et qu’il nous a rappelés, ça nous a vraiment motivés pour continuer.
Donc en 87 sort “Rien qu’en traînant”, c’est toujours autoproduit ?
Benoît : Oui, toujours avec New Rose et Patrick Mathé. C’était plus qu’une distribution avec lui, il nous avançait le coût de la fabrication, c’est quelqu’un de bien qui à l’époque était incontournable, c’était le meilleur label français et son petit magasin à Paris était réputé.
Comment qualifierais-tu le tournant musical sur l’album “Rien qu’en traînant” ?
Benoît : Il y a une approche plus soul, plus reggae, avec malgré tout des musiciens et des énergies issus du punk. Il y a quand même plein de gens qui ont bien aimé… Évolution, ouverture ? J’étais dans le doute quand Gilles est parti, je me suis dit : “putain, quelle légitimité on a ?”. Ça m’a déstabilisé, et c’est ça qui a aussi fait que c’est allé en déclinant… En tout cas, d’un point de vue strictement musical, on s’est mis à écouter plein de choses différentes. J’y croyais de moins en moins, nos concerts étaient aussi moins bons, on a également eu beaucoup de problèmes personnels… On ne peut pas dire non plus qu’on était des bêtes de scène, même quand Gilles était là… Et puis avec cette musique peut-être qu’on pétait plus haut que notre derrière ! (quoique…) On pouvait jouer du punk, de la Oi !, mais après, quand il fallait attaquer des registres soul ou reggae on était un peu plus justes, mais au fond c’est aussi ce qui a fait notre particularité. En plus, comme il fallait que je chante et que je joue de la guitare en même temps, ça a commencé à faire beaucoup… Plus les états d’âme de chacun, (soupir), au bout d’un moment j’ai saturé…
Comment a été reçu l’album, ça a dû surprendre beaucoup de gens ?
Benoît : Oui, bien sûr. Il y en a qui ont bien accepté la transition, d’autres non. C’est normal, il y a des groupes que j’aime bien et je n’adhère pas à toute leur discographie, ça dépend du feeling de chacun.
Vous splittez un an après pour les raisons que tu as évoquées plus haut ?
Benoît : Sans doute, moins d’enthousiasme et moins de fraîcheur… Avec beaucoup de galères, une espèce de grande fatigue…
Pour clore cette interview je vais te donner des titres de vos morceaux :
SQUATT ? C’est un morceau qui parle d’un de nos fidèles potes, Claude, ça décrivait l’univers dans lequel il vivait et dans lequel on a vécu parce qu’à un moment donné on a habité ensemble.
RÉALITÉ ?
Réalité décrit nos histoires entre la rue, l’ennui et la drogue.
POUR LA GLOIRE ?
C’était comme un clin d’œil, c’est le morceau que j’ai écrit le plus vite. C’était un truc fédérateur, en référence aux compilations Oi ! et tous leurs gros refrains.
Avec peut-être plus de second degré ?
Oui Pour la gloire c’est second degré. Quand tu dis que tu fais quelque chose pour la gloire c’est tout le contraire. Il y a un côté rigolo. Ça a été quand même largement pris au premier degré ? Je ne sais pas, on le prend comme on veut. Dans nos textes il y a souvent pas mal de choses qui ont plusieurs sens… IDENTITÉ ? Identité c’est un texte qui parle de notre culture, de nos potes, de nos valeurs…
Du quotidien ?
La plupart de nos textes parlent de notre quotidien.
COMME HIER ?
C’est un morceau charnière justement qui parle déjà de notre passé. C’est nous qui parlons de nous, en nous regardant.
ESPOIRS DÉÇUS ?
C’est un morceau qu’a écrit Éric sur la guerre d’Espagne. À Bordeaux, il y a une grande communauté de réfugiés espagnols. Il y a un quartier qui s’appelle Saint-Michel dont le morceau parle. C’est un quartier où l’on a traîné souvent…
Pour terminer, tu veux parler d’un morceau en particulier ?
Pas spécialement, les morceaux parlent d’eux-mêmes…