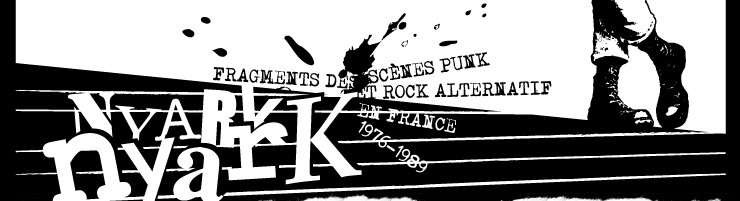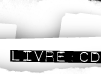Gougnaf Mouvement, c’est une histoire de banlieusards ?
Mortback : Avant Gougnaf, je jouais dans un groupe qui s’appelait Kolérat. On traînait avec le groupe 13e Section, et en 1982-83 on a rencontré Rico Maldoror qui est à l’initiative de Gougnaf. On a commencé par monter une association qui regroupait des groupes du coin, autour d’un fanzine, “La banlieue des machiavels“ qui au bout de trois numéros allait devenir : “Les
 héros du peuple sont immortels”. On organisait aussi des concerts, principalement sur Juvisy. La suite logique a été de rapidement monter un label, parce qu’à l’époque il y avait très peu d’infrastructures. Pour nos groupes, bien sûr, mais aussi et surtout pour tous les groupes qu’on rencontrait via le fanzine, via les concerts, et dont personne ne s’occupait. Le but, c’était de tout faire par nous-mêmes. L’autoproduction c’était aussi une revendication de liberté, pouvoir tout maîtriser de A à Z, sans rien demander à personne.
Rapidement je me suis retrouvé un peu rédacteur en chef des “Héros du peuple sont immortels”.
héros du peuple sont immortels”. On organisait aussi des concerts, principalement sur Juvisy. La suite logique a été de rapidement monter un label, parce qu’à l’époque il y avait très peu d’infrastructures. Pour nos groupes, bien sûr, mais aussi et surtout pour tous les groupes qu’on rencontrait via le fanzine, via les concerts, et dont personne ne s’occupait. Le but, c’était de tout faire par nous-mêmes. L’autoproduction c’était aussi une revendication de liberté, pouvoir tout maîtriser de A à Z, sans rien demander à personne.
Rapidement je me suis retrouvé un peu rédacteur en chef des “Héros du peuple sont immortels”.
 Géant-Vert : Gougnaf, ça se passe dans l’Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang sur Orge, Juvisy… Ils nous ont fait jouer là-dedans [avec Parabellum, NDA], à Juvisy. Et je comprends que les mecs aient eu envie de faire ça, qu’ils en aient eu marre de se faire chier dans une banlieue paumée… Les mecs avaient le choix, le samedi soir, d’aller à l’Ambassy Club écouter de la disco, ou… créer Gougnaf Mouvement ! On ne peut pas leur en vouloir, d’avoir eu, une fois dans leur vie, un trait de génie !
Au début, c’était un fanzine, ils organisaient des concerts… Ils faisaient plein de choses. C’étaient des jeunes, bourrés d’hormones, ils ne savaient pas trop quoi en faire, mais ils le faisaient. Ils prenaient des contacts, ils sortaient de leur banlieue, ils se faisaient connaître… Il y avait une énergie énorme dans cette dizaine de personnes.
Géant-Vert : Gougnaf, ça se passe dans l’Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang sur Orge, Juvisy… Ils nous ont fait jouer là-dedans [avec Parabellum, NDA], à Juvisy. Et je comprends que les mecs aient eu envie de faire ça, qu’ils en aient eu marre de se faire chier dans une banlieue paumée… Les mecs avaient le choix, le samedi soir, d’aller à l’Ambassy Club écouter de la disco, ou… créer Gougnaf Mouvement ! On ne peut pas leur en vouloir, d’avoir eu, une fois dans leur vie, un trait de génie !
Au début, c’était un fanzine, ils organisaient des concerts… Ils faisaient plein de choses. C’étaient des jeunes, bourrés d’hormones, ils ne savaient pas trop quoi en faire, mais ils le faisaient. Ils prenaient des contacts, ils sortaient de leur banlieue, ils se faisaient connaître… Il y avait une énergie énorme dans cette dizaine de personnes.
Peux-tu nous présenter le fanzine ?
Mortback : On voulait parler de tout ce qui concernait le rock indépendan de manière très large, on parlait même de B.D. On connaissait des graphistes, notamment Mattt Konture, qui faisaient des pochettes de disques et chaque numéro était illustré par un graphiste particulier. Le but était de parler de musique, de tout ce qu’il y avait autour, mais aussi de politique. Enfin, au sens social du terme puisqu’on parlait de groupes assez revendicatifs, de tout ce qui était alternatif. À la fin, on essayait de passer au format magazine, plus que fanzine. Au début c’était de la photocopie et sur la fin de l’imprimerie.
 Avec la fameuse maquette bleue ?
Avec la fameuse maquette bleue ?
Mortback : Voilà, c’est ça. Le titre avait une signification, une symbolique. Rico était quelqu’un de très politisé, il avait fait partie de mouvements étudiants, il considérait que les groupes de rock étaient des héros du peuple. On n’était pas spécialisés sur un genre de musique, le punk par exemple. C’était plus large, ça allait par exemple de groupes très rock, comme les Hot Pants, jusqu’à des groupes de reggae, comme les Babylon Fighters… On avait aussi la revendication de la banlieue. On était tous en banlieue sud. Il se passait des choses à Paris, dans les grandes villes en province, et nous on voulait revendiquer notre identité de banlieusards. Il y avait une identité culturelle en banlieue qui n’était pas représentée. On était bien sûr en contact avec des parisiens, Bondage, New Wave, mais on voulait faire reconnaître le fait qu’il se passait aussi des choses en banlieue. On partait du principe que personne ne connaissait la banlieue. Les gens de province allaient à Paris, les gens de Paris allaient en province, mais personne ne s’arrêtait en banlieue. À part les banlieusards…
Quel était l’état de la scène en banlieue, au début des années 80 ?
Mortback : Il y a toujours eu plein de petits groupes. À Juvisy, il y avait une salle de répétition ouverte par la mairie, il y avait aussi le CAES, qui était une espèce de squat au départ, qui organisait beaucoup de concerts. Au niveau des groupes je peux te citer Kolérat, 13° section, les Brigades, Laid Thénardier, Charnier, la moitié des Cadavres… Et plein de petits groupes pas forcément connus.
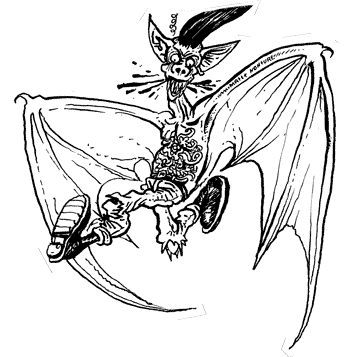 Qui était dans l’équipe Gougnaf ?
Qui était dans l’équipe Gougnaf ?
Mortback : Il y avait Rico, qui a monté le projet, Christian, qui après est devenu manager des Thugs et ensuite des Shériffs, les membres de 13° section et toute une bande de potes qui participaient pour donner un coup de main. Je peux citer en vrac, au risque d’en oublier : Kasquette, Martin, Gaële, Juliette, Dgin, JC Menu, Mattt Konture… Géant-Vert est venu plus tard, quand on a signé Parabellum, il y avait aussi beaucoup de collaborations ponctuelles, qui se faisaient au coup par coup. On était assez nombreux, certains donnaient des coups de mains sur le fanzine, d’autres sur les concerts, c’était un vrai collectif qui se construisait au hasard des rencontres. On a décidé de monter le label assez rapidement. On a commencé en faisant des cassettes, les premiers disques qu’on a sortis sont un maxi d’Ultraviolet, et un 45 tours des Thugs. Tout était intégralement autoproduit, au début on faisait tout nous-mêmes : la distribution, les pochettes, la mise en forme, les envois… À l’époque, il n’y avait pas internet, c’était du mailing, du téléphone… En province, il y avait tout un réseau, on voulait faire un truc global, on faisait des échanges, on distribuait tous les labels indépendants. Au départ, c’était surtout ça l’activité du label, et puis petit à petit, on en est venu à la production. Notre but c’était de faire connaître les groupes qu’on aimait bien, et de faire des échanges avec la province. On accueillait des groupes, et eux en échange nous trouvaient des plans pour les groupes locaux. À l’époque il existait un petit réseau, avec Nineteen [fanzine toulousain, NDA], Clermont Ferrand, Angers par le biais des Thugs, Montpellier, des petits disquaires indépendants, des petites assos. Quand on rencontrait des gens avec qui on accrochait, on travaillait ensemble. Sans contrat, bien sûr, ce n’était pas du tout pro au départ… C’était plutôt artisanal, mais ça demandait vachement de boulot, puisqu’il fallait tout faire. Par la suite, on a trouvé un distributeur, c’est devenu un peu plus structuré. Après, ça s‘est développé parce qu’on commençait à vendre.
Vous aviez quand même de belles références ?
Mortback : Oui, les Thugs, Parabellum, Hot Pants, les Rats qui venaient de Montreau, les Shériffs, les Mescaleros…
 Il y a aussi la compilation “Les héros du peuple sont immortels” ?
Il y a aussi la compilation “Les héros du peuple sont immortels” ?
Mortback : Ça a été le gros démarrage du label. Jusque là, on n’avait sorti que des 45 tours… On a réussi à rassembler un paquet de groupes pour cette compile. Ça a été vraiment le gros projet, à la base de Rico, qui voulait faire une compilation assez large, rassembler les groupes du moment qu’on aimait, rassembler différents styles, différentes régions. Faire un état des lieux… C’était un beau projet, il n’y en a pas eu 10.000 comme ça… C’était vraiment un lien entre le punk et le rock, avec un esprit alternatif.
C’était quoi pour vous l’esprit alternatif ? Mortback : Ne dépendre de personne, surtout pas des majors, tout maîtriser, éviter les rouages du bizness. Et surtout faire découvrir des groupes sans rien demander à personne, une indépendance totale. Cette compile nous a permis de faire vraiment fonctionner le label, de nous faire connaître, de signer plus de groupe, est d’être un peu plus “pro”… Même si on a toujours eu un fonctionnement un peu chaotique.
Par exemple ?
Mortback : Au niveau de l’argent par exemple, pour sortir un disque au début, on faisait des souscriptions, les copains de copains qui mettaient de l’argent. Et tout le monde n’a pas récupéré son argent… La gestion était centralisée par Rico, qui était le seul à faire ça à plein-temps, et à vivre un peu de ça… Des fois ça a été un peu galère, il y a eu des petites histoires… Pour faire fonctionner le label, comme on était en asso, on employait des TUC. On s’auto employait…
 Comment se faisait le choix des groupes ?
Comment se faisait le choix des groupes ?
Mortback : Chacun amenait les groupes qu’il aimait bien, on se réunissait, on en discutait. On rencontrait aussi beaucoup les gens, pour voir si ça collait ou non. On travaillait aussi beaucoup avec Kronchtadt Tapes. Rico allait en province, et comme on organisait beaucoup de concerts, on rencontrait pas mal de gens. On organisait les concerts de A à Z, à Morsang, Juvisy. À l’époque, on n’avait pas de service d’ordre, donc on a eu beaucoup de problèmes avec les skins. Il y a eu quelques épisodes assez chauds… C’était limite Fort Alamo, barricadés dans les loges avec les Rats… Par la suite, des autonomes sont venus nous aider, et des gars comme François Hadji-Lazaro, Géant-Vert…
Comment travailliez-vous avec eux ?
Mortback : On essayait d’impliquer un maximum les gens sur le label. Comme on faisait tout nous-mêmes il n’y avait pas d’un côté le label et de l’autre les groupes. On voulait que les groupes s’investissent dans le fonctionnement du collectif. On ne voulait pas être une maison de disques classique. On développait du coup des relations amicales et de partenariat. Ce qui était intéressant, c’était de faire des choses ensemble.
Qu’est-ce que c’était pour toi, être punk ?
Mortback : C’est ce qui m’a permis de me sentir bien… Un côté différent, évidemment rebelle, indépendant, ne pas ressembler à tout le monde… Une façon d’exister… Faire tout par soi-même, vivre un peu en dehors du système… Et puis c’était riche, il y avait des gens qui faisaient du graphisme, des bouquins, il y avait tout un esprit. L’esprit punk était dans la musique, mais pas uniquement. C’était une façon de voir les choses, une façon non naïve de voir le monde dans lequel on était, un peu cynique mais pas naïve comme les hippies. Avec une vision politique, autonome, on pouvait faire ce qu’on voulait !
En 1986, Rico part à Angers ?
Mortback : Moi je n’ai pas suivi, mais par contre j’ai continué à faire le fanzine, “Les héros du peuple sont immortels”. On est resté en contact, au début il y avait une antenne Gougnaf sur Paris, mais j’ai vite arrêté…
Pourquoi ce nom ?
Mortback : Ça aussi, ça vient de Rico. À l’époque on avait inventé un langage, le “Wardéné language”. Un langage de banlieue, quand on était pétés on déconnait. Et on avait ressorti des vieilles insultes comme gougnafier. C’était des insultes entre nous, gougnaf, wardené… Et on les a utilisées. Wardené, c’est devenu une feuille de choux, qui sortait tous les 15 jours, en plus du fanzine. On essayait toujours de trouver des plans. Des mecs qui bossaient à la mairie pour l’imprimerie, des photocopies à droite à gauche… C’était vraiment de bric et de broc, ce qui permettait de faire un truc de qualité sans trop de moyens. C’était vraiment de la démerde, c’est ça qui était rigolo aussi !