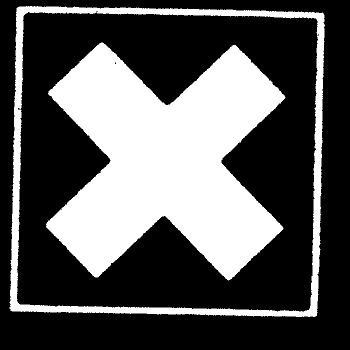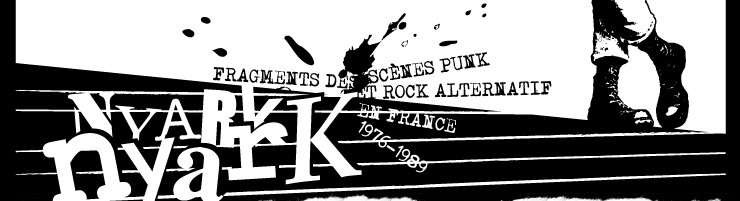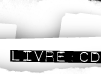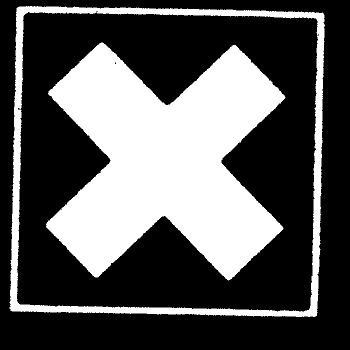 François : La préhistoire de Bérurier se passe à Paris et beaucoup en banlieue, on peut la dater à 1977-78. En 77, j’étais sur Paris et j’étais au courant de ce qui se passait dans le microcosme punk anglais. Il y avait déjà un petit comité de punks qui traînait dans la rue, à cette époque. Notamment autour de ce gros chantier qu’étaient les halles, qui était un point de rencontre entre des gens de tous bords qui venaient de milieux un peu déclassés, marginalisés ou artys. Il y avait ainsi une convergence des gens de la banlieue, pour ce que j’en connais, vers des points de rencontre comme la boutique Harry Cover, Music Box qui était sur Odéon, Music’Action, et d’autres boutiques comme Outrage. Là, je n’y suis allé qu’une seule fois, je devais avoir 15 ans à l’époque.
François : La préhistoire de Bérurier se passe à Paris et beaucoup en banlieue, on peut la dater à 1977-78. En 77, j’étais sur Paris et j’étais au courant de ce qui se passait dans le microcosme punk anglais. Il y avait déjà un petit comité de punks qui traînait dans la rue, à cette époque. Notamment autour de ce gros chantier qu’étaient les halles, qui était un point de rencontre entre des gens de tous bords qui venaient de milieux un peu déclassés, marginalisés ou artys. Il y avait ainsi une convergence des gens de la banlieue, pour ce que j’en connais, vers des points de rencontre comme la boutique Harry Cover, Music Box qui était sur Odéon, Music’Action, et d’autres boutiques comme Outrage. Là, je n’y suis allé qu’une seule fois, je devais avoir 15 ans à l’époque.
Loran : J’étais à l’école De Croly, une école publique, laïque. C’est un médecin qui avait monté ça, une méthode pour les enfants autistes, qui s’est avérée être bonne pour tous. J’avais 13 ans, tous les grands de 15 ans étaient punks. Et c’est là que j’ai fait mon premier concert, avec un groupe qui s’appelait Cadenas Rock. C’est marrant parce qu’on était déjà deux, une guitare et une batterie. On avait programmé le concert et je n’avais jamais joué de gratte. Une semaine avant le concert il fallait que je trouve une guitare, ma mère m’a avancé 300 francs, il me restait deux ou trois jours pour apprendre… J’ai appris deux ou trois accords, et l’on a fait une demi-heure de concert. Tout le monde était surpris et disait que c’était bien. Ça m’a montré que ce qui compte avant tout, ce n’est pas de savoir jouer, c’est ce qui m’a plus dans le punk, c’est l’émotion que tu fais passer.
Laul : Moi, le souvenir que j’en ai, à l’époque, dans les boîtes à bachot, c’est pas mal de mecs qui devenaient keupons parce que l’influence était là, vu qu’il n’y avait rien d’autre. Dans les écoles de dessin ça commençait à devenir comme des boutons d’acné, un par-ci, par-là… Et du coup, les punks, c’étaient des individus, des mecs un par un. Et quand tu en croisais un, tu avais une espèce de respect pour le culot qu’il avait de le faire. Parce que c’était plein de rockers, et qu’on menaçait de se faire péter la gueule à chaque changement de métro. Et dès qu’on se retrouvait, il y avait une espèce de petit soutien. Ça faisait des petites bandes, la petite bande du Luxembourg, la petite de bande de Nation. Et dès fois, quand un mec comme Marsu disait : “ tiens, il y a un plan teuf, mais il faut aller voir machin, qui va nous emmener chez bidule…”, c’est là que se faisaient des connexions. Donc c’était un tout petit réseau, qui finissait par faire des grosses bandes, on pouvait se retrouver à 50.
On écoutait du rock’a’billy, et on jouait une musique dépressive qui était plutôt proche du punk.
Comment rentrez-vous dans la musique ?
François : C’est le culot, le culot. Je crois qu’il n’y a pas eu de réflexion au départ. Pour Bérurier, il y avait les anciens Bérus, avec lesquels j’avais officié en 80. Loran nous a rejoints, parce qu’Olaf était parti à l’armée, en Allemagne. Pierrot qui était le deuxième guitariste avait eu lui des problèmes d’alcoolisme, il avait été en cure de désinto, il était après parti chez les paras d’où il avait déserté, toute une série de problèmes qui lui ont collé à la peau pendant longtemps, je pense… Les anciens Bérus [Béruriers, NDA] étaient partis sur une base de loubards de banlieue, parce qu’en fait notre culture musicale est passée de la musique classique à Eddy Cochran, Pistols, sans passer par les Rolling Stones, les Beatles, les Deep Purple ou je ne sais quoi. Les anciens Bérus c’était un truc bizarre, un malaise avant tout. On écoutait du rock’a’billy, et on jouait une musique dépressive qui était plutôt proche du punk. Et on avait un following qui était plutôt rockabilly, plutôt des loubards. Quand j’ai rejoint le groupe, il était composé de Barthérifiant (Barthélemy), de son petit frère, de Pierrot, d’Olaf, et de Mathieu Szpiro, qui après a rejoint Guernica. Là, on est en 1978. On se connaissait un peu, j’ai rejoint le groupe en 1980 en tant que chanteur.
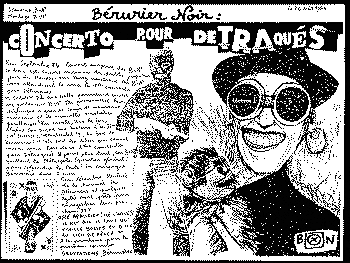 Loran : Les Bérurier sont venu jouer à De Croly. Je n’avais pas de très bons rapports avec eux, je m’étais pris un coup de boule par un des membres du groupe qui m’avait traité de sale hippie. Ils avaient un morceau que je n’aimais pas du tout “mort aux hippies, les Hells sont avec nous”… Super provo…
Loran : Les Bérurier sont venu jouer à De Croly. Je n’avais pas de très bons rapports avec eux, je m’étais pris un coup de boule par un des membres du groupe qui m’avait traité de sale hippie. Ils avaient un morceau que je n’aimais pas du tout “mort aux hippies, les Hells sont avec nous”… Super provo…
François : Le groupe n’avait pas encore de boîte à rythmes, c’était Barthérifiant qui officiait à la batterie. Ensuite le groupe se remodifie, on est resté à trois, avec deux guitaristes, un chanteur, c’est vraiment la première version pré-Bérurier, avec Olaf, Pierrot, moi et la boîte à rythmes, la fameuse DRM 16.
Laul : C’est à cette époque que j’ai vu mes premiers concerts Bérurier.
François : On n’a pas joué souvent. En 82 au squat des Vilins, et rue Bourbon, pour la fête de la musique. Fin 82 on joue place Monge. Il y a eu deux concerts vraiment importants pour les anciens Bérus, celui du squat des Cascades, et cette espèce de festival en plein air, rue des Vilins, qui s’est terminé en baston générale, avec Mass, La Souris Déglinguée… Ça a un peu dégénéré, il y avait beaucoup d’alcool et tout ça s’est terminé en feu de camp et en bastons. Ce sont les deux seuls concerts qui ont été faits, il me semble, avec la formation Pierrot, Olaf et moi-même.
Laul : C’étaient des concerts où l’entrée était à prix libre, tu donnais ce que tu pouvais, et la canette, c’était pareil… Fallait faire de la monnaie avant de venir…
François : Là, Loran faisait des remplacements… Les Bérus se sont construits sur ce truc-là, quand Olaf a décidé de démissionner du groupe, et que Pierrot était déjà “hors-service“. Loran et moi on a repris le groupe pour faire un concert unique, un concert de deuil des anciens Béruriers, c’était le fameux concert de Pali-Kao, qui a débouché… sur cette aventure.
Laul : C’est là qu’on a dit : “ce n’est pas le dernier, c’est le premier”. Ce concert Bérurier… Noir, d’adieu, c’était le meilleur concert Béru qu’on ait jamais vu.
C’est Bérurier Noir qui joue pour ce concert d’adieu ?
François : C’est Bérurier Noir.
Laul : C’était le titre du concert d’adieu.
François : C’est Loran qui est à la guitare, Pierrot, Laul et Helno nous ont rejoint sur scène, et c’est le premier concert, l’acte fondateur de Bérurier Noir. Et le suicide de Bérurier.
Comment est-ce que le concert de Pali-Kao se transforme de suicide en naissance ?
François : Un peu par hasard. Il était très dur de jouer sur Paris. Pali-Kao était un lieu artistique, et le gars a posé ses conditions. On avait fait une série de trucs artys avant, il y avait déjà eu l’organisation de spectacles-performances et le gars a dit : “bon, Bérurier Noir c’est sympa mais je veux une performance, je ne suis pas une salle de concert classique, il est hors de question de faire passer un groupe rock “normal“, stéréotypé”… Donc il a fallu trouver une idée, elle était petite. C’était d’avoir une exposition de peintures et d’oeuvres artistiques faites par des amis, et nous, d’avoir une attitude théâtrale sur scène. C’est là que j’ai inventé cette valise, avec du matos dedans, et les masques ont été intégrés au spectacle un peu par hasard et par obligation… Mais ceci dit, c’était quelque chose qui nous tentait. On avait envie de créer une espèce de “Théâtre de Force”, comme on appelait ça avec Loran. Essayer de faire quelque chose de percutant avec nos moyens qui étaient réduits… Avant ça, avec Bérurier, on avait déjà fait exploser un poulet, acheté en supermarché, bien entendu, pas un poulet vivant…
Loran : Moi je ne savais même pas que François allait mettre des masques, je ne savais rien… Avant de faire ce premier concert, il y a eu deux répétitions de deux heures…
Mais les morceaux existaient déjà ?
Loran : François avait amené plein de nouveaux textes et j’ai réarrangé tous les morceaux. C’était très minimaliste, en quatre heures tu ne peux pas faire un opéra… Et c’était à moitié de l’impro ce concert.
Laul : A Pali-Kao, les groupes étaient obligés de faire une mise en scène. Je crois que c’est les Burial Party, qui avaient lâché 5.000 mouches… Ils avaient acheté des asticots trois semaines avant… pénible pour danser… C’étaient des pauvres trucs, mais c’était keupon…
François : C’était un lieu très avant-gardiste, qui n’existe plus maintenant, où quasiment tout était permis.
Laul : Et là on était dans la salle, avec Lucrate et d’autres, on a bien halluciné, on avait envie de jouer. De jouer la même chose, de jouer avec. On ne s‘est pas imposé tout de suite, mais on leur a dit : “là, il ne faut pas vous arrêter, nous on vous accompagne”.
François : C’est vrai qu’il y a eu une demande. Avec Loran, on ne savait pas trop quoi faire. Lui était déjà en dissidence avec Guernica, il y avait des histoires de jalousie vu qu’il jouait avec moi et qu’en même temps c’était le guitariste officiel de Guernica. Il y avait des tensions, et au bout d‘un moment il a claqué la porte de Guernica, et il a dit : “on continue comme ça !” Ça s’est vraiment fait à l’arrache et un peu par hasard. À l’époque, je venais d’un milieu éclaté… Et Loran, alors que j’étais encore au lycée, travaillait déjà à l’usine…
Laul : D’où son son un petit peu industriel…
Et donc la troupe Béru est née à ce moment-là ?
François : Non, uniquement le duo Béru de départ. Laul : Ça s’est fait… Un peu n’importe comment… La veille, on savait qu’il y avait un concert le lendemain, il y avait une voiture, on pouvait mettre deux personnes, c’était une fois Paulo et Helno, une fois Nénesse et le chien, c’était n’importe quoi. Il n’y avait pas une vraie troupe, puisqu’il n’y avait pas de logistique. Mais si on pouvait avoir une bagnole, on suivait, et si on était là, on montait sur scène, ou pas. Et si François en avait envie, il nous prêtait un masque, sinon il nous claquait le beignet tout de suite…
François : C’était un following… Très souvent, il ne se passait pas grand-chose au début du concert, mais une fois qu’ils étaient bien torchés, les deux, ils occupaient la scène de façon intensive… Rires… et ils finissaient le concert.
Vous décidez donc après le premier concert de continuer sur cette idée ? François : On a décidé de continuer, mais pas de façon intensive, on ne s’est pas dit : “on va faire un groupe”… On a décroché un concert à Tours, c’était le deuxième, avec Foutre, qui étaient les Sex Pistols locaux. Et ensuite un troisième concert, qui était important puisque c’était celui de la salle de la Roquette, avec Lucrate Milk, les Maîtres, tous les groupes importants de la scène… Il y avait un défilé de mode sur scène entre les groupes… Ce concert était organisé par Art Béton, dans lequel se retrouvaient des gens du sud de la France, Didier Talagrand, qui a réalisé le premier clip des Bérus, Mélino, qui après a joué avec les Négresses vertes…
Laul : Leur truc, c’était : “Vive l’Action”, et c’est vrai que ça le faisait, il suffisait de le faire !
François : Ça a eu un impact, c’était dans Paris, et il y a eu 1.000 personnes, ce qui montrait qu’il y avait une demande de concerts assez forte… Peut-être que si on avait continué à faire des petits concerts on aurait arrêté, mais le fait que, tout d’un coup il y ait eu cette dimension, ça nous a motivés pour coucher sur bande et sur vinyle ce qu’on était en train de faire.
Là, on est en 83 ?
François : Oui, le 19 février c’est le concert à Pali-Kao, en avril le concert de Tours et en juin le concert de la Roquette. Et pendant l’été, on est en contact avec V.I.S.A. pour essayer de mettre le premier concert sur cassette.
Béru, c’était des personnes, notamment François, qui avaient un gros mal-être. Il avait besoin de le hurler, si ça ne jaillissait pas, ça l’aurait bouffé de l’intérieur.
Musicalement, à cette période, vous êtes sur quelque chose de très sombre ?
Masto : Béru, c’était des personnes, notamment François, qui avaient un gros mal-être. Il avait besoin de le hurler, si ça ne jaillissait pas, ça l’aurait bouffé de l’intérieur.
François : Psychologiquement, à cette époque, je suis très marqué par tout ce qui est psychiatrique. En 82, j’étais en fac aux Beaux-Arts… On était dans une logique artistique, expressionniste, dadaïste aussi, rénové par une couche de noir, de punk… On oscillait entre le dictionnaire médical, qui était bourré de photos terrifiantes, et des dictionnaires d’art contemporain, un peu plus élaborés. Mais tout compte fait ça se recoupait…
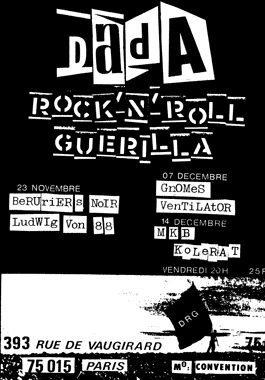 La référence à Dada était-elle consciente ?
La référence à Dada était-elle consciente ?
François : Oui, j’avais un peu baigné dedans, ça m’intéressait beaucoup. Je n’ai jamais lu Tristan Tzara, c’était plus l’imagerie et l’expressionnisme…
Laul : C’est surtout l’imagerie qui nous reliait tous. Fanfan, sa frangine, les gens de Guernica, s’étaient regroupés dans un collectif, Abattoir, et ils m’avaient invité à une exposition, dans une ancienne boucherie transformée en salle d’exposition, et l’on avait pas mal déliré… C’était un peu comme les paroles des Bérus, c’étaient “la viande hurle”, des choses qui ne se disent pas mais qui se ressentent, épidermiques, un truc de frissons, où tu joues avec l’interdit.
Masto : Lucrate et Béru c’était la même raïa. On a participé à des trucs Abattoirs, à faire hurler la viande… Il y a eu un glissement, un croisement,des interférences spontanées entre les deux groupes, dès le début.
François : Oui, c’est vrai. J’avais complètement oublié ça. Là, on est en 1982-83, c’est à cheval entre les Bérurier Noir et avant…
Laul : C’était un peu de la branlette intellectuelle, on n’était pas visité. Mais on se montrait nos trucs, complètement inspirés par le noir blanc. François : On était complètement influencés par Bazooka, par l’impact provo, le visuel facile, cassé, enfin tout ce que faisaient Olivia Clavel, Kiki Picasso dans Libération. Cette provo était intéressante.
François : La première expo d‘Abattoir, c’était “La viande hurle dans ma mémoire”. C’était un sujet autour de la viande, il y en avait qui peignaient des carcasses à la Francis Bacon, ou à la Rembrandt, et on a eu la chance d’avoir une place de choix lors de la Biennale de Paris en 82. On a eu tout un espace sur l’esplanade du centre Georges Pompidou, une espèce de mécène nous a branché… On ne sait pas trop d’où c’est venu… Donc on s’est installé, avec des crocs de bouchers… Ensuite avec Loran et Yves Fedoux, qui a donné par la suite dans la démonstration sadomasochiste, qui est aujourd’hui un artiste confirmé, on a créé une association qui s’appelait “Actes Énergie Perdue”, A.E.P. C’était un peu intellectuelo mais l’acte était intéressant, c’était de dire : l’art, si c’est beau, ça peut être détruit. Yves sculptait très bien, et l’idée était de casser ses structures en direct devant le public. Il y avait un état d’esprit arty-provo.
 Loran : On faisait des happenings. Par exemple, une action commando à Beaubourg. Le problème, c’est qu’à cette époque il y avait un service d’ordre musclé à l’entrée de ce temple pour bobos. Ce service d’ordre était là pour empêcher les gens de la rue de venir se réchauffer auprès des bouquins, ou bien dans les salles de projection, ce qui était l’habitude de toute la faune keupon de l’époque. Donc, comment rentrer pour faire notre happening en plein milieu du hall d’entrée ? Tout à coup, un troupeau de touristes japonais rentre dans Beaubourg. On saute sur l’occase et l’on rentre mélangés aux touristes. Une fois dans le hall, j’installe à l’arrache une cage où je m’enferme, habillé en boucher avec de grosses lunettes noires en bouffant de la viande crue (de récup) à moitié avariée. François dessine une côtelette comme à son habitude (notre thème, à cette époque était “la viande hurle dans ma mémoire”), et le copain sculpteur fait sa big côte de boeuf. Les Japonais étaient ravis, les flashs des appareils photos crépitaient sans interruption. Du coup, les gars du service d’ordre ne savaient pas quoi faire… Nyark nyark !… On avait réussi, nous petits keupons, à prendre d’assaut le monstre de Beaubourg… À la fin, on a détruit notre installation avant de partir en courant, poursuivis par les appareils photo…. Je crois que ces touristes garderont un souvenir délire de leur visite à Paris. Et les gars de Beaubourg n’ont toujours rien compris à ce qu’il s’était passé… C’était ça “Actes Énergie Perdue”…
Loran : On faisait des happenings. Par exemple, une action commando à Beaubourg. Le problème, c’est qu’à cette époque il y avait un service d’ordre musclé à l’entrée de ce temple pour bobos. Ce service d’ordre était là pour empêcher les gens de la rue de venir se réchauffer auprès des bouquins, ou bien dans les salles de projection, ce qui était l’habitude de toute la faune keupon de l’époque. Donc, comment rentrer pour faire notre happening en plein milieu du hall d’entrée ? Tout à coup, un troupeau de touristes japonais rentre dans Beaubourg. On saute sur l’occase et l’on rentre mélangés aux touristes. Une fois dans le hall, j’installe à l’arrache une cage où je m’enferme, habillé en boucher avec de grosses lunettes noires en bouffant de la viande crue (de récup) à moitié avariée. François dessine une côtelette comme à son habitude (notre thème, à cette époque était “la viande hurle dans ma mémoire”), et le copain sculpteur fait sa big côte de boeuf. Les Japonais étaient ravis, les flashs des appareils photos crépitaient sans interruption. Du coup, les gars du service d’ordre ne savaient pas quoi faire… Nyark nyark !… On avait réussi, nous petits keupons, à prendre d’assaut le monstre de Beaubourg… À la fin, on a détruit notre installation avant de partir en courant, poursuivis par les appareils photo…. Je crois que ces touristes garderont un souvenir délire de leur visite à Paris. Et les gars de Beaubourg n’ont toujours rien compris à ce qu’il s’était passé… C’était ça “Actes Énergie Perdue”…
Laul : En dehors du côté traumatisé, carcéral, viscéral, cérébral et tout ça, il y avait le côté on est des gamins, et on s’amuse comme des sales gosses.
François : C’étaient “Les 400 coups” de Truffaut.
Laul : C’était en noir et blanc… Moi je sais que j’ai bêtement fait ma communion, et des tas de trucs comme on m’a dit, et c’est à 15, 16, 17 ans que c’est parti… C’est parti à donf… Comme un élastique que tu as trop tiré… Donc là, tout était permis, tu étais naturiste, ou en pyjama toute la journée, avec la cervelle sur l’oreille et ça ne faisait chier personne…
Dans les paroles, on a le côté viande (les prémices de porcherie ?) et une autre thématique forte est celle de l’enfermement, notamment psychiatrique ?
François : C’est très lié à l’histoire des anciens Bérus, notamment au parcours suicidaire de Pierrot. J’étais allé le voir en maison de désintoxication. Tous les jeunes qui étaient là-bas devaient à peine avoir plus de 20 ans, mais ils en paraissaient plus de 50, ils tremblaient et bavaient en mangeant, ils étaient dans un univers tout à fait flippant…
Laul : Comme on l’a déjà dit, c’étaient des trucs très individuels au début, et quand tu es solitaire, c’est une espèce d’enfermement, d’isolement aussi. Quand tu es tout seul, tu cogites : à quoi je ressemble, comment je suis vu… Ce n’est pas de se montrer, mais d’être perçu, avant tout… Et quand tu cogites, avec le whisky et tout le reste, des fois tu cogites mal.
Loran : François a été mon “maître” au niveau intellectuel. Je suis parti de chez moi assez tôt, à 14 ans j’étais déjà dans la rue, à droite à gauche, chez des potes… J’ai été recueilli par la mère de François, qui était super cool, j’ai habité beaucoup de temps chez eux… Plein de morceaux, tout Macadam Massacre s’est fait dans sa piaule. Il me faisait des lectures… J’ai été instruit par lui. C’était mon grand frère, mon meilleur ami, on était un peu comme un couple. C’est ça Béru… Et comme dans un couple, on pouvait se haïr et s’aimer en même temps. Des fois, on s’engueulait sur scène… Après, la troupe a un peu servi de tampon à ça.
François : D’un autre côté, la rencontre avec d’autres a permis d’échapper au suicide. J’aurais pu me jeter du dixième étage où on était, sans aucun recul, avec même…
Laul : Un peu d’élan ?
François : Pour nous, 21 ans, c’était un peu la date limite donnée par Sid Vicious… Le premier album, c’est le split-album avec Guernica. Là aussi, c’est un genre de mécène, qui a proposé une production à Guernica. On n’était pas très contents du son. On avait fait écouter tout ça à Helno, qui nous avait dit c’est de la merde… Rires… Ça a été enregistré à la campagne, dans un tout petit studio. C’était un enregistrement très rudimentaire, on n’avait pas du tout la structure de ce qui sortait en Angleterre ou aux États-Unis, au niveau musique et surtout au niveau punk, mais ça a surpris les gens. Et ensuite, on s’est lancé dans cette idée de sortir un album. C’est beaucoup dû au fait qu’on ait rencontré Jean Yves Prieur, alias Kid Bravo, qui jouait avec The Brigades, et Philippe Baïa qui avait produit leur premier album. Par leur entremise, on est rentré dans une logique maison de disques, production. Philippe jouait le rôle de producteur, ou plus exactement de mécène. Tout se faisait avec nous, on a eu des discussions très précises sur le son qu’on voulait avoir… On a enregistré “Macadam Massacre” à Evry au studio Anagram, fin 83. Il est sorti en 84. Là, on a mis tout le répertoire banlieue que je continuais à avoir, hérité des anciens Bérus, des morceaux comme Baston, il y a un mélange de trucs anciens Bérus, et purement Bérurier Noir…
Laul : Mais là, on passe déjà un cap, on n’est plus seulement agressés, on devient un peu agressifs !
François : On n’est plus dans la logique révolte individuelle, traumatisme introverti, on est déjà dans la raïa, dans la bande…
Laul : On n’est plus tout seul sur sa mob, on est trois dans une D.S… Rires…
François : Et dans cette D.S. [voir la photo de la pochette, NDA], on retrouve Loran à l’extérieur avec sa guitare, Olive Boy qui était un skin qui faisait de la boxe thaï, Olaf, Vanzo, qui jouait dans un groupe qui s’appelait 1-test-1, un groupe de fous… C’est ma frangine qui a fait cette photo… Et le verso de cette pochette, c’est la première intervention de Laul…
Laul : C’est un souvenir du concert de la Roquette, François qui avait son papier avec les textes, son sabre, et Loran… J’avais fait un dessin de mémoire, je le leur avais donné, et ils m’ont dit que ce serait sur le disque à venir. Ce n’était pas du tout une commande, juste une diapositive.
On retrouve déjà ce son de boîte à rythmes qui va vous caractériser ?
François : Oui, cette boîte qui ne possède que quelques rythmes… Il y a un rythme rock, un rythme funk, un rythme disco, puisque Nada c’est un rythme disco… En gros on avait cinq ou six rythmes, avec des changements de vitesse, c’était très basique, et ça, ça va nous caractériser, puisqu’on va enregistrer à peu près 50 titres avec cette boîte.
Loran : Cette boîte à rythmes était un jouet, avec quatre rythmes, et mes deux fameux accords que je change de sens… Rires… Mais on faisait passer de l’émotion. Et François qui ne connaissait pas ses textes… Parce que c’est un écrivain. Il passe son temps à écrire. Un mec qui écrit, il s’en fout d’apprendre ses textes par cœur. Des fois les gens se foutaient de sa gueule à cause de ça, mais moi je trouvais ça excellent. Justement c’est un bon chanteur, un vrai chanteur.
Le saxo aussi est assez torturé sur cet album ?
Masto : Moi, je ne le vivais pas comme ça, je faisais entre ce que j’aimais et ce que je pouvais… c’était spontané, irréfléchi. Quand Pascal Kung Fu m’a remplacé, pour Concerto pour Détraqué, les parties de sax sont devenues différentes…
Moins il y a de notes mieux je me porte, plus j’entends, plus j’aime. On ne faisait pas beaucoup de répétitions…
Vous sortez donc “Macadam Massacre” sur le label Rock Radicals Records ?
François : Oui, c’était une association loi 1901, donc à but non lucratif… Cet album nous a connecté sur la province. Alors que le premier était plutôt un objet artistique parisien.
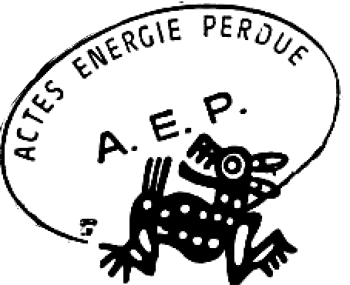 Laul : C’est ce qu’on disait tout à l’heure, sur les individus qui se retrouvaient par rapport à un dégoût… C’était pareil aussi en province, des tas de gens mal dans leur peau, dans leur campagne dans leur bled, soit parce qu’ils étaient pd, soit parce qu’ils étaient… mals, et qui se retrouvaient dans des concerts où il y avait 50, 60 personnes exactement comme eux, c’était fédérateur. Ce n’était pas le premier message, mais c’était le premier constat : tiens, il n’y a que des lourdés, donc je ne suis pas le seul.
Laul : C’est ce qu’on disait tout à l’heure, sur les individus qui se retrouvaient par rapport à un dégoût… C’était pareil aussi en province, des tas de gens mal dans leur peau, dans leur campagne dans leur bled, soit parce qu’ils étaient pd, soit parce qu’ils étaient… mals, et qui se retrouvaient dans des concerts où il y avait 50, 60 personnes exactement comme eux, c’était fédérateur. Ce n’était pas le premier message, mais c’était le premier constat : tiens, il n’y a que des lourdés, donc je ne suis pas le seul.
Loran : On avait ce concept de bande. On a fait des concerts très fort. On avait pris la fac de Tolbiac d’assaut. Avec la bande à autonomes, on était rentré dans un amphi, on avait foutu le prof dehors et on avait joué. On savait que les flics ne pouvaient pas rentrer dans la fac… Le fait d’être deux faisait qu’on était hyper mobiles… Avec un petit ampli, la boîte à rythme… Toujours ce concept de guérilla…
À l’époque vous avez conscience de l’existence d’une scène en France ?
François : En 1984-85, pas encore. Il n’y avait, de fait, pas grand-chose. On avait conscience de quoi ? Effectivement qu’il y avait des marginaux, et des gens marginalisés, des jeunes qui se cherchaient…
Ensuite, en 1984, vous sortez le 45 tour “Nada 84” ?
François : Il se trouve qu’à cette époque, Helno avait un petit singe. On voulait réenregistrer ce morceau avec le singe, un peu dans un esprit libération animale… On a eu envie de recoller ces trois bouts qui avaient été séparés, puisque Nada au départ était un morceau linéaire, qui n’était pas découpé. Il a été découpé dans un certain concept, pour en faire le fil conducteur de la face Béru sur le split LP avec Guernica, et on a voulu le recomposer.
Loran : Ce disque là, il a été fait en une journée sur un huit pistes, ça coûtait 800 francs. Pour le payer, on avait vendu des fringues de la grand-mère de François aux puces.
François : Sur le dos de ce 45 tours, il y a le fameux concert en 1984 au forum des Halles, avec Poison Girl, où l’on s’est fait voler notre première boîte à rythmes, la fameuse Dédé, qui a disparu de scène juste avant le concert. Ça nous avait rendus furieux, c’était un peu l’hystérie…
Laul : C’est Gaboni, batteur de Lucrate, qui a remplacé la boîte à rythmes. De toute façon, ça aurait été une émeute si le concert n’avait pas eu lieu.
François : C’était chaotique, on a très mal joué…
Laul : On a eu le fin mot de l’histoire récemment, c’était un mec qui, pour un pari, pour une espèce de bizutage d’école de commerce avait eu un truc à faire, et lui avait choisi de voler la boîte à rythmes des Bérus…
François : Heureusement qu’il ne s’est pas fait chopper à l’époque, parce qu’il aurait été lynché…
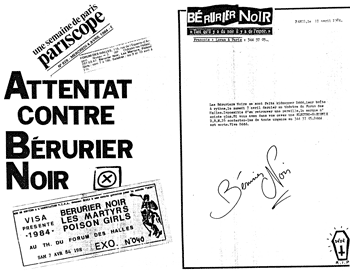 Laul : Maintenant, c’est marrant que ce soit une blague, et pas un attentat…
François : Alors évidemment, nous, on a mis en marche notre officine de propagande. On a mis en marche notre système de parano et de défense, pour montrer que les Bérurier Noir, qui décrassent le système, étaient la cible de forces occultes, c’était le démarrage d’une politisation… Rires… Mais ce n’était pas infondé. On venait d’un milieu de squats, notamment les Vilins, d’autres squats avaient été cassés par les flics, il y avait eu des liens avec Action Directe, il y avait beaucoup d’embrouilles, des balances. Donc on venait d’un milieu, les Vilins, les Cascades, Botzaris, un milieu autonome, qui était incontrôlable, et qui pouvait déranger politiquement.
Laul : Maintenant, c’est marrant que ce soit une blague, et pas un attentat…
François : Alors évidemment, nous, on a mis en marche notre officine de propagande. On a mis en marche notre système de parano et de défense, pour montrer que les Bérurier Noir, qui décrassent le système, étaient la cible de forces occultes, c’était le démarrage d’une politisation… Rires… Mais ce n’était pas infondé. On venait d’un milieu de squats, notamment les Vilins, d’autres squats avaient été cassés par les flics, il y avait eu des liens avec Action Directe, il y avait beaucoup d’embrouilles, des balances. Donc on venait d’un milieu, les Vilins, les Cascades, Botzaris, un milieu autonome, qui était incontrôlable, et qui pouvait déranger politiquement.
Laul : En plus tu avais des titres de fanzines, le genre “contre l’État : Pan ! dans la gueule”… Des trucs qui marquent un peu, avec une imagerie… rebelle…
François : Ça c’était un des premiers tracts de Bérurier Noir : “contre l’État : Pan ! dans la gueule”… Avec cet autonome italien qui tire dans les jambes des flics.
On était dans une période un peu controversée, où les Brigades Rouges étaient encore opérantes.
 Là, on est en 84, vous commencez à tourner un peu plus ?
Là, on est en 84, vous commencez à tourner un peu plus ?
François : On tourne un peu plus, l’étape qui va marquer le groupe, c’est la sortie de “Concerto pour détraqués”. Avant ça, ce sont des petits concerts…
Concerto va être un moment charnière dans votre histoire ?
François : Oui parce que le son change, il est plus costaud, on enregistre au studio W.W. qui est un studio qui est beaucoup plus à l’écoute de ce qui se fait en Angleterre, qui a amené un son au groupe. L’enregistrement s’est vraiment fait à l’arrache, mais avec l’idée précise d’avoir un son incisif, super compressé et percutant. Et là se sont rajoutés les chœurs. Là, on a une dimension “oi !”. Il est beaucoup plus raïa affirmée… À cette époque, j’écoute beaucoup de oi !, l’album live de Sham 69, “Tell us the truth”, m’a beaucoup marqué, pour le côté rudimentaire, efficace…
Loran : C’est l’album où l’on entend les premiers chœurs, en référence à la culture oi !, pas du tout affiliée à l’extrême droite, plutôt des hooligans décalés d’extrême-gauche.
François : Le contexte dans lequel on enregistre cet album est bizarre. Masto était parti à New-York, donc on a cherché un saxo, on a trouvé Pascal Kung-Fu, qui avait enregistré avec les Tolbiac Toads, on était dans plein de milieux… déclassés. Et c’est un peu la dimension du dessin qu’a fait Laul, cette fresque, très puissante, qui est un amalgame de la société des détraqués.
Laul : En même temps, c’est fidèle au disque, moi je les ai juste rangés comme ça. Ça parle des textes du disque, il y a un renard, une bergère, une bande d’alcoolos, trois skins, mais c’est métissé, et il y a la violence qu’il y a dans le contact. Si tu mets tous ces gens-là dans le métro dans le même wagon, il y a baston. C’est explosif, en effet.
Masto : À l’époque où l’on préparait Concerto, j’ai eu un plan pour partir à New-York comme photographe pour une bande de peintres, et j’avais super envie de faire ce voyage. J’étais emmerdé, mais ça ne durait que deux mois, ça me paraissait jouable. Loran m’a dit : “si tu pars c’est fini”, genre il faut que tu choisisses, et je l’ai remercié, je lui ai dit : “je me casse, c’est cool…” Ils m’ont repêché deux ou trois ans après. Ils ont déboulé chez moi, avec des affiches, il y en a un qui met un coup de coude à l’autre : tu vois, il s’est coupé les cheveux ! Allez, on le branche. Ils avaient peur parce que j’ai eu une petite maladie, j’ai eu les cheveux longs… Rires… Ça les inquiétait… Rires… Apparemment, c’était ça la barrière au fait qu’ils me rebranchent… Je suis donc revenu pour l’album “Abracadaboum !”
Musicalement, on a quelque chose de beaucoup plus offensif ?
François : Oui, du point de vue de l’identité musicale et artistique. Quelqu’un a joué un rôle, dont on ne parle jamais, puisqu’il est effacé, c’est le photographe qui apparaît sous le pseudo de Benoît Simon, il a fait tous les clichés de cette époque, “Concerto” et “Joyeux Merdier”. Il a contribué à donner cette nouvelle image des Bérus, plus affirmée, plus campée sur ses deux jambes. Cette image va être en porte-à-faux avec Rock Radical Records, qui est en train de se transformer en Bondage Records. Il y a eu de grandes discussions à cette époque avec Philippe, puisque c’est moi qui avais conçu la pochette, (l’intérieur était dessiné par Laul). Il ne voulait pas que ça s’appelle “Concerto pour détraqués”, et il ne voulait pas qu’on apparaisse avec des masques. Un soir, il m’appelle chez moi à minuit, pour changer le titre, alors je lui dist : “trouves en un autre et on verra”. Il a dit à Loran : “j’ai trouvé un titre qui est bien, c’est “Rancard pour les barjos”… Rires… On a dit c’est sûr, on garde “Concerto pour détraqués”, on le garde.
Et pour te dire à quel point on était fort en musique, la partition musicale qui est dessinée sur la pochette a une ligne de trop… Rires… J’étais incapable de savoir combien il y avait de lignes sur une partition, et pour dessiner la clef de sol, ça a été toute une affaire… Rires… En fait le premier titre devait être “Vendetta”, on ne l’a pas fait parce qu’il y avait un groupe de disco qui s’appelait déjà comme ça. Mais l’état d’esprit était là, on était une bande, et l’on voulait prendre une revanche sur la société. Il y avait ce côté vengeur.
Il y a encore des titres comme “Les éléphants” qui rappellent l’univers psychiatrique ?
François : Il y a encore deux ou trois titres qui plongent dans le passé de l’aventure bérurière. Tout à fait.
(MARSU) sentait que Bérus étaient une force, et qu’il y avait de quoi construire quelque chose, un projet alternatif.
C’est à cette époque-là que Marsu te donne un coup de main pour le management ?
François : Oui, c’est l’arrivée de Marsu, et là, il y a véritablement des tournées qui vont s’organiser. Il a voulu donner une cohérence. Il sentait que Bérus étaient une force, et qu’il y avait de quoi construire quelque chose, un projet alternatif. Je dirais que le constructeur de l’alternative en France ça a été en grande partie Marsu. Pour moi, au départ Béru c’était plus une volonté d’autonomisation, d’autonomie artistique et politique plutôt qu’une recherche de voix alternative, c’était plus sortir de l‘autodestruction.
Marsu : J’ai commencé par filer un coup de main aux Bérus, j’avais gardé mes contacts de l’époque Lucrate alors je les ai refilé aux Bérus. François était débordé parce que le groupe explosait et il était submergé par le courrier de centaines de fans, de fanzines, d’interviews papier, de propositions de concerts… Donc je lui donnais un coup de main, et au moment où on enregistrait “Concerto pour détraqués”, je me suis retrouvé manager. C’était en août 85. François n’avait plus le temps de s’en occuper, mais il continuera à s’impliquer pendant très longtemps. De toute façon, toutes les décisions importantes étaient discutées entre nous. Je m’occupais de la recherche de concerts, de l’intendance, la promo, je servais de filtre entre le groupe et l’extérieur. Du coup, je vais être pour pas mal dans la structuration du discours du groupe.
Le commissaire politique…
Marsu : Oui, c’est pour cela que l’on m’a appelé “le commissaire politique”, j’essayais à mon niveau d’avoir une cohérence, et de remettre tout ça à plat par rapport au fond. Même si un groupe évolue tout le temps, et si a un moment donné, j’ai figé complètement son discours. Au bout d’un moment ça t’échappe ce truc-là, ça devient ce que les gens ont envie que tu sois. Je me tenais de manière forcée à ce truc-là, alors que le groupe commençait à partir dans toutes les directions. Et j’ai eu du mal à négocier le virage… ! À la base, j’ai pris tous les éléments que le groupe développait, et je les ai recollés dans un corpus cohérent.
François : Il avait cet état d’esprit-là très tôt, déjà, quand on était dans la bande du Luxembourg, la première fois que je l’ai vu, j’ai cru que c’était un mec des R.G. Il avait ce côté tellement… positif, et tellement : “on va construire !”… Je me suis dit : “ce mec va manipuler tout le monde, c’est clair”. Il avait ce côté, très cartésien, très fédérateur pour construire une alternative musicale et politique si possible.
Loran : Ça devait être le seul, ou au moins le plus cartésien du groupe. C’est lui qui a fait la connexion entre toutes les associations, les groupes… C’est lui qui a un peu tissé la toile d’araignée de ce qu’on a appelé le rock alternatif… François : À l’époque de “Joyeux Merdier”, on a un changement de couleur, on a un message beaucoup plus positif. “Salut à toi”…
Laul : Là, c’est “Vive le feu !”, ce n’est pas “À mort la pluie”… Un truc positif, tout le reste c’était anti-machin, anti-truc…
François : Ça a déplu d’ailleurs. Je me souviens que pour l’enregistrement de “Salut à toi”, Loran s’est fâché avec Philippe qui voulait un truc beaucoup plus formaté pour les radios, il y a eu un clash. On était sans concession sur ce que l’on voulait. On faisait ce qu’on voulait, avec le son que l’on voulait… “Salut à toi” est passé pour un tube très vite, ça nous a été reproché…
De toute façon, tous les albums de Bérus ont été décriés à l’époque où ils sont sortis…
François : C’est vrai. Les premiers, qui étaient dans la vague arty, quand ils ont vu “Macadam” on dit : “putain ils retournent à leurs trucs de loubards, de banlieue pérave, de voyous…” Ceux qui ont vu “Concerto”, ont dit : “ce n’est plus pareil c’est l’Orange Mécanique, laisse tomber”, “Joyeux Merdier”, on vient d’en parler.
Laul : C’est comme tous ces trucs que tu as découvert tout seul, qui deviennent moins bien quand tu vois que d’autres s’en emparent…
François : C’est normal j’ai eu la même réaction pour les Clash, les Sex Pistols… Quand les Clash ont sorti “Sandinista” ce n’est pas passé, je l’ai acheté le jour même, je l’ai revendu le jour même. Je comprends tout à fait cette attitude. “Macadam”, c’est du noir et blanc, “Concerto” il y a une touche de rouge, et “Joyeux Merdier” c’est les couleurs…
Laul : Et “Abracadaboum !”, c’est le plus de couleurs qu’on peut mettre, avec des confettis, des ballons…
Comment bossiez-vous avec Bondage et Marsu ?
François : Au départ Rock Radicals Records était une association loi 1901. Donc à but non lucratif, tout devait être réinvesti. À l’époque, pour un concert, on doit toucher à peu près 2.000 francs. On tourne avec le matos dans notre D.S. À partir de 1986, c’est devenu plus sérieux. C’est là qu’a commencé à se coordonner toute la structure du “Troupeau d‘rock”.
Il n’existait pas auparavant ?
Laul : Si tu veux il y avait un troupeau, mais les bêtes n’étaient pas marquées…
François : C’est vraiment vers la fin 85, avec l’arrivée des Titis que tout s’est structuré. Ça apparaît très clairement sur “Joyeux merdier”, où on a les Tontons, les Titis, c’est-à-dire Helno, Laul, Karine et Florence. Les Titis sont arrivées par hasard. Elles nous ont passé un coup de fil, en nous disant : “on veut intervenir à un concert à Tours”, nous on a dit pas de problème. Et là, elles arrivent à l’improviste, elles déboulent sur scène, et déclenchent l’hystérie, elles avaient deux nez de cochons, des mini-jupes et ça a volé dans tous les sens…
Laul : En fait, elles s’éclataient chez elles devant leur miroir à écouter les Bérus, comme deux copines, et elles se sont dit : le top ce serait de le faire en vrai. Elles ont eu le culot de le demander. Après ça, on ne les a plus lâchées.
François : Elles sont montées vivre sur Paris, et ça a démarré comme ça.
Loran : L’arrivée des Titis a apporté vachement de choses au groupe… Ça nous a ouvert l’esprit, c’était vachement important.
Et les Tontons ?
François : Eux, ils étaient là depuis longtemps.
Laul : D’un seul coup, c’était une logistique, chacun sa malle, il fallait qu’on prévoit un endroit pour se changer, par contre pour le matériel de scène, c’était ce qu’on trouvait. S’il y avait un caddie ou un escabeau, on le prenait… On n’était plus en incruste, on était invités par le groupe pour une prestation. On n’était pas obligé de jouer sur tous les morceaux, et l’on prévoyait tel chapeau pour tel morceau, on essayait de penser des trucs pour ne pas être hors-sujet.
 François : En 86, l’affiche officielle c’est le dessin de Laul, la pochette de “Joyeux Merdier”. Marsu organise les tournées, là, on a vraiment beaucoup de monde. C’est là que ça a vraiment explosé, là qu’il y a eu vraiment une synergie entre les groupes aussi. La rencontre avec les gens de Nuclear Device par exemple…
“Abracadaboum !” est un album puissant musicalement et au niveau de ce qu’il raconte, mais il a été mal enregistré et mal mixé, et il a perdu toute sa percussion. Il a été noyé. C’est un album qui a trop de réverbe, qui a perdu de son efficacité. Quand il est sorti, il y a une campagne d’affichage de Best, on a été placardé partout sur les grands panneaux. Il y avait des grands placards dans Paris sur lesquels était reproduite la pochette du Best sur lequel on apparaissait. Bérurier Noir était vraiment super promotionné. Et le groupe s’est arrêté. On a annulé les concerts de mai et de juin 1987. Et on a réfléchi pendant l’été. À la rentrée, on a mis sur pied “Le Mouvement de la Jeunesse” et on a participé à un concert pour SOS Racisme, place de la Bastille qui a réuni énormément de monde.
François : En 86, l’affiche officielle c’est le dessin de Laul, la pochette de “Joyeux Merdier”. Marsu organise les tournées, là, on a vraiment beaucoup de monde. C’est là que ça a vraiment explosé, là qu’il y a eu vraiment une synergie entre les groupes aussi. La rencontre avec les gens de Nuclear Device par exemple…
“Abracadaboum !” est un album puissant musicalement et au niveau de ce qu’il raconte, mais il a été mal enregistré et mal mixé, et il a perdu toute sa percussion. Il a été noyé. C’est un album qui a trop de réverbe, qui a perdu de son efficacité. Quand il est sorti, il y a une campagne d’affichage de Best, on a été placardé partout sur les grands panneaux. Il y avait des grands placards dans Paris sur lesquels était reproduite la pochette du Best sur lequel on apparaissait. Bérurier Noir était vraiment super promotionné. Et le groupe s’est arrêté. On a annulé les concerts de mai et de juin 1987. Et on a réfléchi pendant l’été. À la rentrée, on a mis sur pied “Le Mouvement de la Jeunesse” et on a participé à un concert pour SOS Racisme, place de la Bastille qui a réuni énormément de monde.
Loran : C’est vrai que, pour nous, Béru a été une véritable alternative au suicide… “Abracadaboum !”, c’est l’apogée de la tribu, où tout le monde est bien dans sa peau, ce n’est plus une espèce de happening qui fait peur. On ne parle plus d’hôpital psychiatrique, de la mort, là on commence à parler du “Yes Future”. Même des morceaux comme “SOS” finissent en hymne au rassemblement.
Masto : À cette époque ça a un peu changé… La tribu était bien là, humainement, la bande entre Helno, Bol, Jojo et les Titis, François et Loran évidemment, c’était le top. Avec Pierrot aussi qui est arrivé plus tard au son, c’était super, super. Une confiance totale, une harmonie totale. Chacun a pris sa place, chacun respectait la place des autres, tout en se moquant, évidemment !
Vous avez conscience du développement de l’alternatif ?
François : Oui, on défendait ça, on avait un S.O., on voulait que les prix des concerts soient les plus bas possibles… Mais je dirais que le maître d’oeuvre c’était vraiment Marsu… Nous, on était d’accord, mais la mise en place théorique et pratique venait de lui. Donc l’idée était de développer ces tournées avec cet idéal, jusqu’en 87 et là, il y a eu un ras-le-bol… Un ras-le-bol, par rapport à la fois à une contestation interne, et aussi au fait qu’on se rendait compte qu’on était les dindons de la farce. Ça a vraiment été le concert du Printemps de Bourges qui a été l’overdose. C’était le summum du non-respect des artistes, il n’y avait pas de logements, il n’y avait rien…
Laul : Au début c’était : “vous jouez dans trois mois, qu’est-ce que vous désireriez manger ?”. Marsu nous a fait passer la liste, et on s’est dit : on ne va pas mettre du homard, mais on va mettre manger bon et sain… On a eu que des trucs passés au micro-ondes, avec des capsules qui puent… Ce n’était pas la peine de demander dans ce cas-là… Et après tu apprends que Rita Mitsouko a touché dix fois plus que ce que tu as touché…
François : Nous, on avait une autre exigence, qui était une exigence de solidarité entre les jeunes, laisser rentrer tout le monde, on était dans une démarche beaucoup plus alternative, avec des tables de presse qu’on imposait, un service d’ordre qu’on imposait, qui a posé un certain nombre de problèmes à des structures plus officielles…
Laul : Il y avait des endroits où la boîte était très bien, le public était très bien, c’était juste le patron qui se disait : “tiens, eux ils ne sont pas chers, mais nous on va vendre de la bière à fond, on va garder le bar ouvert tout le long”, et le mec se faisait dix fois plus d’argent que nous, alors qu’il ne l’aurait pas fait si on n’avait pas été là. C’était “chacun sa merde”… Et nous on ne faisait pas de caprices, on disait : “on veut de la bière”, on n’indiquait pas de marques, et très souvent, on avait la pire…
Masto : J’avais conscience du développement de l’alternatif, mais je refusais tout ça à l’époque. Par provocation, et colère contre ce que je voyais. Je n’ai jamais voulu rentrer dans un discours, défendre des choses… J’avais ma lucidité et mon point de vue, mais je voulais rester dans la provocation. Je trouvais que j’avais d’autant plus de raisons de le faire en étant dans les Bérus. J’ai toujours été le méchant, même dans l’imagerie sur les morceaux, j’ai toujours fait le salop, le mec en noir qui tape les autres… Il y avait suffisamment de gens qui faisaient des discours, moi je préférais montrer autre chose. Je suis d’une manière générale réfractaire au discours, à une bonne conduite, même si elle correspond à ce que je pense. Sur le fond j’étais évidemment d’accord, mais je n’étais pas en phase avec ce mode d’expression. Après les interviews, François et Loran me faisaient souvent la gueule… Je sortais de manière assez volontaire des grosses conneries. Je sentais une nécessité à avoir ce contre-pouvoir.
La grève, vous la décidez tous ensemble ?
François : Le groupe est contesté à l’intérieur, Laul crée le zinzindicat, pour faire entendre sa voix et celle d’Helno. Les Titis ne sont pas en reste, puisque la Grande Titi veut quitter le groupe. Helno a déjà un pied dans les Négresses Vertes, il ne sait pas trop s’il va rester. Et tout se décide à l’été 87, Helno et la Grande Titi quittent le groupe. Laul se met en grève de temps en temps, il apparaît, il disparaît…
Masto : Ça commence à devenir un gros groupe… On travaillait tous à côté, donc on ne faisait des concerts que le week-end… Et l’on faisait énormément de bornes en camion, beaucoup trop. On pouvait faire 2 ou 3.000 kilomètres en bétaillère pour un concert pourri où l’on croyait qu’on allait sauver le monde, libérer des mecs qui étaient en prison, et on s’apercevait que c’était juste pour payer les amendes d’un mec qui avait fait ci ou ça…
Marsu : La grève survient suite au Printemps de Bourges en 87. Plusieurs membres des Bérus trouvent qu’ils sont bien mal payés et doivent se produire dans des conditions trop précaires, quand on compare cela au succès du groupe. En même temps, la troupe compte une quinzaine de personnes, il y a le S.O. à payer, et des gens qui veulent le beurre et l’argent du beurre. C’est pour ça, entre autres, qu’ils en voudront à Bondage, alors qu’en fait, il aurait fallu vendre les concerts nettement plus chers, et pratiquer des prix d’entrée “normaux”. En même temps, ce n’est pas ce qu’on avait décidé. C’est là où moi, en tant que commissaire politique, mais aussi en tant que manager, j’ai essayé de mettre les points sur les I, et de maintenir le cap. Ce qui était peut-être une erreur. Après ça, c’est parti à hue et à dia… Le succès, est très dur à assumer. Les différences entre les gens s’exacerbent, entre ceux qui veulent être des artistes, vivre de leur art sans faire de concession, ce qui est respectable, et ceux qui voudraient que le groupe soit un commando d’agit-prop, ce qui serait plutôt ma tendance.
Ça l’a globalement été quand même…
Marsu : Oui, mais entre autres parce qu’il y a eu cette grève et qu’on n’a pas viré la cuti business à ce moment-là… Et quand ils ont envisagé de le faire, ils se sont très vite aperçus de leurs contradictions, ce qui est l’une des causes de leur arrêt. Mais peut-être que s’ils avaient trouvé quelqu’un pour mieux structurer l’histoire, ils auraient pu prendre le virage. J’en doute cependant… Les contradictions qui étaient apparues quand j’étais encore leur manager, ils les ont gardées après mon départ.
Donc la grève, c’était ça ?
Marsu : Oui, avoir de meilleures conditions, gagner plus d’argent, être respectés par les organisateurs de concert… C’est vrai qu’à cette époque-là, nous jouions beaucoup pour de petites assos qui avaient grandi, et l’on en était encore au régime sandwich au pâté plus hébergement chez l’habitant… Alors que le poids du groupe aurait mérité logiquement d’avoir des hôtels un peu mieux, des super bonnes bouffes etc… et gagner de l’argent. C’était super contradictoire pour le groupe, tant d’argent brassé sur ton dos et toi tu en vois peu, ce n’est pas normal… Et en même temps, c’est aussi un truc de savoir quand on peut se permettre ça. On en était encore à la phase où l’on se battait pour obtenir ces conditions pour le groupe et le reste de la scène. Par exemple le S.O. nous coûtait une fortune à chaque fois… On n’avait pas l’environnement qu’il nous fallait… On n’a, par exemple, jamais eu de sonorisateur compétent… Dans de nombreux cas, nous n’avons pas choisi les solutions qui s’imposaient, mais tenté de générer les nôtres, sans qu’elles soient efficaces pour autant. Il y avait beaucoup d’éléments dont les membres du groupe n’étaient pas conscients. Je tâchais quant à moi de garder les pieds sur terre, et je me rendais compte en 88, en faisant les comptes avec les organisateurs, qu’il y avait des concerts où ils commençaient à se planter… Ce qui est complètement aberrant. À l’époque, les salles n’étaient pas subventionnées comme maintenant. On ne bossait pas avec les gros organisateurs parce “c’étaient des vendus”, et, avec les petits, on faisait les trucs ensemble. Si on gagnait des sous tant mieux, si on n’en gagnait pas tant pis, on partait avec le minimum…
François : On a donc été obligé de se recomposer à la rentrée 87. C’est là que j’ai dit à Loran, on va faire comme Mao Tse Toung, on va s’appuyer sur les gardes rouges pour maintenir le cap. C’est-à-dire s’appuyer sur la jeunesse qui nous soutient puisque le groupe est en train de partir en couilles. D’où l’idée de créer le bulletin “Le Mouvement De La Jeunesse”. Avec l’envie de reprendre en main l’aspect médiatique du groupe, car on en avait un peu marre que tout le monde raconte un peu n’importe quoi, par exemple les articles d’Actuel sur la mode Béru etc. C‘était aussi une reprise en main du discours de Marsu, que l’on voulait plus large. C’était une façon de relier le groupe à son public. C’est nous qui le tirions, qui le préparions avec Loran, et c’est moi qui le confectionnais et l‘envoyais à notre fichier de fans. C’est aussi à partir de ces constats-là qu’on a décidé de créer le “Folklore de la Zone Mondiale”, pour faire entendre la voix des sans-voix.
Vous avez eu très tôt des organes de propagande, bien avant “Le mouvement la jeunesse” ?
François : On faisait de l’archivage, des dossiers de presse…. On n’est jamais mieux servi que par soi-même, et comme on ne parlait jamais de nous dans la presse, j’envoyais des dépêches à Best, et un jour, ils se sont mis à les imprimer. Ensuite je découpais mes dépêches pour les photocopier, c’était une espèce d’auto-propagande…
Laul : On glissait nos revues de presse dans les disques, et on demandait aux gens de les photocopier.
François : Le tout premier ça devait être “Bérurier : dossier noir”, qui était à cheval entre les anciens Béruriers et Bérurier Noir. C’était un truc anecdotique qui a dû être tiré à vingt exemplaires, mais qui est devenu mythique justement parce que personne ne pouvait le trouver… Rires… Le deuxième truc important est sorti en 86, c’était “A bien Märrér hiier souar !”… Ça, c’étaient des collages que je faisais, pour donner un sens…
Un sens à quoi ?
François : Pour dire que les Bérus n‘était pas juste un groupe de rock, mais aussi autre chose… C’était une demande, je l’ai mis en vente à la librairie Parallèle, et c’est parti très vite. Il y a une volonté de marquer une autre façon de faire par rapport à notre public.
Marsu : “Le Mouvement De La Jeunesse”, c’est une très bonne idée de François. C’était l’idée d’avoir notre support média et de communiquer en direction de nos fans et du reste du monde… Dès les Bérus ancienne formule, ils avaient déjà un truc qui s’appelait “Foulard Noir”. Il y avait ce côté un peu situ, de faire des manifestes, comme un mouvement artistique. Après ça, il y a eu les “Carnets Noirs”, les revues de presse des Bérus, un peu ré-orientées quand même, avec des petits textes en plus, et ensuite il y a eu “Le Mouvement De La Jeunesse”. LMDJ était à la fois un retour de terrain, on racontait ce qu’on faisait, ce qu’on vivait, les gens qu’on rencontrait, etc., et en même temps, quelque chose qui, beaucoup plus qu’une feuille d’info, cherchait à communiquer, à orienter les gens dans une direction, à donner une prise collective à l’ensemble. C’était une très bonne démarche, et pratiquement tous ceux qu’on a faits ont été bien. Celui qui parlait de l’affaire “Black War” est sorti beaucoup trop tard, bien après les événements. C’était dommage car il aurait fallu qu’on ait une réponse ferme et radicale aux attaques dont les médias nous ont accablés. À ce niveau, si les Bérus avaient eu l’ingénierie qu’ils ont maintenant à cette époque, je pense qu’on aurait calmé du monde…
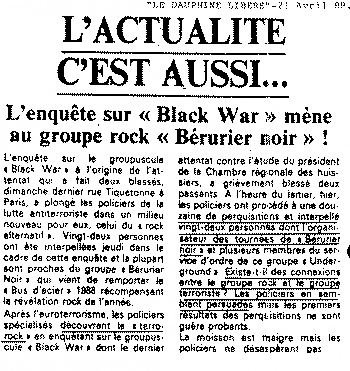 L’histoire de Black War est assez simple. En 88, au moment où les Bérus vont faire le Zénith, il y a une série d’attentats en région parisienne, principalement contre des huissiers de justice qui expulsaient des gens. Il y en a un qui a la main arrachée quand même. À la suite de ça, les flics font des descentes dans les milieux d’extrême-gauche pour ratiboiser tout ce qu’ils peuvent, choper des carnets d’adresse et se remettre à jour. Ils embarquent une grosse partie de notre S.O., dont Dom qui en était le coordinateur. C’est au même moment qu’on reçoit” le Bus d’Acier” qu’on avait refusé tout en le prenant, truc très agaçant pour un manager. Parce qu’on dit un truc et on ne le fait pas après…
L’histoire de Black War est assez simple. En 88, au moment où les Bérus vont faire le Zénith, il y a une série d’attentats en région parisienne, principalement contre des huissiers de justice qui expulsaient des gens. Il y en a un qui a la main arrachée quand même. À la suite de ça, les flics font des descentes dans les milieux d’extrême-gauche pour ratiboiser tout ce qu’ils peuvent, choper des carnets d’adresse et se remettre à jour. Ils embarquent une grosse partie de notre S.O., dont Dom qui en était le coordinateur. C’est au même moment qu’on reçoit” le Bus d’Acier” qu’on avait refusé tout en le prenant, truc très agaçant pour un manager. Parce qu’on dit un truc et on ne le fait pas après…
C’est-à-dire… ?
Marsu : On s’était quand même tâté : est-ce qu’on le prend, est-ce qu’on ne le prend pas ? C’était une distinction honorifique, méritée d’un côté parce qu’elle symbolisait le boom du rock alternatif, et, en même temps, pour nous qui avions toujours affirmé qu’on n’était pas dans le business, cela revenait à une forme de récupération ; il y avait donc une contradiction de base. Finalement, on décide de le refuser.
Laul : Pour nous c’était un prix, et on disait : “c’est de la connerie, nous on ne court pas après les concours”.
Marsu : Alors qu’on était en train de manger avant de se retrouver à la cérémonie du Bus d’Acier, on voit à la télé un gars de la boutique Bondage, (qu’on avait montée en parallèle du label, qui avait très peu à voir avec lui sauf les actionnaires, ce qui s’y vendait n’était pas du tout ce que j’aurais voulu. Enfin, chacun ses contradictions, ça c’en était une bonne), agrippé par les médias, qui grosso modo lui décernent le prix. Il ne savait pas quoi dire… Donc on se retrouvait à accepter le prix. On déboule immédiatement là-bas, François fait un discours comme quoi on le refuse, et à la fin de la soirée, la Titi, complètement bourrée, se précipite sur le mec qui tenait le Bus d’Acier et part avec. Il a fini par servir d’antenne de radio à Laul, c’est une bonne pièce métallique, et après je ne sais plus qui l’a récupéré…
Je pense rétrospectivement qu’il aurait fallu accepter le prix, au nom du mouvement alternatif, et le donner à une salle quelconque, genre Fahrenheit, un endroit collectif, où il aurait pu trôner. Mais là, ce n’était ni fait ni à faire, tout et son contraire, ça donnait juste l’image du chaos. Bon, c’est très Bérurier, mais de mon point de vue, c’était minable. J’étais fou de rage… Le lendemain, on partait en Suisse. Tout le voyage, je boudais dans mon coin, j’étais fumasse… ! On arrive en Suisse, qu’est ce qu’on apprend ? Dans la nuit avait eu lieu la descente de flics, tout notre S.O. avait été serré, et, comme par hasard, l’AFP publie une dépêche affirmant que Bérurier Noir est la branche culturelle d’Action Directe. Truc qui n’a pas été contredit. Les gens du label ont flippé.
Les médias disaient : le manager de Bérurier Noir est en prison, alors qu’en fait c’était le chef du S.O., et eux n’avaient pas d’informations, ils n’étaient pas du tout préparés à ça, c’était assez violent comme attaque… Du coup, ils ont fait un vague démenti, alors qu’il aurait fallu réagir promptement, avec un avocat, attaquer l’AFP, obtenir un droit de réponse immédiat dans la presse, parce qu’après ça, le mal était fait. Donc on a eu plein de concerts annulés, les keufs qui suivaient les concerts avec deux cars de CRS, c’était super dur…
Vous avez été emmerdés après ça ?
Marsu : On était sur écoute, il y avait des gens bizarres qui zonaient devant chez Loran, des trucs pas possibles. Il y a eu, à notre avis, une grosse manipulation pour nous couler. Même en tenant compte de la parano naturelle qu’on peut avoir, du fait de la pression, je pense qu’il y a eu une stratégie orchestrée pour nous dégommer. Tous les médias se sont bien évidemment emparés de ça, donc tous les maires qui avaient Béru dans leur ville ont annulés les concerts, soit une vingtaine d’annulations au total, donc préjudice important, et surtout, après ça, une image de marque méga sulfureuse, pour rien… À la limite quand c’est voulu ça se manoeuvre, mais là…
Au final, les gens qui se sont fait embarquer sont tous relâchés, la montagne a accouché d’une souris, il n’y avait rien… Ils n’ont jamais rien trouvé sur qui que ce soit… On se demande si ce coup n’est pas une gigantesque intox des R.G. ou de services barbouzards quelconques. Parce que c’est vrai que ce que l’on faisait inquiétait les pouvoirs publics. Je me souviens qu’au moment du concert au Zénith, on a eu une discussion dans les bureaux de la production avec le commandant des C.R.S. Les C.R.S. quadrillaient tout le coin, et il y avait beaucoup trop de monde par rapport à la contenance de la salle. On a réussi à négocier avec les gens du Zénith et le commandant des CRS, qui voulait faire charger dans le tas, de faire rentrer quasiment tout le public. Donc on a dépassé la jauge du Zénith de 500 personnes… C’est là que j’ai vu que l’on commençait déjà à jouer dans la cour des emmerdeurs…
Je pense qu’à ce moment, on n’était pas suffisamment structurés politiquement, techniquement (c’est-à-dire avocats, etc.) pour pouvoir assumer ça. Nous qui étions des petits artisans, on se retrouvait avec des gros balèzes qui nous tapaient dessus. Ça n’a plus jamais été la même chose après.
Laul : Je crois qu’ils se sont fait un film, on était juste dans le collimateur d’une parano.
François : Ce qu’on sait de façon assez précise, c’est que l’organisation du concert du Zénith en mars 88, a été très mal perçue par les R.G. et par tous ceux qui voulaient contrôler ce mouvement, de prix d’entrées pas chers, de tables de presse en soutien aux prisonniers, aux minorités, aux réfugiés etc…
Laul : Une petite phrase d’Helno au passage…
François : Moi, entre-temps j’avais vu Charlie Baston, un autonome, qui avait escaladé toutes les grilles de ce camp retranché qu‘est le Zénith, il avait sauté par-dessus les barbelés, il avait les mains en sang. Il vient me voir, et me dit : “François, ce soir motus et bouche cousue, (il y avait le procès d’Action Directe), ce soir, il va y avoir plein de flics en civil dans le public, ils sont supers tendus, pas un mot là-dessus”. Je lui dis : “pas de souci, je n’ai pas prévu quoi que ce soit à ce sujet”.
Mais, pendant le concert, je vois Helno débouler entre deux morceaux, avec un papier qu’on lui avait donné, et qui commence à lire, à moitié bourré, un texte en soutien à Nathalie Ménigon…
Ça m’a fait marrer, parce que c’était trop ça les Bérus… Joyeux merdier… On a su qu’ils avaient été terrifiés, parce qu’on avait fait sauter les standards de sécurité du Zénith. On avait joué en obligeant l’ouverture des portes aux 500 personnes qui restaient dehors. Loran qui était très nerveux au début du concert a fait un chantage en disant : “je refuse de jouer tant que tout le monde n’est pas rentré”… C’était très tendu entre Loran et le gérant du Zénith, donc il a décidé d’ouvrir… Et ils avaient peur qu’on rentre dans une espèce de logique de masse, et qu’on dise : ”allez, tous à l’Élysée !”, et que tout le monde nous suive d’un bloc, en se disant on va aller tout fracasser. Là, on a vu qu’on était dans une logique de surveillance accrue.
Laul : Ce que je trouvais formidable dans cette histoire, c’était le coup de pied dans la fourmilière, montrer qu’on pouvait faire un Zénith à 50 balles, et que les gens soient contents. Ce n’était pas un sous service. Tout ce qui fait que ça coûte 120 balles ou 200 balles, c’est uniquement des marchands d’esquimaux et des vigiles avec des beaux badges. Je pensais qu’on donnerait l’exemple… Et on n’a pas donné d’exemple, on a juste été une exception. Mais c’était intéressant de montrer que c’était faisable, que l’idée se tenait.
François : Organiser un concert populaire, avec des idées… C’est vrai qu’on y croyait, il y avait cet idéal… Nous, on ne s‘est pas payé sur le Zénith. Ça a été cadeau. Les radios sponsors, c’étaient Radio Libertaire, et Radio Aligre. On était dans une logique de service public !
Sur les concerts, on met les comptes à plat, on organise ensemble, donc on prend un fixe pas trop élevé, et après on partage les bénéfices. Contrôle du public au niveau des entrées, pas de fafs, pas de mecs ambigus…
Quelles étaient les valeurs de management que tu portais ? Marsu : Il y a beaucoup de choses qu’on discutait avec le groupe, dès qu’il y avait des décisions importantes. Pour les radios, comme NRJ, par exemple, avoir le contrôle de ce que tu dis. Pour les interviews, le principe c’était droit de relecture systématique… On a raconté trop de conneries sur nous. Sur les concerts, on met les comptes à plat, on organise ensemble, donc on prend un fixe pas trop élevé, et après on partage les bénéfices. Contrôle du public au niveau des entrées, pas de fafs, pas de mecs ambigus…
Quand est-ce que vous décidez de créer le S.O. ?
Laul : Très vite sur Paris, on a eu des fidèles. Des potes qui se sont responsabilisés de ça, du genre ne bouge pas, je vais m’y mettre…
François : Le S.O. a été mis sur pied par Dom. C’était un mec très politisé qui avait sorti un magazine de soutien logistique aux anciens prisonniers d’Action Directe. Il venait du milieu autonome et il s’est dit, compte-tenu de la pression et du monde qu’ils ont, les Bérus ont besoin de gérer ce public de la manière la plus autonome et la plus respectueuse possible. Donc il a rassemblé autour de lui un certain nombre de potes qui étaient d’accord pour marcher dans l’affaire et fonctionner avec nous. C’était tout à fait organisé et métissé. Il y avait des Beurs, un Antillais, Farid des Thénardier…
Marsu : À l’époque 86-87, on a trop fait de concerts super tendus, avec des fafs dans la salle, des embrouilles. Du coup il fallait descendre avec la barre de fer à la main pour régler des comptes… Trop chaud… À partir du moment où l’on a eu notre propre S.O., on a fait le ménage… Je les ai toujours soutenus, tant que c’était rationnel. Quand je n’ai plus été là, je sais qu’il y a eu quelques bavures, genre chasseurs de skins… “Il n’y a plus de nazis, tiens lui ça doit en être un… C’est un punk à crête, ce n’est pas grave…” J’exagère un peu, mais il y a eu des trucs stupides comme ça… Des mecs sans vécu militant et qui faisaient ça sans recul. Alors qu’au départ, y compris les Red Warriors, c’étaient des militants politiques.
Laul : Il y avait des mecs qui étaient là pour faire chier tout le monde, le S.O. les attachait avec du scotch dans les buissons, et une fois que c’était fini, ils enlevaient le scotch. C’était juste pour les immobiliser. Je trouvais ça correct. François : Les mecs étaient très respectueux de notre public.
Comment est-il constitué ?
Marsu : À la base, c’est autour de gens comme Dom, des anciens totos. Après ça, il commence à y avoir des redskins, quelques punks balèzes. Ce sont des gens qui ont une bonne force de frappe, qui ne sont pas des masses mais qui sont suffisants pour calmer les ardeurs des gros cons. Ensuite il y a eu un peu plus de monde, et ç’est devenu un peu plus la chasse aux skinheads.
Avant tout, ce S.O. était coercitif vis-à-vis des relous, et offensif en direction des fafs.
Le S.O. compte 10-15 personnes ?
Marsu : Oui, entre six et quinze, deux au minimum. Généralement de quoi remplir une ou deux bagnoles. Une quinzaine pour le Zénith de Paris. Mais c’était un S.O. de scène et un S.O. antifa. Le problème est que l’on imposait ce S.O. de scène, alors que souvent les organisateurs voulaient un S.O. tout court… Parfois, notre S.O. se retrouvait à faire l’entrée, ce pourquoi il n’était pas venu.
Il y a plein d’endroits où l’on a fait le ménage définitivement, ou au moins pour quelques années… Avant tout, ce S.O. était coercitif vis-à-vis des relous, et offensif en direction des fafs. Point. C’était le but de la manoeuvre… Nous venions du public. On avait vu à l’oeuvre le S.O. du Gibus ou les connards de KCP qui défonçaient tout le monde. Notre vision du S.O. était plutôt “gentils organisateurs”. Il est là pour protéger le public, pour accueillir les gens, faire que ça se passe bien, et pas pour faire de la répression. C’étaient des gens qui venaient du public comme nous et qui s’étaient auto-organisés. C’était une belle théorie, et on a essayé de s’y tenir. Mais bon, c’était quand même un bon nid de voyous et de redskins au final, ce qui n’a pas été inintéressant.
Et ça a permis aux gens de comprendre qu’ils pouvaient être autre chose que des victimes, qu’ils pouvaient s’organiser, et que s’ils le voulaient, de même que nous on avait viré tous ces cons de nos concerts, ils pouvaient faire pareil. Ça a aidé vachement de choses. Ramener la solidarité dans le public… Là aussi, je pense qu’il aurait fallu structurer plus politiquement…
Vous allez rentrer en conflit avec Bondage ?
François : Bondage n’étant plus une association loi 1901, il y avait des bénéfices qu’il fallait partager. Le contrat de départ, ce qu’on s’est toujours dit c’était : un tiers pour les taxes, TVA etc., un tiers pour nous, un tiers pour Bondage. Au fur et à mesure, il y a eu une demande d’éclaircissement sur les comptes, qui ne s’est pas faite. Et là, on a considéré qu’il y avait arnaque… La question s’est posée de manière assez radicale avec les Satellites, qui étaient des potes mais qui avaient une vision de l’alternatif qui ne nous correspondait pas, qu’on ne trouvait pas du tout alternative. Donc là, il y a eu une tension à la fois artistique et idéologique au niveau du fonctionnement d’un label alternatif. Je pense que ça ne serait pas mentir de dire que Philippe et Jean-Yves avaient une autre idée du développement du label, comme une espèce de petit Virgin. On est rentré dans une logique de conflit avec Bondage, qui s’est terminée par une sorte de règlement à l’amiable en fin d’année. Ce qui fait qu’on a retiré les injures, les “special fuck Bondage” qu’on avait mis sur la pochette de l’album “Souvent fauché, toujours marteau“… On arrive dans une sorte d’impasse avec Bondage, c’est très, très tendu, notamment avec David Dufresne… La position de Marsu était très dure, parce qu’il avait cette double casquette de manager de Béru, et de membre de Bondage. À un moment donné, on lui a demandé de choisir. Et donc, début 89, il y a eu cette rupture avec Marsu.
L’album “Souvent fauché, toujours marteau” est symbolique de cette période ?
Laul : Il y a un changement de style d’écriture… On n’est plus dans l’agression, on est dans la réflexion, on demande aux gens de se prendre en charge. Il n’y avait plus de caricatures à faire, en tant que clown ou même que dessinateur. J’avais beaucoup plus de mal à parodier ou à trouver un second degré aux choses…
 La pochette répond un peu à celle de Macadam Massacre…
La pochette répond un peu à celle de Macadam Massacre…
François : Non, c’est différent… C’est une photo qui a été faite dans la montagne. C’est une fuite, une traque… On quitte les lieux, avec un gugus en plus qui est Masto.
Laul : Mais c’est lui qui porte les bagages, alors on va le garder. François : Cette photo est parlante, elle a été prise dans la montagne dans un décor différent, naturel, à nous l’aventure ! C’est l’ouverture vers quelque chose, il y a une envie de partir… Une traque, et une fuite.
Loran : On revient au noir et blanc, on est trois. Moi je suis comme un nomade avec mon banjo, je fais un doigt au système. François est comme un militaire déchu, perdu dans une guerre qui n’existe plus depuis longtemps, un mec décalé, et Masto, le mec complètement à la masse, avec son sac en parachute… À partir de là, Béru on a été trois. C’est passé du couple au trio. Le couple était impossible. Ça ne marchait plus. Il y a un truc qui s’était cassé. On s’adorait, mais on savait qu’on ne pouvait plus être trois.
Masto : Le seul truc dont j’étais conscient quand j’ai fait cette photo c’est qu’on était dans la nature. Je l’avais vraiment souhaité. On était en mai ou juin, près de Montélimar, avec des cerisiers en fleurs partout. Une image en noir et blanc assez zen. On se sentait, ou l’on souhaitait être seuls…
La fin du Troupeau d’rock ?
Masto : Un peu… Ça clashait à droite à gauche, il y avait plein de dissensions, plein de problèmes. Je ne jette la pierre à personne, je les comprends, c’est super dur l’autogestion, c’est super dur la justice…
Laul : C’est aussi trois Pieds Nickelés… Et il n’y a aucun truc ostentatoire, pas de grosses pattes ou de trucs rebelles affichés…
Pas besoin puisqu’il y a écrit Bérurier Noir dessus… Donc, la fuite ?
François : On est dans une situation très fragile. Entre Loran et moi ce n’est pas la guerre mais on n’est pas d’accord sur le groupe et la façon dont il fonctionne… L‘interview, qui a été faite après l’Olympia par François Bergeron (qui n’a jamais été diffusée), est affreuse. On sent toute cette tension. Il y a vraiment deux clans. Le clan Loran, le clan François. Et ça se termine en pointillé. Les groupes qui suivent, Mano Negra, les Négresses Vertes, sont dans une autre logique. Une logique beaucoup plus commerciale. Il y a une récupération de tout ce mouvement par Virgin, Barclay…
Loran : Bérurier Noir, ça a vraiment été l’histoire de deux jeunes garçons qui se sentaient mal dans le système dans lequel ils étaient, lui c’était vraiment la tête et moi j’étais les jambes. Dans le sens où lui a amené tout le côté intellectuel, et moi l’énergie pure. On a souvent comparé les Bérus à une pile électrique, le plus et le moins. C’est notre différence qui a fait le groupe.
Laul : Il y avait déjà, le Zénith qui aurait dû servir d’exemple. On ouvre des portes, il n’y a plus qu’à s’engouffrer. Et en fait, c’était juste un courant d’air, personne ne suivait…
François : On a recomposé le groupe encore une fois, et là le Troupeau d’Rock s’est vraiment agrandi, puisqu’on est arrivé à 13 personnes. Éclairagistes, acrobates, Valoche, Nounours, Jojo est arrivé aussi, Mich’boul. Donc les Bérus commençaient à devenir une machine importante. Loran et moi, à partir de 89, on arrête de travailler. Mich’Boul devient notre manager-tourneur, et l’on organise une véritable tournée.
Vous travaillez jusqu’en 89 ?
François : Oui, j’arrête le B.H.V. en janvier 1989. Je fais un pot de départ avec mes collègues portugais, antillais, maghrébins, qui disaient tous, ça y est, c’est une rock star, il nous largue parce que c’est le jackpot… Et l’année 89 n’a été qu’une année… de décadence…
Loran : On était dans une impasse artistique, parce que tout le côté émotionnel et provocateur du début, on ne pouvait plus se le permettre, parce dès qu’on faisait un truc que les gens ne comprenaient pas, on passait notre temps à se justifier. Quand on était gamins, les gens se prenaient la claque dans la gueule, et basta. La pire des choses qui est arrivée aux Bérus c’est que ça marche…
Laul : Je reviens dans le groupe, à condition que l‘on mette les petits plats dans les grands, que l’on ait les moyens de nos ambitions, que l’on ait du matériel, des échasses, du pétrole, et donc un budget pour ça.
François : On fait toute une série de concerts, qui étaient des concerts d’adieu puisqu’on passait une fois dans chaque ville…
Vous le saviez déjà à l’époque ?
François : Non. Au début de l’année 89, on ne pense pas que le groupe va s’arrêter. La question se pose quand même assez vite, en mars-avril, parce qu’on sent qu’on tourne en rond. On tourne en rond musicalement, entre Loran et moi c’est un peu la guerre, le tandem de départ est super-tendu, par rapport à des options politiques différentes, des visions différentes du groupe, la troupe est quasiment clanisée. Il y a les copains du chef, les copains de Loran, et les Lucrate. Donc une tension interne, due aussi à des histoires personnelles, une pression très forte des milieux d’extrême-droite, de la police. Il faut voir qu’à cette époque Loran avait été cambriolé de manière très suspecte, ça ressemblait à un cambriolage professionnel des R.G., moi j’avais été attaqué par des skins, il y avait une tentative de la presse de nous présenter comme la deuxième génération d’Action Directe …
Laul : Mon père avait le même grade que le général Audran, qui s’était fait descendre par Action Directe. Donc les gendarmes venaient chez moi, de façon très officielle savoir ce que je branlais…
 François : Il y avait une espèce de parano pour savoir ce qu’étaient les Bérus. Mais ils n’ont pas été déçus…
François : Il y avait une espèce de parano pour savoir ce qu’étaient les Bérus. Mais ils n’ont pas été déçus…
Loran : Je n’étais pas très chaud pour arrêter, pas parce que je m’accrochais au groupe, mais parce que je me doutais qu’en arrêtant tout allait suivre. Ça me paraissait évident que l’on allait sabrer toute la vague alternative. Pour moi le groupe dépassait le groupe. Et c’est vrai que les autres groupes n’ont pas suivi, ils se sont juste servi du mouvement comme d’un marche pied. Pour moi, la vague alternative, c’était Béru et les petits groupes.
François : Le procès avec Bondage démarre en juillet 89. Avant l’été, se pose la question de l’arrêt du groupe. On est tous d’accord, sauf Loran qui veut continuer. Mais la pression générale du groupe fait qu’on décide de trois dates les 9, 10, 11 novembre à l’Olympia pour signer l’armistice du rock. Pour dire on en a marre, arrêtez de nous prendre pour des cons, si vous ne voulez pas marcher dans cette logique-là, nous on n’y peut rien…
Comment avez vous préparé les concerts de suicide ?
François : On a eu un vrai travail de répétition, plus que pour les autres concerts. Avant, on n’avait pas un réel professionnalisme, parce qu’on travaillait à côté.
Vous finissez avec un peu d’amertume ?
François : Non, pour moi, ça a été un énorme souffle de liberté. Ça tombait un peu par hasard, mais quand on a joué, le mur de Berlin est tombé. C’était l’ouverture de tout un monde, et pour moi, la fin des Bérus c’était un petit peu pareil.
Masto : J’étais super heureux qu’on arrête, de la façon dont on le faisait, du message transmis, de la coïncidence avec la chute du mur de Berlin… Je l’ai pris comme un petit signe historique, un truc qui s’arrête et un autre qui continue… J’étais très touché de tout ça. J’étais à ce moment de ma vie en saturation du non, et en quête de oui. J’étais de moins en moins en phase avec tout ce qui était dit, énormément de non. La fin des Bérus a été pour moi le début de ma quête du oui. On a reçu énormément d’amour, tout le temps, pas uniquement à ce moment-là…
Après chaque morceau, on balançait nos masques dans le public, comme pour se dire à nous-mêmes, on ne jouera plus, c’est sûr.
Qu’est-ce que vous retirez de ce moment précis ?
Masto : Là, on voulait vraiment donner le meilleur. J’avais des soucis personnels, et pour moi ça a été une période dure, douloureuse. J’ai ressenti des milliards de choses, c’était touchant, triste, heureux, tout à la fois, mais je n’ai pas été capable d’être généreux comme j’aurais voulu l’être. Le côté physique me balayait, m’emportait, mais entre les morceaux, je m’écroulais…
Loran : On savait que c’était la fin. C’était super fort. Le 9, dans le poulailler de l’Olympia, on avait invité tous nos parents. On avait fait rentrer le plus de monde possible. Le 10, on a appris la chute du mur de Berlin en plein concert. Le 11, après chaque morceau, on savait que plus jamais on ne le jouerait. Alors on s’est appliqué comme jamais. C’est un des concerts où l’on a le mieux joué. Après chaque morceau, on balançait nos masques dans le public, comme pour se dire à nous-mêmes, on ne jouera plus, c’est sûr.
Symboliquement c’était vraiment la fin d’un truc.
François : Je crois que c’était émouvant pour tout le monde. C’était trois concerts avec trois groupes différents : Die Toten Hosen, les Cadavres, la Muerte. Tout autour de la mort… Ce n’était pas fait exprès…
On avait vécu une aventure tellement forte…
Masto : J’ai un truc à rajouter, un merci… À tous ceux dont on a parlé, Helno, François, Loran, Titi, Bol, Nina, Gabo, Marsu… Un merci très rempli… Pour ce qu’ils sont, pour tout ce qu’ils sont. Particulièrement pour tout…