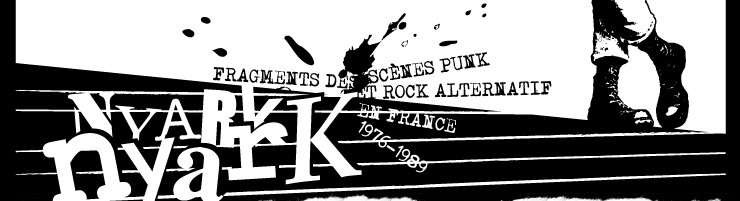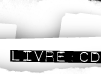RED WARRIORS, c’est une aventure qui commence en 1986 ?
RED WARRIORS, c’est une aventure qui commence en 1986 ?
Julien : Pour présenter les Red Warriors il faut se replacer dans le contexte du milieu des années 80. La date de création officielle est décembre 86 mais le processus de création est antérieur. À Paris à cette époque-là, il y a une tribu dominante qui fait la loi et qui sème la terreur c’est les skins. À ce moment-là ils sont devenus clairement fafs. En 84-85, c’est le moment où la première génération de skins, l’équipe des Halles, Farid, Pierrot… commencent à lâcher l’affaire, pour plusieurs raisons, la principale étant la came. Arrive là dessus l’onde de choc, avec quatre ou cinq ans de décalage, de la récupération des mouvements skins anglais par des groupes nazis.
Ils sont organisés ? Julien : Non, mais en bandes affinitaires, comme tout le monde. Tu as les skins de Pasteur, les skins du Luxembourg, les skins de ceci, les skins de cela, les skins de Tolbiac… En général ils sont rassemblés autour d’un groupe de musique ou autour d’un lieu. Ça devient très, très compliqué, dans le milieu des années 80, quand tu es punk, ou en tout cas pas neusk, de se déplacer dans Paris. Il faut que tu prennes ton plan de métro, et tu sais qu’il y a des stations où il ne faut pas descendre… Parce que tu sais qu’à telle station, il y a la bande à machin qui traîne. C’est clairement eux qui font la loi, et c’est insupportable pour beaucoup de monde. À l’époque, les concerts de punk n’ont pas encore le droit de citer dans les salles officielles, ça à tout le temps lieu dans des endroits en marge, des squats, dans un milieu où il n’est pas de très bon ton d’avoir recours ni à la police ni à des boîtes de sécu. Donc un milieu très favorable au fait qu’une bande un peu violente et organisée puisse faire la loi comme elle l’entend. Dans cette espèce de jungle urbaine alternative tu pouvais croiser le meilleur comme le pire. Le meilleur, c’était des mecs incroyablement intéressants, des politiques, des militants, qui pouvaient t’apporter énormément de choses à tous les niveaux, et le pire, des bandes de gros fachos avinés, des toxicos qui pouvaient te découper au cutter pour dix balles… Aller à un concert, c’était une vraie aventure. Pour te donner un exemple, tu as des gros concerts, comme les Cure, ou Siouxies and the Banshees, où tu vas avoir, 100 mètres avant l’entrée, une trentaine de skins qui dépouillent tout le monde. Tout le monde, de façon organisée… Il n’y a pas un mec qui bouge une oreille, parce qu’ils sont 30 et que tu sais que si tu bouges tu vas te faire défoncer… À l’époque, j’étais un petit punk de 16-17 ans. J’étais punk depuis l’âge de 13 ans, et j’avais déjà vécu des scènes assez reloues… La scène alternative commence à vraiment se développer, je commence à grandir, à traîner avec des potes… Il y a eu deux-trois grosses bagarres où normalement on aurait dû se carapater comme des lapins et où on décide de tenir. Et forcément, les mecs en face ne sont pas des surhommes, si tu leur mets une droite dans l’axe, ils restent sur leur cul comme tout le monde… Et ça, ça arrive de plus en plus souvent, à un moment donné, on se dit “il suffit de n’être pas tout seul et un peu solide, et les mecs ne font pas la loi”. Dont acte. En décembre 86, avec un pote qui s’appelle Jeff, on décide de monter une bande qui aura pour vocation de ne plus courir, d’aller où on veut quand on veut, de ne craindre personne, de faire changer la peur de camps. Donc, pas vraiment de vocation politique avouée, une volonté antifa radicale indiscutable et sine qua non… J’avais déjà un petit parcours politique institutionnel au P.C., mon pote Jeff, lui n’en avait vraiment rien à foutre. C’était juste de l’antifa radical. Au début on est deux, puis se retrouve rapidement à quatre ou cinq, et on commence à traîner en bande. On va où l’on veut, quand on veut, et quand on croise les mecs, on ne baisse plus les yeux, bim bam boum !, et très vite, ça devient l’inverse… Red Warriors est un nom qui commence à circuler… Du trip “on est en bande et on ne craint personne”, ça devient, “on ne va plus les attendre, on va aller les chercher”. C’est nous qui lançons le terme “chasseur”, chasseurs de skins. À l’époque skin égale faf. On commence à devenir officiellement, les premiers chasseurs de skins. La bande grossit de manière purement affinitaire, au hasard des rencontres. Jeff et Rico se connaissent depuis un moment… Jusqu’à la fin où on sera 14 dans le noyau dur. Après on pourra regrouper jusqu’à 60 personnes autour de nous.
Déjà à l’époque, médiatiquement on va souvent mettre en balance les Red Warriors et les JNR ?
Julien : Les JNR sont nées de la volonté d’un ancien briscard de l’extrême droite française, Jean-Gilles Malliarakis, qui avait déjà monté le MNR. Il caresse le secret espoir de faire ce qu’on fait les Anglais avec les skins. Il se renseigne pour savoir qui est la personne la plus en vue dans ce milieu, il se trouve que c’est Serge Ayoub, dit Batskin. Il prend contact avec lui et ils élaborent ensemble l’idée d’une structure à vocation politique qui organiserait les skins fafs. Il met à leur disposition des moyens énormes, un local rue de Châtelet, et Ayoub se charge de recruter une espèce de garde S.A., qu’on va voir défiler une fois ou deux le premier mai, en rang… C’est voué à l’échec, Ayoub lui-même le sait, il y a une interview super drôle de lui à l’époque, où il reconnaît que 90% de ses troupes vont finir en prison… Il a affaire à des nez-de-boeuf ingérables qui sont plus psychopathes qu’autre chose, il a raison d’ailleurs, parce que ceux qui ne sont pas morts d’overdose sont au trou à perpétuité… Rapidement, ça devient la structure facho skinhead organisée. Et, finalement, on a eu très peu de confrontations directes, on en a éclaté plein qui se disaient JNR mais on ne les a jamais rencontrés… Mais on n’a jamais été dans cette culture-là non plus. On a bien lu Lao-Tseu et Hô Chi Minh, quand le rapport de force n’est pas favorable tu ne fais pas de la guerre frontale. Tu fais de la guérilla. On savait ce qu’on était, on savait qu’on était les moins nombreux pour l’instant, et on n’allait pas leur filer rencard dans un terrain vague… Il y a eu de grosses, grosses bastons, mais il n’y a jamais eu de rencontre officielle. On en avait rien à branler… On ne se considérait pas comme des voyous, mais comme des militants. Donc, dès qu’on en voyait un dans la rue, on le pliait, pour que les mecs finissent par comprendre que concrètement il n’était plus anodin de se balader habillé en néo-nazi. À l’époque tu croises des mecs avec des croix gammées en bandoulière, drapeau bleu blanc rouge avec des croix celtiques au milieu, ces mecs c’est de la propagande permanente. Ils savent dorénavant que c’est dangereux de se balader comme ça.
Vous vous dites redskins dès le départ ?
Julien : Ouai, en référence au groupe anglais. Ce mouvement c’est nous qui le créons parce qu’au départ c’est juste un groupe de musique. Et une équipe de football américain. Je te dis ça parce qu’au départ, on détourne les logos de cette équipe, parce qu’il n’existe rien d’autre. Mais la référence est celle du groupe. On hallucine d’apprendre que c’est un groupe de skinheads clairement affiché, mais de gauche, trotskiste. On apprend qu’ils sont super engagés auprès des mineurs en grève, à fond la caisse à gauche, à fond la caisse en soutien à l’Antinazi League… Nous, le trip skinhead ça nous branche. Sauf qu’à l’époque, on ne se rase pas le crâne, parce qu’on ne veut surtout pas être confondus avec des skins, donc avec des fafs. Donc on se dit red, plus par opposition aux fafs que par appartenance idéologique… Pour les fafs, tout ce qui n’est pas faf, c’est rouge. Ils n’aiment pas les rouges, donc nous on est les rouges. On veut être ce qu’ils aiment le moins. Donc surenchère d’oripeaux communistes, faucilles et marteaux, j’en passe et des meilleures alors qu’on s’en fout. On accapare tout ce qui nous démarque d’eux de façon claire et nette. Quand on débarquait tous lookés en bomber, avec des cheveux sur le dessus mais quand même bien rasés, avec des bagues de combat, des battes qui dépassaient du sac à dos, les gens te regardaient bizarrement. Alors directement ils voyaient des trucs CCCP, faucilles et marteaux, ils savaient qu’ils avaient affaire à des redskins. Mais déjà à l’époque, Brejnev, la Chine communiste, ce n’est pas notre tasse de thé. Moi je suis déjà libertaire sans le savoir, et une grosse majorité des autres s’en fout. L’idée c’est l’antifascisme radical. Typiquement, on ne sait pas ce qu’on aime, mais on sait ce qu’on n’aime pas.
Vous allez rapidement vous mettre à chasser ?
Oui, on n’attend plus de les rencontrer, on va les chercher. On a tellement subi, et on se rend tellement compte après les premières confrontations que ces mecs ce n’est que de la tchatche, qu’on décide de partir en goguette pour les faire disparaître. Ça devient une espèce de vocation. C’est violent, super violent, peut-être un peu trop à mon avis avec le recul… Mais on n’y va pas avec le dos de la cuillère. En même temps tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, il y a d’authentiques fondus en face et donc on ne sort pas tous nus… On préfère en avoir trop et ne pas s’en servir, que l’inverse. On a un risque vital clairement engagé. On a peur comme tout le monde, mais le fait d’être sûrs d’avoir raison nous transcende…
 Vous pratiquez des sports de combat ?
Vous pratiquez des sports de combat ?
Julien : Je me suis mis à la boxe assez tard. Fin 87, on était bien barrés… On faisait la fête, on buvait, c’était le début des acides pour nous… C’était un peu too much selon moi. Ça faisait un moment que je voulais me mettre à un sport de combat. Pour mettre un frein à la défonce et être affuté physiquement. À l’époque on se tapait au moins deux fois par jour… Je me suis inscrit dans un club de boxe américaine fin 87 et je me suis entraîné comme un bourrin… Trois fois trois heures par semaine, cours du débutant au confirmé, alors que techniquement je ne touchais pas un caramel. C’était marrant, pour les boxeurs il y a toujours une grande appréhension avant de monter sur un ring. C’est un truc un peu extrême, tu mets ta santé en jeu… Les mecs étaient démunis par rapport à ça. Moi j’arrivais d’un univers où on ne se tapait pas avec de la mousse sur les mains, où il n’y avait pas d’arbitre pour arrêter quand il y en a un qui a un genou à terre, où on se tapait à coup de gants plombés, de bagues de combat, de battes de baseball, de paraboots… Alors pour moi, monter sur un ring pour un combat avec des règles ça me paraissait moins la mer à boire que pour certains autres… Mon prof m’a très vite fait faire des combats, et à la fin de ma première année de licence j’ai été champion de France “espoir”. Du coup, j’ai tout arrêté, de boire, fumer. Il y en avait d’autres dans la bande, Skan, pour la boxe française, Kim qui était à fond la caisse dans la boxe chinoise et qui se mettait à la boxe thaïe. Il a fini champion d’Europe de boxe chinoise. Tout le monde, au bout d’un moment traficote dans la thaïe. On est tous tombés d’accord sur le fait que c’était le plus efficace. Il y en avait qui étaient à donf, avec combats, hygiène de vie… et ceux qui continuaient à faire la teuf mais qui ne rechignaient pas à aller mettre des coups dans les paos. On avait tous au moins des rudiments… La particularité des Red Warriors c’est que la bande n’était pas du tout homogène au niveau géographique. Contrairement à d’autres bandes, on n’était pas issu du même quartier… Ce n’était pas pour ça qu’on traînait ensemble. Ce qui nous unissait, c’était une dimension autre… Au-delà du plaisir qu’on avait à être ensemble, on se retrouvait pour des actions précises, sporadiques, préparées… Ce qui nous rendait particulièrement efficaces, redoutables et redoutés, c’est qu’on arrivait, on frappait et on disparaissait. On était une bande qui existait clairement puisqu’il y avait des mecs qui se faisaient ruiner dans tous les coins, mais personne ne savait concrètement d’où on venait, où on allait, et où on pouvait éventuellement nous trouver. Moi je traînais plus avec Jeff, Anto, Rico. Les mecs du 13°, Kim, Skan, Jérôme, Karim, traînaient ensemble en semaine, Nano, Franky… Et donc chacun dans son coin, s’il était amené à démonter des mecs, c’était les Red Warriors. Du coup, les gens avaient l’impression qu’on était hyper nombreux et partout.
Est-ce qu’à un moment donné vous avez des aspirations à construire autre chose qu’un groupe antifa radical ?
Julien : Non. Objectivement, on est complètement déconnectés des organisations politiques. Premièrement, on est un peu dans le creux de la vague, c’est la période où tu as l’impression que la gauche est au pouvoir, et que ça ne sert plus à grand-chose de militer. On faisait peur au PC, à la LCR, on était un peu vécu comme des fous furieux.
Quelle était votre bande son à l’époque ?
Julien : Les Redskins, bien sûr. Il n’y a pas de groupe clairement redskin français. Ça va plutôt être des groupes redskins par destination. On écoutait Nuclear Device, les Bérus, OTH dont c’est presque la fin, les Sheriffs, Laid Thénardier, les Kamionërs du suicide… Ils faisaient une musique qui nous parle, avec des textes clairement engagés. Pour nous les Nuclear, c’était le groupe Redskins français. Rapidement comme on connaissait bien ces groupes, ils ont commencé à jouer le jeu. Tu prends la pochette des Bérus de “Joyeux merdier”, sur le verso tu as une photo de François qui saute en l’air, qui ouvre son bomber, il est rasé et il a un tee-shirt redskins. C’est une espèce de reconnaissance mutuelle, pas du racolage, parce qu’on est 15 à Paris, mais à un moment donné, on se reconnaît. La particularité de la scène alternative dans laquelle on traînait, c’est que la majorité des mecs venait des mêmes endroits que nous. Comme nous, ils traînaient dans les squats, les concerts, avant de faire des groupes.
Au lieu de faire de la boxe, ils ont fait de la musique ?
Julien : Exactement. Ils avaient du respect pour ce qu’on faisait, et ils étaient contents qu’on vienne à leurs concerts. Pour nos idées et notre action. On a vite sympathisé avec beaucoup. Et pour d’autres c’est bien antérieur, comme les Bérus. Rico les connaissait limite avant qu’ils n’existent. On était une composante de la rue comme ces groupes-là étaient une composante de la rue. Il y a eu rapidement une collusion volontaire entre les Red Warriors, à vocation politico-violente, et des groupes comme les Bérus. Même les Washington Dead Cats dans une moindre mesure… Il y avait à cette époque-là toute une mouvance musicale, qui se reconnaissait dans un discours anti-autoritaire, et donc antifa.
Vous vous retrouvez impliqués dans le S.O. Béru ?
Julien : Par affinité. On est toujours fourrés aux concerts, je les connais depuis l’époque de l’Usine. La bande commence à être connue, on est ceux qui avons mis une branlée à telle bande, telle bande, on est la garantie d’un concert sans embrouilles. C’est le moment où les Bérus démarrent vraiment, ils ont régulièrement des problèmes avec les fafs, notamment en province, ils ont aussi des problèmes avec les boîtes de sécu, qui ont déjà à l’époque des accointances plus que douteuses… Les mecs ne sont pas habitués à gérer ce genre de public et il y a des dérapages. Le succès aidant, les Bérus arrivent à imposer leur S.O. C’était à ma connaissance une première dans le rock en France. Dans ce S.O. on retrouve de nombreux Red Warriors, mais pas uniquement, il y a aussi beaucoup de leurs vieux potes des années 70, des totos. D’ailleurs, certains vont devenir Red Warriors.
Comment est ce qu’on devient Red Warrior ?
Julien : Contrairement aux délires de la presse à l’époque, il n’y a pas de parcours du combattant, de rite initiatique. C’est archi-affinitaire, c’est comme aujourd’hui, tu ne vas pas voir une bande de potes pour dire “je peux traîner avec vous ?”. Tu es là un jour, puis le lendemain et au bout d’un moment c’est comme si tu avais toujours été là… Si le mec le fait bien sûr un plan humain, si en cas d’embrouille le mec est présent… Après à l’époque, pour traîner avec nous, il fallait en vouloir… Un des mecs qui ont traînés au début avec nous, Mickey, un jour me dit : “c’est too much pour moi, j’arrête”. Moi je dis respect, le mec ça reste un pote, mais il y a eu deux trois fois où des trucs sont partis en live trop fort pour lui, et du coup il n’assumait plus et plutôt que de mettre en danger le groupe il a préféré arrêter. D’autres groupes vont se monter en référence aux Red Warriors ? Julien : Vachement… Il y a plein de petits, Redboys, Lenin killers… Dès que tu tiens la rue, les concerts, les mecs c’est toi qu’ils voient et ils commencent à s’habiller comme toi… Le constat que tu peux faire, aujourd’hui, si tu regardes toutes les capitales européennes, Madrid, Londres, Berlin, Rome, il n’y a qu’à Paris qu’il n’y a plus de fafs. C’est un état de fait parisiano-parisien. C’est dû au phénomène de chasseurs qu’ont engendré les Red Warriors, qui s’est surdéveloppé et qui est même devenu à un moment un phénomène de mode… Tu voulais être dans le mouv’ ? Il fallait monter une bande, écouter soit les Bérus, soit du hip-hop bien véner, et être chasseur…
Vous aviez des liens avec les bandes de zulus ?
Julien : Musicalement, on était plus dans le rock alternatif. Mais on connaissait les mecs, ça correspondait à la prise de conscience dans les cités de ce qui se passait sur Paris…
Dans les autres bandes quelles sont celles qui ont compté ?
Julien : Il y avait des bandes qui nous étaient antérieures et qui étaient plus dans la fin de la mouvance rock‘n’roll, dans le trip les rebelles contre les blacks, notamment une bande très sérieuse de blacks qui s’appelait les “Black Panthers”, en référence à l’organisation américaine mais qui n’avaient absolument rien à voir avec eux. Ils étaient très respectés, ce sont eux qui ensuite ont monté la boîte de sécu “Bafalos”. Il y avait aussi les Bouns, les Asney. Et ensuite, dans la foulée des Red Warriors, quand on a eu droit au chapitre, tu as tout de suite eu des bandes de chasseurs qui se sont monté, les Ducky Boys, la première génération qui était très carrée…
Les Rudy Fox ?
Julien : Eux, c’est sur la fin. C’est la génération d’après nous, enfin génération, ils avaient trois-quatre ans de moins que nous. À cet âge-là ça compte ! Ils sont arrivés sur la fin du délire chasseur, au moment où ça partait un peu en couille, avec des gros dérapages, des grosses bavures, à chasser n’importe qui… Dans cette sale ambiance générale ils ont eu la particularité de conserver une éthique super carrée. Ils prônaient la tolérance, l’intransigeance face aux fafs s’ils en rencontraient mais pas la baston pour la baston. Ce qui a perdu les Requins Vicieux, les Ducky Boys, qui, le temps passant, avaient mis de côté toute démarche politique. Nous, on n’a très vite plus grand-chose à voir avec ça, on constate qu’il n’y a plus de nazis dans les rues. En 90-91, à Paris, plus personne n’ose sortir dans la rue avec un bomber kaki et un drapeau bleu blanc rouge. Ça, ça veut dire qu’il y a partout des mecs qui chassent…
Comment finit l’histoire ?
Julien : Elle ne se finit pas officiellement. Il y a une fin à l’aventure, que je situerai autour de 93, après sept années bien actives, avec des hauts et des bas… On a tous grandi, certains ont des gamins, d’autres rentrent dans la vie professionnelle, et, objectivement, on n’a plus de raison d’être. On a continué à se voir, mais en dehors des Red Warriors. Ça s’est fini de sa belle mort, et on a assisté un peu en spectateur à la fin du délire chasseur qui commençait à partir en couille… Mais on n’avait plus rien à voir avec ça. Pour nous, ce délire ce n’était pas une échappatoire de galériens. On n’avait pas besoin d’une famille de substitution. Objectivement on n’avait pas besoin de ça pour exister. C’était une démarche politique, mine de rien assez réfléchie. On ne voulait pas faire une bande pour faire une bande. Les fafs qu’on a marave à coups de battes de baseball, ce n’était que la partie visible de l’iceberg. Le fascisme des casernes, des commissariats, des facultés de droit, celui-là tu ne le combats pas à coup de battes de baseball. Nous on s’était juste dit : on va prendre ceux qu’on voit dans la rue et dans les concerts parce que c’est là qu’on traîne. C’est sûr qu’il y en a ailleurs, mais nous on en a marre de les voir là. On a fait le ménage là parce que c’était notre univers…